Accueil > NATION-ALGERIE > GÉOGRAPHIE CULTURELLE ET GÉOPOLITIQUE EN KABYLIE, & GRANDE KABYLIE : DU (...)
GÉOGRAPHIE CULTURELLE ET GÉOPOLITIQUE EN KABYLIE, & GRANDE KABYLIE : DU DANGER DES TRADITIONS MONTAGNARDES
par CAMILLE LACOSTE-DUJARDIN, paru dans "HERODOTE" 2001-2002
samedi 20 mars 2010
SOCIALGERIE, présente ici deux monographies de Camille LACOSTE-DUJARDIN, précédemment publiées par la revue "HERODOTE" en 2001 - 2002, qui nous avaient été adressées par un lecteur du site :
"GÉOGRAPHIE CULTURELLE ET GÉOPOLITIQUE EN KABYLIE
La révolte de la jeunesse kabyle pour une Algérie démocratique"
(Hérodote, N°103 –2001/4)
"GRANDE KABYLIE : du danger des traditions montagnardes"
Hérodote, N°107 –2002/4
Ces deux études, de même que les "récits" de Fanny COLONNA dans son dernier livre "Le Meunier, les moines et le bandit - Des vies quotidiennes dans l’Aurès (Algérie) du XXe siècle" , présenté sur le site
s’attachent à décrire et analyser des histoires de vie dans les deux massifs montagneux, la Kabylie et les Aurès, hauts lieux de lutte pour la libération de l’Algérie.
Ils peuvent beaucoup éclairer les raisons et particularités qui ont constitué le levain de la résistance, et l’ancrage de l’insurrection dans ces deux massifs montagneux.
En cette année 2010, ces textes qui constituaient une introduction à la commémoration du 30ème anniversaire du "printemps berbère" de 1980, ont vu leur mise en ligne retardée de par la suspension d’activités du site au printemps.
GÉOGRAPHIE CULTURELLE ET GÉOPOLITIQUE EN KABYLIE
La révolte de la jeunesse kabyle pour une Algérie démocratique
(Hérodote, N°103 –2001/4)
par Camille Lacoste-Dujardin [1]
« Les germes d’une guerre civile sont là... », « Algérie : le divorce d’avec la
jeunesse », « Algérie, les forces de l’ordre ont empêché la marche kabyle dans la capitale », « Répression en Kabylie », « Grève générale en Kabylie », « Marche en Kabylie », « L’enquête sur les morts de Kabylie », « Les Kabyles se soulèvent contre le “mépris” du pouvoir », « Les émeutes en Kabylie ont fait une soixantaine de morts et près de deux mille blessés en deux mois », « Algérie : la gendarmerie accusée, le pouvoir préservé ».
Tels sont quelques-uns des titres ou sous-titres d’articles publiés dans des journaux français en juin, juillet et août 2001. [2]
Nombre de ces informations sont complétées de photos de presse ou, à la radio et la télévision, d’entretiens avec de jeunes manifestants. À y regarder de plus près, la plupart des slogans figurant sur les banderoles, y compris celle qui portait l’expression kabyle Ulac smah [3]
« Aucun pardon » –pour les gendarmes–, ont été écrits en caractères latins, la plupart en français, comme le français est aussi la langue dans laquelle beaucoup de ces jeunes interviewés se sont exprimés en pleine effervescence, spontanément, avec une expression châtiée, sans guère d’accent local. Il semble bien que ce mode d’expression soit une marque spécifique et habituelle de la jeunesse kabyle car, en Kabylie même, encore aujourd’hui, les murs sont recouverts de slogans accusateurs visant les gendarmes et les généraux... en français.
C’est en tout cas un fait incontestable : l’effervescence qui se développe
aujourd’hui en Algérie a pris naissance parmi cette jeunesse de Kabylie, à très peu de distance d’Alger, avec une grande ampleur. Ces récents « événements de Kabylie » ont déjà fait, en deux mois à peine, de la fin du mois d’avril à la fin juin 2001, une soixantaine de morts et plus de deux mille blessés en Kabylie (Le Monde, 22 août 2001). Toutes ces observations méritent qu’on se pose les nombreuses questions afin de tenter d’y répondre. En quoi les habitants de cette région toute proche d’Alger, pourtant bons musulmans [4], se distinguent-ils donc au sein de l’ensemble national ? En 1991, la Kabylie a été la seule région d’Algérie à ne pas accorder ses suffrages au FIS (Front islamique du salut). Alors, et depuis,
pourquoi n’ont-ils presque pas donné prise aux mouvements islamistes ?
Bien au contraire, la génération des Kabyles adultes avait adhéré massivement aux partis démocratiques : le FFS (Front des forces socialistes) d’Aït Ahmed et le RCD (Rassemblement pour la culture et la démocratie) du Dr Saïd Sadi. Mais pourquoi la jeunesse kabyle –leurs enfants– constitue-t-elle aujourd’hui une avant-garde politique, en venant même à dépasser ces partis démocratiques eux-mêmes ? Pourquoi
sa mobilisation actuelle, dans l’expression de nombreuses revendications contre le pouvoir algérien, s’étend-elle au point de risquer de gagner toute l’Algérie ?
Pour être en mesure de saisir les données des problèmes, il faut s’efforcer, à travers les réalités de la géographie, de l’histoire, de la culture et des structures sociales assez spécifiques de cette partie de l’Algérie, de tenir compte et de comprendre les représentations que les Kabyles eux-mêmes ont de leur région et de leur place dans la société algérienne. Incontestablement, ces représentations leur donnent une telle assurance dans leur identité nationale, et suscitent parmi eux une telle prise de conscience politique, qu’ils n’hésitent pas à être les premiers à manifester pour exprimer clairement leurs revendications : « La primauté du politique sur le militaire, et une Algérie démocratique et sociale » (Coordination de Kabylie, 20 août 2001). Qui sont donc ces Kabyles, sur quels fondements s’est
construite leur identité, quels en sont les composantes ?
Une montagne berbère très peuplée à proximité d’Alger
Les Kabyles sont d’abord des imesdourar « montagnards », ce dont ils sont fiers. Tamourt leqbayl , le « pays des Kabyles » ou la « patrie kabyle » et la « terre kabyle » tout à la fois, à laquelle ses habitants sont très attachés, est en effet un ensemble montagneux, la Grande Kabylie, très densément peuplé (en moyenne 200 hab./km2) qui, à une cinquantaine de kilomètres à peine à l’est d’Alger, s’étend sur un peu plus de 200 km d’ouest en est et une centaine du nord au sud.
Je distingue ici de cette Grande Kabylie les « Petites Kabylies » qui lui font suite et comprennent, vers l’est, les massifs de Jijel, des Babors et, vers le sud, la région de Bordj Bou Arreridj, plus arabisés. Et je considère que la région à l’ouest de Béjaïa fait partie de la Grande Kabylie (voir carte ci-dessous).
Bordées au nord par la Méditerranée, les montagnes de la Grande Kabylie
surplombent vers le sud, par la haute sierra calcaire du Djurdjura, la large vallée de l’oued Sahel-Soummam, qui rejoint, au nord, la côte méditerranéenne au port de Béjaïa. Cette longue et large vallée fertile accueille les grandes voies de communication qui relient le centre de l’Algérie et sa capitale à toute sa région orientale (par les centres de Bouïra et d’El-Kseur), vers la ville de Constantine et au-delà vers la Tunisie.
Après avoir quitté Alger, et traversé, en une quarantaine de kilomètres, la partie orientale de la plaine de la Mitidja, l’autoroute de Tizi-Ouzou file droit vers l’est en franchissant, après Boudouaou, les portes de la Kabylie : c’est là, près du pont de l’Isser, un lieu stratégique où ont eu lieu maintes célèbres batailles et là où, plus récemment, les hommes au pouvoir à Alger établissent le « cordon sécuritaire » qui fait barrage aux manifestations kabyles interdites à Alger, ainsi bloquées en Kabylie. C’est là aussi, sur le pont même de l’oued Isser, que les gendarmes avaient empêché l’écrivain kabyle Mouloud Mammeri venant d’Alger de poursuivre jusqu’à Tizi-Ouzou, où il devait faire une conférence à l’université sur les poèmes kabyles anciens ; c’est cette interdiction qui avait déclenché les émeutes du « printemps berbère » de 1980. C’est encore en ces lieux que, le 8 août 2001, d’autres gendarmes ont stoppé la marche des jeunes Kabyles sur Alger.
Tout près de là, sur les collines, au col de Thénia, l’on découvre Tamourt leqbayl , le pays des Kabyles : des montagnes qui dominent de part et d’autre le bassin du fleuve Sebaou et de ses nombreux affluents, où se niche la capitale régionale de la Kabylie, Tizi-Ouzou (le « col des genêts »). Cette large et riche plaine du Sebaou sépare en effet la Grande Kabylie en deux parties.
Au nord, la Kabylie maritime est une chaîne côtière dont les sommets dépassent de peu 1 000 m (1 278 m au tamgout des Aït Jennad) ; son relief escarpé s’allonge d’ouest en est et domine abruptement la Méditerranée par un rivage accidenté (avec les ports de Dellys, Tigzirt, Azefoun).
Au loin, vers le sud, l’horizon est fermé par la grande sierra calcaire du Djurdjura (Djerjer) , appelée aussi par les Kabyles adrar budfel , la « montagne de la neige », dont le sommet, la pyramide de Lalla Khedidja (à 2 308 m), domine le col de Tirourda qui permet de redescendre dans la vallée de la Soummam ; enfin, au centre, entre le bassin du Sebaou et le Djurdjura, les hauteurs d’un massif ancien
culminent à 1 000 m à Larbaâ n’aït Iraten –anciennement Fort-National–, où
l’armée française avait, dès la conquête, construit une citadelle. Ces hauteurs, entaillées de profonds ravins où dévalent les torrents, sont disposées en un ensemble de longues digitations nord-sud qui descendent depuis les abords du Djurdjura, à une moyenne de 800 m d’altitude, en de longues croupes, chacune d’elles couronnée de nombreux villages et petites villes jalonnant les chemins des crêtes. Les Kabyles appellent cet ensemble le massif Agawa , du nom que se donnent ses habitants : les Igawawen (au singulier : Agawa, devenu « Zouaoua » en arabe et « Zouave » en français).
La montagne adrar , dans sa diversité, occupe une place de choix dans les représentations des Kabyles, dans leur culture comme dans toute leur vie et leurs activités [Lacoste-Dujardin, 2000]. Alors que le Djurdjura est, pour eux, le domaine d’une nature sauvage, inhospitalière, résidence d’êtres surnaturels ou lieu de refuge de bandits, juste en dessous, la montagne moyenne est celle qui accueille et abrite les maisons des hommes. Ils s’y concentrent en gros villages, perchés audessus des plaines, celles-ci certes fertiles et propres à la céréaliculture, mais tout aussi dangereuses autrefois que la haute montagne, car à la merci d’incursions hostiles de cavaliers turcs.
Ce massif Agawa est la partie la plus densément peuplée de la Grande Kabylie ; les villages s’y pressent, avec, autrefois, leurs maisons à toits de tuiles rondes et rouges, sur les crêtes de la montagne surpeuplée –on compte environ 4 millions d’habitants en Grande Kabylie–, au point d’y atteindre plus de 200 hab./km2, ce qui n’a pas manqué d’étonner les premiers voyageurs stupéfaits de trouver, juchés sur les montagnes,
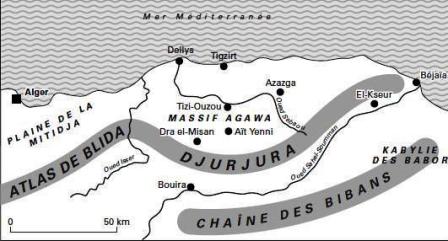
- GRANDE KABYLIE
des « centres de population où le nombre d’habitants est dix fois supérieur aux chiffres des villages de la plaine » [Carette, 1848, t. II, p. 327]. Ce massif est aussi la partie la plus connue, et celle d’où sont venus jusqu’en
France le plus grand nombre d’émigrants.
Langue tamazight « berbère » et culture des imazighen, « Berbères »
Fiers d’être des montagnards, les Kabyles sont aussi fiers de leur culture
berbère, distincte de la culture arabe dont la langue est la seule à être officielle en Algérie et au Maghreb. [5] La culture kabyle est donc d’abord une langue, le berbère, qui fait partie de la grande famille des langues chamito-sémitiques (auxquelles appartient aussi l’arabe). Le terme de « berbère » est d’origine incertaine, il existe bien barbar, berber en arabe, barbaru s en latin, du grec barbaros, « étranger », mais aucun rapport entre ces termes ne paraît établi avec certitude (d’après le
Dictionnaire de la langue française Le Robert, 1985).
La plupart des berbérophones préfèrent aujourd’hui nommer leur langue la
tamazight , langue des imazighen , « hommes libres » (tout comme le français a été la langue des « hommes de condition libre »). La tamazight parlée à travers le Maghreb, en Algérie et au Maroc surtout, aurait peut-être aujourd’hui environ trente-deux millions de locuteurs, sédentaires habitant la plupart des montagnes du nord de l’Afrique, ou nomades comme les Touareg dans le Sahara et au Sahel ; mais il n’y a plus de continuité entre toutes ces régions berbérophones. C’est pourquoi, tout en ayant la même langue et en parvenant rapidement à l’intercompréhension, les berbérophones s’expriment dans des parlers un peu différents selon les régions qu’ils habitent : les 4 millions de Kabyles (30% de toute l’Algérie) parlent la taqbaylit , les Mozabites (de l’oasis du Mzab) s’expriment en tamzabit , les Chaouiïa de l’Aurès en tachaouit ; la plupart des Touareg sahariens parlent la tamachek ou la tamahaq en Algérie, ou d’autres langues encore comme au Mali, au Niger, au Burkina Faso ou en Libye. En Mauritanie certains parlent zenaga (arabo-berbère), tandis que dans les montagnes marocaines, les Chleuhs du Sous et du Haut-Atlas
parlent la tachelhit . Plus au nord, dans le Moyen-Atlas, on s’exprime en tamazight , et les Rifains parlent la tarifit . Nombre d’autres groupes résiduels sont encore éparpillés à travers toute cette vaste aire autrefois uniformément berbérophone qui allait des îles Canaries à l’ouest jusqu’à l’oasis de Siwa à la frontière égyptienne à l’est, et de la Méditerranée au nord jusqu’aux confins saharo-sahéliens au sud.
La langue tamazight est donc la plus anciennement parlée au Maghreb, et il est probable que ses locuteurs actuels sont les héritiers des peuples autochtones du nord de l’Afrique, les habitants préhistoriques du Maghreb. Le succès actuel de la désignation de cette langue orale comme tamazight, celle des imazighen , « hommes libres », est le signe d’une renaissance culturelle et d’un militantisme politique actuellement très vif, auquel les Kabyles prennent une part tout particulièrement active en ce moment en Algérie. Le refus persistant de la reconnaissance, par le gouvernement algérien, de la langue tamazight comme langue officielle en
Algérie conjointement avec la langue arabe
[6] incite les jeunes Kabyles à placer cette reconnaissance au premier rang de leurs revendications.
Un patrimoine historique qui nourrit la fierté identitaire
Car les imazighen d’aujourd’hui sont aussi légitimement fiers de leur passé commun à tout le nord de l’Afrique, la Berbérie, qu’ils appellent Tamazgha ou Tamourt imazighen le « Pays des hommes libres ». Grâce au renouveau assez récent d’un très dynamique courant intellectuel kabyle sur les deux rives de la Méditerranée, en Algérie grâce à de nombreuses associations (dont le MCB : Mouvement culturel berbère), comme en France en immigration (entre autres avec l’ACB : Association culturelle berbère), où s’active une intelligentsia kabyle en correspondance étroite avec le pays, les nouvelles générations de jeunes Kabyles ont acquis une connaissance passionnée de leur culture [Lacoste-Dujardin, 1999]. Ils s’enorgueillissent de leur histoire, dont leurs ancêtres ont été des acteurs dynamiques.
De grands rois et de fiers résistants
Ils célèbrent la gloire des grands royaumes, avec de grands rois, tel, avant notre ère, Massinissa, vainqueur des Carthaginois et unificateur de la Numidie (l’est du Maghreb), et plus tard, de grands empires régnant sur une importante partie du nord de l’Afrique : ceux des dynasties Fatimides, Zirides, Hammadides, fondateurs de Béjaïa, des Almoravides, qui aux XIe et XIIe siècles régnèrent sur le Sahara occidental, le Maroc, l’ouest de l’Algérie et l’Espagne, des Almohades ensuite, installés au Maroc, en Algérie, en Tunisie et encore en Andalousie.
Aujourd’hui, les jeunes Kabyles sont peut-être plus fiers encore des héros
berbères rebelles qui animèrent de multiples et célèbres révoltes contre les
fréquentes invasions, dans lesquelles ils s’illustrèrent tout particulièrement : d’abord contre Carthage, tel Syphax, puis contre les Romains comme Jugurtha, Tacfarinas ou Firmus. Ils connaissent aussi un célèbre chrétien berbéro-romain : saint Augustin, évêque d’Hippone (l’actuelle Annaba), dont la mère, Monique, était berbère et a récemment fait l’objet d’un congrès à Alger. C’est encore, au VIIe siècle, Kocéïla, puis la Kahéna, « reine de l’Aurès », rebelle à la conquête arabe, et enfin, aux XVe et
XVIe siècles, les plus récentes résistances armées contre les incursions des Espagnols, des Portugais. Enfin, ils cultivent le souvenir de la résistance héroïque à la conquête française, de la célèbre Fadhma n’Soumeur en haute Kabylie en 1857, qui, objet d’expositions dans les musées, est encore représentée sur des cartes postales.
La fierté de ce passé nourrit aujourd’hui une nouvelle mode, révélatrice de
l’identification à ces héros historiques : celle de prénoms attribués aux enfants, tel le malheureux Massinissa Guermah, assassiné le 18 avril 2001, à l’âge de dix-neuf ans, par des gendarmes dans leur caserne de Beni Douala, tandis que l’un de ses camarades se prénomme Kocéïla. On constate aussi la mode de pseudonymes choisis par des chanteurs ou acteurs kabyles (comme Tacfarinas).
Une farouche résistance à la conquête
L’histoire plus récente a ravivé ces souvenirs et réveillé une tradition de promptitude à la rébellion et de constance dans la résistance. Il y a plus d’un siècle et demi, ne fallut-il pas attendre vingt-sept années après le débarquement des Français à Alger en 1830 pour que l’armée française parvienne enfin à conquérir le massif Agawa, en 1857 ? J’en prendrai l’exemple que je connais tout particulièrement, celui des hommes et des femmes d’un groupement tribal de Kabylie maritime, les Iflissen Lebhar, situés entre Tigzirt et Azefoun, à proximité de la voie d’accès empruntée par les conquérants de la Kabylie depuis le port de Dellys jusqu’à Tizi-
Ouzou. Pendant pas moins de vingt-sept années, entre 1844 et 1871, ils n’ont jamais manqué de participer à chaque révolte régionale, ni de combattre toute colonne s’aventurant sur cette voie de montagne, toujours sur le même champ de bataille, une position retranchée sur une crête à l’entrée de leur territoire (lieu d’un marché : le Tleta des Iflissen Lebhar). Tant et si bien qu’à plus de six reprises ils se sont engagés dans des combats contre l’armée française, en 1844, 1845, 1854, 1856, 1857, puis, enfin, dès le 13 mai 1871, allant ainsi au bout de l’insurrection qui devait gagner ensuite toute la Kabylie dans une grande révolte populaire. [7]
La Kabylie perd les bénéfices de sa lutte pour l’indépendance
Plus récemment encore, pendant la guerre de libération nationale (1954-1962), la wilaya III, celle de Grande Kabylie, en dépit de sa proximité d’Alger, a connu les plus nombreux combats en Algérie, elle a aussi payé le plus lourd tribut en morts, puisque toute une génération d’adultes a été très sévèrement ponctionnée, au point d’accroître encore le déséquilibre démographique [8]].
De cet héroïsme qui fut celui de leurs pères et grands-pères, les jeunes gens de Kabylie sont conscients et fiers. Et ils savent aussi qu’après cette guerre, dès 1962, avant même l’indépendance, le pouvoir en Algérie a été indûment confisqué à leurs mêmes pères et grands-pères, ces combattants de l’intérieur, par des officiers de l’armée de l’extérieur, composée d’unités demeurées indemnes, restées l’arme au pied, le long de la frontière algérienne de l’ouest. Nombre d’entre eux se souviennent aussi que, en désaccord avec Ahmed ben Bella, le premier chef du gouvernement algérien installé par cette armée, Hocine Aït Ahmed (l’actuel dirigeant du FFS), avait, en 1963, pris les armes et constitué un maquis en Kabylie, bientôt écrasé par cette même armée. Aït Ahmed fut arrêté et exilé en 1964, tandis que nombre de cadres et militants politiques kabyles émigraient en France, bénéficiant de la loi générale d’amnistie [9]. Ce lourd contentieux est un motif de plus pour refuser qu’aujourd’hui se perpétue l’exclusivité de la gestion du pouvoir national par des généraux, en l’absence de démocratie, alors que durant de longues
années, jusqu’en 1988, la proclamation d’un idéal « populaire et socialiste » s’est accompagnée du règne du parti unique (le FLN : Front de libération nationale).
Précisément, les jeunes manifestants kabyles d’aujourd’hui réclament la « réappropriation des dates historiques par le peuple algérien ». C’est ainsi qu’ils ont tenu à interdire la présence des officiels pour se réserver l’exclusivité de la commémoration, le 20 août 2001, à Ifri (chez les Ouzellaguen du versant sud du Djurdjura) du quarante-cinquième anniversaire du célèbre « congrès de la Soummam » qui s’y tint en 1956, moins de deux ans après le commencement de la guerre d’indépendance nationale. En cette même occasion, ils ont tenu à honorer la mémoire de l’initiateur kabyle et principal acteur de cet événement, Abane Ramdane, un des premiers dirigeants du FLN, qui fut, l’année suivante au Maroc, assassiné par ses rivaux. C’est que ce fameux congrès de la Soummam, en 1956, avait été dominé par une tendance très démocratique, moderne et kabyle du FLN, qui fut par la suite supplantée. Abane Ramdane y prônait la « primauté du politique sur le militaire », et une Algérie démocratique et sociale, ce qui coïncide très exactement avec les revendications actuelles de la jeunesse kabyle. Cette tendance aurait même élaboré un projet -demeuré à l’état de brouillon sans lendemain– de Constitution de l’Algérie, républicaine et... laïque ! Rien d’étonnant à ce que, célébrant le souvenir des actes de cette orientation politique marquant précocement une dominance kabyle dans le FLN, les jeunes gens de la Coordination des
villages et des aârouch (« tribus ») aient, ce jour-là, choisi pour slogan : « 1954-2001 : le combat continue » (1954 marque le début de la guerre d’indépendance).
Une culture encore vivante
À longue histoire, culture riche en productions orales et matérielles, que cette culture tamazight a exceptionnellement entretenues et développées jusqu’à aujourd’hui grâce à l’oralité, qui a stimulé la mémoire à un point extrême [10].
Une telle survie provient sans doute de ce qui devient à présent un handicap : l’absence d’écriture propre chez les Berbères. Seuls les Touareg sahariens utilisent une écriture : le tifinagh, dont les caractères alphabétiques font partie de leur éducation traditionnelle. Ils l’emploient usuellement, surtout dans des jeux poétiques, des graffitis, de courts messages. Faite pour être gravée durablement dans la pierre ou de façon éphémère dans le sable, cette écriture est demeurée inutilisée par le
commerce et l’exercice du pouvoir, qui n’employaient que la parole [11]. En l’absence de vecteurs écrits –à l’exception de cet alphabet tifinagh–, la tamazight n’a donc pu se diffuser, c’est pourquoi elle est demeurée d’usage limité à la communication entre groupes désormais réduits. Certes, cette langue contribue à maintenir la solidarité des imazighen, mais elle n’est guère, aujourd’hui, en mesure de s’étendre.
Néanmoins, tout orale qu’elle soit, la tamazight a été, depuis le Moyen Âge, transcrite par les Marocains au moyen de caractères arabes, mais les Kabyles l’écrivent aujourd’hui en caractères latins grâce aux nombreux francophones ou Français qui, les premiers, ont recueilli des narrations de la bouche de conteurs kabyles.
Cette tamazight sert de support à une très grande et très riche littérature orale tant en prose [Lacoste-Dujardin, 1970] – mythes antéislamiques, contes, légendes, histoires plaisantes – qu’en poésie (poésies amoureuses, chants de louanges, de travail, de fêtes, berceuses, etc.), que la très longue persistance locale de l’oralité a maintenues vivantes jusqu’à présent. Les Kabyles connaissent les œuvres de leurs grands poètes, tel Si Mohand-ou-Mhand, qu’aujourd’hui l’écrit ou les moyens audiovisuels sauvegardent et enrichissent de nouveautés : on assiste à un remarquable épanouissement créatif, par exemple dans l’humour (Fellag), la chanson, très en vogue parmi les jeunes (Sliman Azzem, Aït Manguellat, Ferhat, Lounès Matoub, Idir, etc.), dont le succès peut même être mondial, tel Idir, chanté jusqu’au Japon.
La culture kabyle, ces jeunes le savent, existe aussi par ses danses, sa musique qui a ses grands artistes, créateurs et interprètes, comme cheikh Hasnaoui. Elle s’exprime encore par maintes productions artistiques matérielles : dans le domaine du tissage, les tentures, tapis, fins tissus de laine et soie sont réputés, élaborés par les montagnardes sur des métiers de haute lisse. Il y a encore le travail du bois au décor géométrique spécifiquement berbère, plus rectiligne que curviligne, la poterie kabyle aux décors géométriques multiples dont s’inspire aujourd’hui une vaisselle commercialisée jusqu’à Alger. L’orfèvrerie, enfin, est célèbre par les bijoux kabyles très spécifiques, traditionnellement en argent, parfois de grande taille, supportant des émaux cloisonnés multicolores et ornés de cabochons de corail, et de ces pendeloques tintinnabulantes dont est inspirée la célèbre chanson d’Idir qui a connu un succès mondial : Vava i nuva. La valeur identitaire de ces bijoux est encore si actuelle qu’une toute récente « charte de village », concoctée par de jeunes intransigeants, prescrit aux femmes de s’en parer à l’exclusion des modernes bijoux en or importés, étrangers à l’art local, mais qu’arborent les femmes d’émigrés ou bien des jeunes femmes plus modernes.
Trois productions matérielles connues maintenant de tous les Maghrébins font la fierté des jeunes pour leur origine spécifiquement imazighen : un vêtement, le burnous ( abernus ), grande cape de laine à capuchon que tout homme se doit de porter pour afficher son « amazighité » et qui s’est depuis longtemps largement répandu à travers le Maghreb ; un instrument, la cuillère individuelle en bois, souvent gravée ( taghenjaout ), alors que les Arabes, même citadins, mangent couramment avec leurs doigts ; enfin un mets, le seksou , son véritable nom berbère, plus connu sous le nom de « couscous », apprécié non seulement dans le nord de l’Afrique, où il n’est nulle cérémonie ou fête sans ce plat au rôle sacralisé de communion entre tous les convives, et succès international aujourd’hui.
Les jeunes connaissent aussi l’architecture berbère, maisons plus ou moins
grandes ou greniers fortifiés, depuis les grands châteaux igherm ou tighermt du Sud marocain jusqu’aux greniers collectifs de la même région ou de l’Aurès, en passant par les anciennes maisons kabyles en pierres claires souvent taillées et aux toits de tuiles canal rondes (appelées « romaines », mais qui sont méditerranéennes). Certains grands édifices actuels, comme la grande mosquée Hassan-II de Casablanca –au minaret de section carrée et recouverte de tuiles rondes–, sont inspirés de cet art architectural amazigh qui s’est répandu jusqu’en Andalousie où les grandes dynasties arabo-berbères l’ont épanoui, et dont les Maghrébins, beaucoup de ceux qui se disent arabes mais qui sont en fait des Berbères arabisés, sont légitimement fiers.
L’appétit culturel des jeunes
Cette fierté d’une culture fort ancienne et riche, les jeunes gens de Kabylie en sont de plus en plus conscients. C’est ainsi que s’est développé dans la quasi-totalité des villages de la montagne kabyle un foisonnement d’associations « culturelles et scientifiques amazigh » qui, regroupant jeunes gens et jeunes filles, en dépit de l’ancienne ségrégation selon le sexe qu’ils savent démocratiquement dépasser, s’attachent à recueillir des trésors d’oralité encore vivants : contes, légendes, récits historiques, poèmes, comme des éléments de vocabulaire concernant les animaux ou les plantes, par exemple, dont les noms peuvent différer d’un village à l’autre. Ils se montrent ainsi fort avides de cette richesse culturelle et très soucieux de la sauvegarder tant que des anciens peuvent encore la transmettre, afin de la faire respecter, de la reconnaître et de la promouvoir avec l’aval de l’autorité de l’État au sein de l’ensemble algérien.
Leur richesse culturelle, dont ils sont conscients, inclut les autres apports qu’ils se sont appropriés. Ainsi tiennent-ils compte de la composante arabophone de l’Algérie, dont souvent d’ailleurs les représentants partagent leurs revendications de reconnaissance officielle des langues proprement algériennes, celles parlées en Algérie, tel le kabyle, et tel l’arabe algérien au lieu de cet arabe classique (du VIIe siècle, celui du Coran), ou cet arabe dit « moderne » (celui des journaux du Moyen-Orient), ou tel encore le français parlé par tant d’Algériens, en Algérie comme en émigration, et dont l’emploi se développe aujourd’hui en Kabylie grâce aux chaînes de radio et de télévision francophones. Ouverts, les jeunes Kabyles souhaitent voir reconnus et légitimés les enrichissements qu’ils ont reçus grâce à diverses composantes culturelles. Par exemple, n’est-ce pas un intéressant paradoxe qu’une production culturelle récente, spécifiquement kabyle, puise avec bonheur à plusieurs de ces cultures ? C’est d’un tel éclectisme qu’est riche l’aventure d’un récent et très beau film kabyle financé par des capitaux de l’immigration : La Colline oubliée , d’Abderrhamane Bouguermouh, tiré d’un roman que Mouloud Mammeri a écrit en français (1953). Cet auteur, d’une famille des Aït Yenni, est un des plus illustres représentants de cette élite intellectuelle kabyle formée par l’école française, et il a bénéficié d’une considérable audience parmi la jeunesse kabyle. Universitaire, chercheur et écrivain, il avait écrit son roman, qui se déroule dans un village kabyle à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en français ; mais, dans le film, les acteurs s’expriment en kabyle et, pour sa diffusion en France, les dialogues ont été sous-titrés en français. Ces allers et retours du français au kabyle n’ont nullement troublé le très grand succès obtenu par cette oeuvre en France comme en Algérie, et les jeunes Kabyles lui ont fait un écho enthousiaste.
Pourtant, ceux-ci ont pu avoir un moment l’espoir de la reconnaissance de
cette richesse culturelle par le gouvernement algérien lorsque, au printemps 1992, sous la présidence de Mohammed Boudiaf, son ministre de la Culture M. Belkaïd confiait son souci d’assumer le passé algérien en se réconciliant avec toutes ses racines, à savoir ses trois composantes culturelles conçues comme autant de richesses : arabe, berbère et aussi française, considérée comme un « butin de guerre », selon l’expression du grand écrivain algérien Kateb Yacine. Espoir vite déçu : on sait que le président Boudiaf devait mourir assassiné le 29 juin 1992, et son ministre de la Culture connut, peu après, le même sort tragique. Dix années
plus tard, alors qu’une nouvelle génération prend une conscience de plus en plus aiguë de cette réalité, nul doute que le pouvoir algérien actuel, en refusant de reconnaître et de célébrer ce patrimoine algérien, n’exaspère les revendications des jeunes Kabyles et leur sentiment de minorité au sein de la nation algérienne.
De maigres ressources agricoles, mais beaucoup d’arbres fruitiers
Mais une riche culture ne peut suffire à nourrir ses hommes et ses femmes, et pourtant elle est le propre d’une société active, non déshéritée. Or, comme beaucoup de montagnes méditerranéennes, la Kabylie, certes refuge sûr pour ses très nombreux habitants, ne leur fournit cependant que de maigres ressources agricoles. Sur des pentes excessives et un sol pauvre et raviné, l’agriculture, même au prix de dur travail, est peu productive, la céréaliculture est difficile, seulement possible sur les replats ou dans les fonds de vallée. Aussi, au temps des Turcs, les Kabyles descendaient souvent, en armes, cultiver leurs céréales sur les terres des
plaines bordières ou intérieures à la montagne : celle, au sud, de la large et longue vallée de l’oued Sahel-Soummam, celle, au centre, du bassin du Sebaou, entre la chaîne maritime et le massif Agawa, et aussi dans quelques bassins au pied nord du Djurdjura comme celui de Boghni –Dra el-Mizan. Mais, sur ces terres de plaine, les Kabyles entraient souvent en conflit avec les maîtres d’Alger, dont la cavalerie empruntait ces voies de pénétration pour s’emparer de la récolte à titre d’impôt et tenter de soumettre les montagnards. En outre, dans la plupart de ces plaines, les Turcs construisirent des bordj, « citadelles », et établirent alentour
des étrangers ou transfuges kabyles à leur solde. Les plaines étaient devenues, pour les Kabyles, le bled el-baroud , le « champ de bataille ». Plus tard, une grande partie de ces riches terres de plaine auraient pu être accaparées par la colonisation, mais beaucoup ont été rachetées par quelques Kabyles fortunés.
Descendre de la montagne pour cultiver la plaine a toujours été une entreprise risquée, au point que le laboureur descendu dans la plaine était comparé au lion. Par ailleurs, le Kabyle pouvait être d’autant plus valeureux en plaine qu’il savait sa famille en sécurité dans la montagne : « Celui qui a les siens dans la montagne [enfants mâles ou alliés] n’a rien à redouter dans la plaine », disait-on. La céréaliculture des plaines a donc toujours fait cruellement défaut à l’économie de la Grande Kabylie, réduite aux seules productions montagnardes. Dans de telles conditions, la montagne ne peut se suffire à elle-même, aujourd’hui encore moins qu’hier.
C’est pourquoi, de longue date, les Kabyles ont cherché, sur place ou ailleurs, mais dans d’autres activités que la céréaliculture, les revenus indispensables. Beaucoup de ceux qui habitent au-dessous de 800 m d’altitude pratiquent l’arboriculture, qui s’accommode des versants pentus, quitte à s’encorder pour planter les arbres : ils cultivent beaucoup de figuiers (80% de ceux de toute l’Algérie), des oliviers et d’autres arbres fruitiers (vignes, cerisiers, pommiers, poiriers, etc.) ; autrefois on vivait aussi de cueillette : les glands du chêne à glands doux ( abellud ) permettaient de compléter la trop rare farine ou semoule de blé ; la plupart des Kabyles font aussi un peu d’élevage (quelques vaches, chèvres et moutons) tandis que dans les villages les plus élevés, certains, en été, engraissent des boeufs dans les prairies de montagne.
D’actifs artisans et des commerçants voyageurs
Enfin, un très grand nombre de Kabyles se sont spécialisés dans un artisanat actif, au savoir-faire manufacturier très développé, productif de ces œuvres particulières à la culture tamazight (voire parfois pécifiquement kabyle) que l’on a décrites plus haut. Les savoir-faire masculins sont principalement l’industrie du bois productrice de plats, louches et cuillères spécifiquement berbères, la métallurgie en fer aux nombreux forgerons, l’armurerie d’armes blanches ou à feu souvent fort réputées, l’orfèvrerie aux célèbres bijoux kabyles à émaux cloisonnés multicolores et pendeloques si caractéristiques et de grande renommée. Quant aux
savoir-faire féminins, ils concernent le tissage de tentures et tapis renommés au décor toujours géométrique et très travaillé, encore recherchés, et la poterie, maintenant souvent remplacée par le plastique.
Du commerçant itinérant à l’émigré
Parallèlement, tant les artisans que les habitants des villages les plus élevés se sont depuis fort longtemps lancés dans des entreprises commerciales. Très nombreux sont en effet les Kabyles –les Igawawen surtout– à avoir exercé le métier de commerçant itinérant. Au début de l’occupation française, 50% des hommes du « cercle de Fort-National » ont déclaré mener cette activité. Autrefois, ils parcouraient tout le Maghreb, de Constantine à Alger et jusqu’à Tunis, puis ce fut même jusqu’en France, puisque les premiers y apparurent dès 1905, pour vendre des tapis fabriqués par leurs femmes. Les uns se déplaçaient à plusieurs, en convois ou caravanes, les autres, plus nombreux, allaient seuls, à mulet ou à pied, mais tous étaient armés. Parmi les plus aisés venaient les marchands de
bestiaux, tandis que d’autres allaient au loin négocier leurs œuvres, comme les sabres des Iflissen. Certains revendaient dans les campagnes divers tissus achetés en ville. Les plus nombreux étaient des hommes des villages les plus élevés, les fameux colporteurs kabyles ( iâttaren , « parfumeurs »), dont le seul sac à dos pesait parfois jusqu’à 50 à 60 kilos, empli de produits de parfumerie, divers savons et cosmétiques, drogues ou condiments de toutes sortes. Le commerce était profitable puisque cette pacotille pouvait, au terme d’une année de commerce, leur rapporter jusqu’à cinquante, voire cent fois leur mise de fonds.
Ainsi, loin d’être cantonnés à demeure dans leur montagne où ils laissaient
seuls, avec les plus jeunes et les plus vieux, leurs femmes et enfants à l’abri dans les villages perchés, les hommes de Kabylie ont de tout temps voyagé au-dehors : les uns furent commerçants, les plus nombreux itinérants, mais parfois fixes, lorsque, par exemple, ils installaient des épiceries dans les villes (comme beaucoup de montagnards méditerranéens, ils furent « l’épicier du coin » berbère –le Kabyle,
le Chleuh, le Mozabite– comme le Grec, le Libanais, etc.) ; d’autres se firent
ouvriers d’artisans citadins (entre autres dans la coutellerie) ; d’autres encore furent maçons (ne dit-on pas que la ville d’Alger a été construite par les Kabyles ?), voire employés de hammam –des bains dits « turcs » (comme les Aït Jennad à Oran) –ou soldats, ainsi des fameux Zouaouas au service des Turcs d’Alger ou de Tunis [12]. Après l’installation des colons dans la plaine de la Mitidja (près d’Alger), beaucoup de Kabyles ont d’abord émigré temporairement comme saisonniers ou plus durablement
comme journaliers, avant que, à partir de 1905, nombre d’entre eux soient
les premiers Algériens à franchir la Méditerranée pour émigrer en France en tant que travailleurs, où ils ont suivi les premiers colporteurs kabyles temporaires puisque, cette même année 1905, les Kabyles purent circuler librement hors d’Algérie.
L’importance de l’émigration, bien qu’elle soit aujourd’hui restreinte
Aujourd’hui, la Kabylie, par laquelle a commencé l’émigration algérienne en
France, vit encore essentiellement des revenus de cette émigration, au point qu’une grande partie des transactions financières et bancaires se font désormais principalement hors Algérie, entre des comptes bancaires en France. L’interdiction de l’émigration de travail individuelle, en 1975, et l’autorisation du seul « regroupement familial » qui a permis, autour de l’émigré de longue date, le rassemblement des familles déjà constituées, ont désormais privé de possibilité de départ, et des revenus attendus, la nouvelle génération de jeunes hommes, sans emploi sur place, sans ressources et réduits à une inaction dont ils rendent responsable le gouvernement algérien.
Car, autrefois comme il y a peu encore, par leurs fréquentes activités hors de Kabylie, les hommes kabyles ont toujours noué de nombreux contacts avec bien d’autres Algériens comme avec des étrangers, dans tout le pays, en Tunisie, en France et à travers le monde. Partout ils ont établi des réseaux de relations et de transmission d’informations, d’idées, d’échanges et de fermentation intellectuelle et politique. Mais il ne peut plus en être de même aujourd’hui, et les jeunes Kabyles se désespèrent de ne plus pouvoir trouver aucune source de revenus, ni sur place, ni ailleurs en Algérie, ni en émigration en France ou en des pays plus éloignés, partout où la diaspora kabyle est dispersée à travers le monde : en Nouvelle-Calédonie, où sont encore des descendants d’exilés au bagne après 1871, en Russie (ex-URSS) et en Allemagne (anciennement « de l’Est »), où sont allés des étudiants et des travailleurs, et jusqu’au Canada, aux États-Unis, en Europe du Nord, au Moyen-Orient, etc.
De petites villes manufacturières : des groupements de villages d’artisans
Autrefois, les Kabyles les plus riches étaient, incontestablement, les artisans et les commerçants. Ils habitaient de gros villages tassés qui, juchés dans la montagne, à bonne distance des plaines, pouvaient constituer une seule agglomération, réunissant des centres très proches et parfois aussi quelques hameaux. C’étaient de véritables petites villes manufacturières très peuplées ; certaines d’entre elles étaient alors appelées Tlata tuddar , les « trois villages », et offraient les caractéristiques d’un début de réel processus d’urbanisation. Ainsi en était-il, par exemple, au XIXe siècle, des Tlata tuddar des Aït Yenni (réunion des villages de Aït Larbaâ, Taourirt Mimoun et Aït Lahcène), qui rassemblaient près de deux cents ateliers et boutiques, d’orfèvres surtout, et aussi d’armuriers, et comptaient près de 5 000 habitants, au coeur du massif Agawa. Ainsi en a-t-il été aussi des Tlata tuddar des Iflissen Lebhar, où plus d’une centaine d’ateliers d’armuriers réunis constituaient un véritable arsenal de sabres ( les flissa ) en Kabylie maritime (Taourirt n’aït Zouaou, Ighil Boussouil et Issoukan). Construits en grosses et belles pierres taillées, entourés de murailles souvent formées par les murs extérieurs jointifs des maisons et fermés de portes, ces bourgs étaient de véritables forteresses ceintes de remparts, pourvues à l’intérieur de plusieurs places, de mosquées et de « maisons des hommes », tajmaât , garnies de bancs de pierres où se tenaient les assemblées villageoises (les jemaâ) , réunissant périodiquement les hommes. Les quartiers – tikharroubin ( takharrubt au singulier) – des grandes familles lignagères dominantes – imerkantiyen
(singulier : amerkanti ) –« riches » (surtout des commerçants) se distinguaient des quartiers plus indifférenciés (les iderman/adrum ) des autres villageois (idaâfen, « pauvres, chétifs »). Des corps spécialisés d’habitants au service de la communauté assuraient différentes tâches, d’entretien et de voirie, de garde nocturne ou diurne, et tous étaient réunis dans une même communauté de défense. C’étaient bien là de réels embryons de cités [13] [Lacoste-Dujardin, 1993].
La formation d’une élite ouvrière et intellectuelle
Or, au début de la colonisation, parmi ces montagnards les plus aisés, en voie de citadinisation et aux contacts fréquents avec d’autres régions d’Algérie, voire du Maghreb, et une vingtaine d’années seulement après l’achèvement de la conquête coloniale, le gouvernement français, passant outre à l’opposition de la plupart des Français d’Algérie et des instances administratives françaises en Algérie, a créé nombre d’écoles primaires dites « pour indigènes ». Pourquoi une telle politique de scolarisation fut-elle entreprise en Kabylie ?
Pour la comprendre, il faut remonter à 1847 lorsque, précédant la conquête de la Kabylie, Bugeaud avait lancé une sorte d’ethnopolitique kabyle à partir d’une représentation opposant « Berbères sédentaires » et « Arabes nomades » [Lacoste-Dujardin, 1984]. Il faut ajouter que les Kabyles avaient résisté longuement à l’armée française, sans pour autant se rallier à Abd el-Kader. Dès cette époque, alors que la Kabylie apparaissait conforme à l’image des autres montagnes méditerranéennes (Corse ou Provence, par exemple), les autorités coloniales estimèrent, en effet, que les Kabyles tout particulièrement étaient susceptibles d’être « assimilables », quoique bons musulmans. Pourtant, la confrérie dominante en Kabylie, la Rahmaniya, aura, dès 1871 et jusqu’à la guerre d’indépendance, joué un rôle important dans l’opposition à la colonisation. Plus tard, cette image du
« bon Kabyle » devait être largement utilisée en maintes occasions, et à plusieurs fins, souvent conjointes : en premier lieu afin de « diviser pour régner », divide ut imperes, et en même temps afin de compromettre les Kabyles pour affinités profrançaises. Cette représentation a la vie dure puisque certains –dont les islamistes- accusent aujourd’hui encore les Kabyles d’être « du parti de la France » !
Des instituteurs français aux maîtres kabyles
Toujours est-il que, seize années à peine après la conquête de la Kabylie,
lorsque des instructions ministérielles de Paris, appliquant la politique promue en France par Jules Ferry, créèrent des « écoles pour indigènes » en Algérie, elles furent installées d’abord en Kabylie, dans des bourgades à forte population agglomérée. L’on devait ainsi apprendre à lire et écrire en français à des enfants d’artisans et de commerçants, censés devoir être plus réceptifs à l’instruction que les fils de paysans. C’était d’autant plus facile que les écoles laïques françaises n’entraient guère en concurrence avec les écoles coraniques, qui en Kabylie étaient surtout fréquentées par les enfants de lignages religieux, dans leurs propres villages ou quartiers. On s’intéressa donc, entre autres, à recruter tout particulièrement dans
ces écoles des « fils de forgerons ou d’armuriers » que certains souhaitaient
pouvoir envoyer ensuite « dans nos écoles manufacturières d’Angers ou de
Châlons » [Aucapitaine, 1864, p. 35].
En fait de « politique berbère » en matière de scolarisation, il est à penser que la perspective de préparer de bons ouvriers francophones pour les industries françaises n’a pas été étrangère à ces choix. Bref, c’est bien dans des petites villes ou gros villages d’artisans et de commerçants, de Kabylie ou à proximité, qu’ont été implantées les toutes premières « écoles indigènes » d’Algérie, dès 1873 à Tamazirt, près de Larbaâ n’aït Iraten (Fort-National), et en 1881 aux Aït Yenni ; en 1889, on comptait trente-sept écoles en Kabylie, la moitié de toutes celles créées en Algérie.
Par la suite, à partir de 1905, lorsque l’autorisation de voyager sans permis
spécial fut accordée aux Kabyles, ceux qui étaient instruits ont pris en nombre le chemin de la France, d’abord de ses mines et de ses usines (Courrières, Clermont-Ferrand, les fonderies de l’Est ou les usines de métallurgie et de mécanique), d’autant que la crise de surproduction de vin à la fin du XIXe siècle dans la société coloniale réduisit les possibilités d’emploi des Kabyles dans la Mitidja. Le mouvement d’émigration s’accéléra et se diversifia pendant et après la guerre de 1914-1918, les Kabyles remplaçant les Français mobilisés. En 1949, les émigrants de la « commune mixte » du Djurdjura atteignaient le nombre de 10 000, soit, par rapport à la population masculine, une proportion de 51% : un homme sur deux [INED, 1955, p. 50]. Le mouvement prit une telle ampleur que les Kabyles étaient encore largement majoritaires dans l’immigration algérienne en France (les trois quarts).
Les écoles les plus anciennement créées (Aït Yenni par exemple) ne furent pas fréquentées par les plus démunis, mais par les familles assez aisés, voire les grandes familles dominantes –y compris des lignages religieux ou maraboutiques–, qui ont saisi l’intérêt d’instruire, en français, leurs garçons, ayant vite compris que cette scolarisation permettait la réalisation de leur ambition de participer au monde moderne. Ce furent donc les familles influentes qui, les premières, acceptèrent l’école, que l’administration ne créait qu’en l’absence de toute opposition. Il n’y
avait pas non plus en Kabylie de colons pour s’opposer à l’école des petits
Kabyles, la colonisation ayant presque complètement échoué dans les plaines, où il était risqué de s’installer à proximité d’une montagne trop prompte à l’insurrection –comme en 1871. Ce sont donc ces jeunes Kabyles, premiers instruits, bientôt suivis par d’autres, qui, peu après, ont constitué une élite ouvrière et intellectuelle algérienne et ont accédé à des emplois dans l’administration, l’enseignement, les professions libérales en Algérie.
L’entreprise de scolarisation en Kabylie eut d’autant plus de succès qu’elle avait été confiée aux plus brillants instituteurs frais émoulus de l’École normale d’instituteurs et sélectionnés au mérite, militants convaincus d’un « enseignement francoarabe ». Ces pionniers, souvent sympathisants des théories saint-simoniennes, exerçaient un véritable « apostolat scolaire » [Rambaud, 1891], laïc et républicain, tout en se montrant fort respectueux de la culture et de la religion de leurs élèves. Ils ne se bornèrent pas à leur apprendre le français, à leur dispenser un savoir, ils s’attachèrent aussi à ouvrir leur esprit.
Les conséquences de l’école de la République
Rien d’étonnant à ce que ce type d’enseignement se soit heurté à l’hostilité
d’une partie des « Français d’Algérie » –ceux qu’on appelait alors les « colonistes »–, qui le jugeaient trop « révolutionnaire ». Car ses conséquences furent, en effet, conformes à ce qu’ils redoutaient : ces « indigènes » acquirent une conscience politique des inégalités, tant dans l’ensemble algérien que dans les rapports coloniaux, voire dans les grands courants de pensée politique internationaux, et développèrent leurs propres mouvements revendicatifs et politiques, qui plus tard les mèneront jusqu’à prendre la part déterminante que l’on connaît dans la guerre de libération nationale.
Rien d’étonnant non plus à ce que, par la suite, dans le terreau propice de cette élite ouvrière et intellectuelle émigrée, les mouvements d’indépendance aient pris racine et se soient développés. L’Étoile nord-africaine (ENA), née dans le 14e arrondissement de Paris en 1926, dissoute en 1934 et clandestine par la suite, a été le premier mouvement algérien anticolonialiste prônant la résistance à la France et réclamant l’indépendance de l’Algérie. En 1936, son comité directeur comprenait 70% de Kabyles [Lacoste-Dujardin, 1999], proportion qui correspondait
à celle des Kabyles dans l’émigration en France.
Une fois adultes, certains de ces brillants élèves poursuivirent leurs études à l’École normale d’instituteurs de la Bouzaréa, sur les hauteurs d’Alger
[14]. Parmi ceux qui devinrent à leur tour instituteurs, la plupart revinrent en Kabylie poursuivre la tâche émancipatrice commencée par les instituteurs français. Certains d’entre eux organisèrent les premiers foyers de contestation politique dans les villages.
Ainsi, une génération suivant l’autre, s’est constituée une élite intellectuelle qui a compté de nombreux professeurs, médecins, chercheurs, pionniers en études berbères, écrivains ou romanciers d’expression française tels que Si Saïd Boulifa, Mouloud Feraoun, Malek Ouary, Mouloud Mammeri, et maints autres encore dont Jean Amrouche, pour ne citer que ceux-là. C’est que l’idéologie égalitaire des instituteurs français, militants de l’« école laïque et républicaine », ne pouvait que rencontrer un écho sensible parmi leurs élèves grandis dans une culture qui partageait en grande partie ces mêmes valeurs.
Une idéologie égalitariste toujours vivante
Le terreau était en effet fort propice, car la fierté d’être kabyle, c’est aussi
l’attachement à des formes d’institutions qui se veulent égalitaristes, que ce soient des structures sociales, à plusieurs niveaux, et tant anciennes que modernes, ou des cérémonies et rites collectifs, ou encore des représentations héritées de la tradition culturelle orale, et même jusqu’à un islam populaire.
Des structures sociales anciennes : lâarch, « tribu »,
et jemaâ, « assemblée villageoise »
Très anciennes et de type communautaire, les structures sociales et politiques, autrefois adaptées à des contraintes géographiques, économiques et historiques, ont perduré et inspirent encore les mouvements démocratiques d’aujourd’hui. Elles comportent plusieurs niveaux, dont lâarch , la « tribu », et jemaâ , l’« assemblée villageoise ».
On a décrit ci-dessus le relief du massif Agawa, découpé par de profondes
vallées qui séparent des croupes surmontées de collines. À chacune de ces unités de relief correspondent plus ou moins précisément, chez les Igawawen comme ailleurs, sur les versants mêmes du Djurdjura ou en Kabylie maritime, des ensembles de communautés de plusieurs villages établis sur les croupes, éperons, voire replats ou flancs de coteau, dont les membres se disent descendants d’un ancêtre prétendument commun (et toujours d’homme en homme, à l’exclusion des femmes). Chacun de ces groupements tribaux était appelé lâarch , « tribu », dont tous les membres portent collectivement le nom : les « Untel », Aït ou At , « fils d’Untel » ( Beni en arabe). Par exemple : Iflissen, Iouadiyen, At Iraten, At Âïssi, At Yenni... Autrefois –et encore aujourd’hui dans bien des cas–, les relations sociales, internes ou externes à la tribu, étaient le plus souvent représentées, voire organisées, sur le modèle de la parenté masculine, réelle ou fictive, les hommes se disant ainsi, entre eux, « frères ». En certaines –mais rares– circonstances, les
leârach , « tribus », pouvaient réunir les représentants des assemblées des villages constitutifs (voire se regrouper en « confédération », qabila ), mais c’était toujours de façon exceptionnelle et éphémère.
C’est pourtant ce type de groupements qui sont parfois réalisés aujourd’hui par les mouvements en voie d’organisation en adoptant des formes nouvelles de « coordination », sur des principes démocratiques inspirés de la tradition, mais dans des unités de groupement plus vastes, moins fractionnées que les villages et leurs assemblées. Il semblerait que ces nouvelles leârach se soient multipliées (sous la désignation arabisée de ourouch ) dans maintes régions de Kabylie ou de ses marches peuplées de Kabyles. Les formes de groupement peuvent différer,
s’adapter à de nouvelles réalités, mais les principes de démocratie représentative sont clairement affirmés, inspirés de la tradition.
Dans les petites villes de Kabylie, que les quartiers soient réellement lignagers et endogames ou qu’ils rassemblent des familles non apparentées, chacun d’entre eux se désignait le plus souvent sous le nom collectif d’un ascendant fictif. À leurs instances familiales revenait le règlement des affaires de droit privé. Désormais, il n’en est plus de même –du moins officiellement– puisque l’État gère les personnes individuellement. Pourtant, l’idéologie de la parenté, corollaire d’une
fraternité égalitariste, demeure la référence principale, prête à resurgir pour justifier telle ou telle forme de solidarité ou de gestion d’ordre privé.
Une structure de base :
la jemaâ villageoise, assemblée des hommes du village
C’est ainsi que subsiste non seulement un fort sentiment de solidarité communautaire, mais encore son expression concrète et politique, et non pas au sein des grandes unités tribales (les leârach ) sans instance de concertation régulière, mais au niveau de chaque village, dans la seule instance politique qui ait encore une réalité : l’« assemblée des hommes du village » traditionnelle, la jemaâ , toujours vivante, plus ou moins officiellement. Constituée par la réunion périodique des représentants de chaque famille ou de chaque quartier constitutif du village, cette institution villageoise siège dans une construction particulière, la tajmaât , ou « maison des hommes », qui impose sa présence quasi sacrée au sein du village ; elle gère la plupart des affaires de la communauté villageoise composée de tous ses habitants. Mais si la structure de la jemaâ demeure, ses hommes ont changé.
Autrefois, les assemblées villageoises offraient surtout de la démocratie son image fraternelle et égalitariste, certes souvent affirmée, mais la réalité était plus complexe. Car les représentants des grandes familles qui y siégeaient étaient le plus souvent les chefs de famille, les plus âgés, les imgharen, « grands » ou « têtes du village » ( iqurray n taddart ), les patriarches, qui formaient en fait une gérontocratie. Aux réunions de l’assemblée des hommes, pourtant, toutes les familles du village avaient, en principe, accès à la parole, puisque le poids politique de chacun de leurs délégués était, dans cette société orale, fonction de sa seule aptitude à l’art d’une parole à laquelle tous avaient droit, permettant ainsi au meilleur orateur d’emporter la décision par sa seule force de conviction. En réalité, les patriarches des grandes familles avaient davantage de chance de se faire entendre que les autres, puisqu’ils étaient des imusnawen , « savants en science du discours », d’autant que l’adoption de toute décision exigeait l’unanimité des participants.
Ainsi, par consensus, chaque assemblée débattait et résolvait les affaires administratives, juridiques et politiques de chaque village. En l’absence de fixation par l’écrit, cette oralité avait par ailleurs le considérable avantage de permettre une grande souplesse d’adaptation des réglementations. Ainsi en maintes occasions, des changements circonstanciels pouvaient conduire les assemblées à débattre des modifications nécessaires et à adapter le droit à ces nouvelles données.
Les nouvelles jemaâs :
des patriarches d’autrefois aux jeunes d’aujourd’hui
Donc, parmi les institutions politiques, seules, autrefois, les assemblées villageoises se réunissaient régulièrement dans chaque village ou ville (parfois quartier dans les agglomérations). Or, dans l’actuelle structure et nomenclature administrative nationale algérienne, les APC, assemblées populaires communales (créées en 1962), ont été définies en Kabylie à l’échelle des groupement tribaux, si bien que, grosso modo , et en dépit de quelques réaménagements dans les délimitations, ces nouvelles « communes » réunissent entre elles les mêmes villages que les anciens l eârach . Ces APC (dont le secrétaire est nommé par l’État) sont
aujourd’hui composées de représentants élus par l’ensemble de la population de la « commune » dans les différents villages qui la composent ; ils appartiennent souvent aux mêmes familles autrefois influentes à l’assemblée de chaque village.
Or les assemblées villageoises perdurent toujours, tolérées par l’État algérien, qui en fait préfère sans doute concéder cette forme ancienne et traditionnelle de concertation politique où s’exprime une très forte solidarité, structurée sur le modèle idéologique dominant de la parenté, plutôt que de voir se développer de modernes partis dépassant largement le cadre local, voire à prétentions nationales. Cependant, si tous les villageois sont toujours représentés à l’assemblée du village (quoique encore à l’exclusion des femmes), la composition de ces nouvelles jemaâs a changé.
En effet, tout d’abord, au temps de l’émigration de travail, celle des hommes seuls, les patriarches y furent secondés, voire relayés, par les ex-émigrés de retour après plusieurs années en France ; souvent instruits, ceux-ci étaient alors des personnages écoutés du fait de leur expérience, d’autant plus s’ils faisaient partie de « bonnes familles », ce qui était souvent le cas. Mais aujourd’hui que l’émigration « de travail », d’hommes seuls, est pratiquement tarie (ou du moins beaucoup plus rare), alors que la plupart des émigrés restent désormais en France avec leur famille et qu’il y a de plus en plus de jeunes au village, les nouvelles générations prennent
le relais de la gestion des affaires locales, quitte à demander parfois conseil aux anciens, associés comme consultants aux nouvelles assemblées villageoises.
Depuis des années, en effet, les villages ont perdu beaucoup de leurs hommes : nombre de familles ont émigré, qui en ville, à Alger tout proche -dont 60% des habitants sont d’origine kabyle– ou ailleurs en Algérie, qui en France ; la guerre d’indépendance a fait aussi beaucoup de morts parmi les hommes alors adultes, causé de graves désagrégations familiales et entraîné nombre d’émigrations intérieures ou extérieures à l’Algérie. À présent, s’il ne reste plus guère que quelques vieux et retraités de France aux villages, il y a en revanche, et de plus en plus nombreux, des jeunes adultes, beaucoup de jeunes, car le gouvernement algérien, par attachement à l’ancienne idéologie de la fécondité, a attendu très longtemps avant d’adopter une politique démographique fondée sur l’espacement des naissances [15]
En 2001, 57% de la population algérienne a moins de vingt-cinq ans.
Dans les nouvelles assemblées villageoises s’exprime aujourd’hui majoritairement cette nouvelle génération, qui, grâce à la scolarisation –même si elle est parfois défaillante– et surtout grâce aux modernes moyens de communication, a acquis une conscience politique aiguisée au niveau national et international, si bien que, à l’écoute des partis nationaux, elle exprime des revendications plus que jamais démocratiques et en opposition avec le gouvernement actuel.
Un rite égalitariste : la timechret
Une autre institution kabyle, révélatrice d’une idéologie égalitariste, est un rite au cours duquel est affiché un très sourcilleux souci de l’égalité, rite encore pratiqué dans les villages, même si sa fréquence est moindre qu’auparavant. Il s’agit d’un sacrifice et partage de viande que l’on appelle timechret (ou ouziaâ ). Une ou plusieurs fois dans l’année en effet, autrefois d’abord pour inaugurer l’année agricole et les labours d’automne, ou pour faire tomber la pluie attendue, ou, plus récemment, pour fêter le retour d’un émigré, ou encore en toute autre occasion offerte par un villageois, et entérinée par la jemaâ , les habitants d’un même village partageaient la viande de boeufs ou moutons alors sacrifiés, en un lieu public, souvent à proximité de la tajmaât , la « maison des hommes ». En réalité, la quantité de viande emportée par chaque maître de maison –comptée en parts– variait dans de notables proportions selon l’importance de la contribution qu’il s’était engagé à donner à la caisse collective et durant toute l’année en chacune de ces mêmes occasions (en principe selon le nombre de personnes à son foyer) ou grâce à l’acquisition, au terme d’une enchère, de la prestigieuse dépouille. Dans le passé, la décision du nombre de parts que chaque homme s’engageait à prendre –avec éventuellement contribution– réinstitutionnalisait ainsi, annuellement, la hiérarchie du village [Lacoste-Dujardin, 1976b].
Quoi qu’il en soit, ce qu’en voulaient voir –et donner à voir– les participants
à cette cérémonie, comme l’image qu’en retiennent toujours les Kabyles aujourd’hui, est celle d’un parfait modèle égalitariste. Pour eux, ce partage de viande est la réalisation, à la fois réelle et de grande valeur symbolique, d’une distribution solidaire entre tous les villageois. Dans la pratique apparente, en effet, en recomptant et comparant à tout instant la grosseur des morceaux de viande, ces hommes veillent tous scrupuleusement à une répartition strictement égale, soucieux du nombre et de la taille rigoureusement identiques de morceaux des différentes parties des bêtes –gras, os, chairs, abats, etc. Et chacun de dire sa satisfaction et sa fierté de voir ainsi le village unanime célébrer ce partage équitable entre tous les
villageois et, ajoutent-ils, offrir ainsi aux plus démunis l’occasion de consommer un peu de viande [16]
En effet, la participation de chacun est obligatoire, faute de quoi le fautif est exclu de l’assemblée, sauf, ce qu’il ne manque pas de faire, s’il
emprunte pour l’occasion aux plus aisés [Lacoste-Dujardin, 1992].
En dépit de l’inégalité plus ou moins masquée, c’est bien l’exercice d’une forme de démocratie qui est donné à voir, tout comme il est aussi donné à voir dans le fonctionnement de la jemaâ . Aujourd’hui, l’unanimité requise à l’assemblée, qui fait peu de cas d’une minorité d’opposition et, somme toute, peu démocratique, ne serait, semble-t-il, plus exigée dans les débats de la nouvelle assemblée, la nouvelle jemaâ .
Égalitarisme dans la tradition orale
Il est encore une autre expression des sentiments, sinon démocratiques, du
moins très égalitaristes des Kabyles, elle se découvre dans le discours social
commun kabyle qui assure la transmission idéologique par le moyen de sa littérature
orale : c’est un discours que la société se tient à elle-même, destiné à inculquer
à tous l’idéologie commune. Souvent dans les contes apparaît en effet, imposée
par la collectivité villageoise, une limitation à l’enrichissement individuel de l’un
de ses membres. Ce peut être le cas, par exemple, d’un commerçant qui atteint la
richesse. Dans les récits, l’autorité villageoise intervient pour contraindre le
malheureux amerkanti à en rester là, en ne tirant nul plus ample profit de la
richesse acquise. C’est ainsi que l’enrichi en est réduit à thésauriser stérilement,
condamné à accumuler ses biens dans plusieurs pièces ou maisons de façon totalement
improductive, ne pouvant guère accroître que son seul prestige [17]
L’égalitarisme villageois kabyle montré à travers la littérature orale révèle en
chaque occasion une véritable hantise de l’accaparement d’un pouvoir personnel
contre lequel il semble bien que la lutte des communautés villageoises ait été
constante. Par ailleurs, les héros les plus célébrés dans les contes villageois sont
avant tout de vigilants restaurateurs de son ordre communautaire, fraternel et
égalitaire [Lacoste-Dujardin, 1970].
Cet attachement des Kabyles au partage fraternel et à la concertation, ce
constant souci d’égalité et, surtout, ces principes démocratiques permettent peutêtre
de rendre compte d’une autre particularité kabyle : l’absence relative, sinon la
rareté des islamistes en région kabyle, surtout en Grande Kabylie, car l’islam
kabyle est aussi démocratique.
Une autre spécificité kabyle : un islam peut-être trop patriotique pour être islamiste ?
En Kabylie, en effet, les islamistes, qu’il s’agisse du FIS (Front islamique du
salut) ou des GIA (Groupes islamistes armés), ou encore aujourd’hui des GSPC
(Groupes salafistes pour la prédication et le combat), n’ont guère recruté de partisans. On leur connaît cependant quelques refuges dans certains massifs isolés et
peu peuplés (près de la côte et surtout dans les Petites Kabylies). Ils ont aussi une
influence dans certains secteurs de plaine dont les habitants furent autrefois à la
solde des Turcs, et où il y eut aussi, au début du XXe siècle, comme en d’autres
régions de l’Algérie, des foyers d’un mouvement de renouveau islamique (le réformisme,
avec ses savants, les « oulémas »). Or, si la faiblesse des islamistes est une
spécificité kabyle, c’est que, dans cette région, l’islam a revêtu une forme particulière : l’islam kabyle est maraboutique, confrérique, populaire et modéré.
Les religieux musulmans, les imrabden , « marabouts », sont ainsi nommés
parce qu’ils se disent venus d’un ribat , « forteresse et monastère », aux frontières
du monde musulman ; en l’occurrence, pour les marabouts installés en Kabylie, de
la Seguiet el-Hamra, dans le sud marocain. Installés en Kabylie à dater du
XVIe siècle, ils se prétendent arabes sinon même descendants du Prophète ( chorfa , au singulier chérif ). [18]
En Kabylie, les marabouts constituent une sorte d’aristocratie
religieuse. Établis dans tous les groupements tribaux, ils habitent des
villages ou des quartiers de villages propres et ne se marient qu’entre eux. Ils
enseignent le Coran, sacralisent les cérémonies et les rites, et jouent souvent un
rôle médiateur dans les conflits. S’il s’en trouve qui abusent de leur autorité pour
faire payer cher leur protection et se sont compromis avec l’autorité coloniale,
certains autres jouissent d’une grande réputation de sagesse et de sainteté ; c’est
souvent le cas de ceux qui appartiennent à la confrérie de la Rahmaniya.
Cette confrérie (ou ordre religieux) est tout particulièrement influente et dominante
en Kabylie, où ses principes égalitaires et démocratiques ont fait son succès
[Rinn, 1891, p. 199]. Car l’islam prôné et pratiqué par la Rahmaniya accepte et
intègre le sacré traditionnel kabyle, son culte des saints locaux ; il adopte une
expression fréquente en kabyle (chants, prières) et accueille les femmes parmi ses
affiliés. Surtout, la Rahmaniya a toujours prôné et pratiqué un islam patriotique
qui, dès la conquête coloniale, a su prendre des engagements très nationalistes :
après que le fondateur de la confrérie (au XVIIIe siècle), Sidi Abderhamane bou Qobrin, se fut installé aux Aït Smaïl en Kabylie où sont encore sa zaouïa (« monastère et école ») et l’un de ses deux tombeaux [19]
l’un de ses successeurs
appela à résister à la conquête en 1857 et fut exilé. Peu après, son remplaçant, un ouvrier du fer d’origine laïque, [20] le cheikh Aheddad, a été en Kabylie le principal
instigateur de la grande insurrection de 1871 contre l’occupation française. Plus récemment encore, nombre de religieux de la confrérie, comme cheikh Tahar de
Timliline, ont payé de leur vie leur sympathie pour les partisans de l’indépendance
pendant la guerre de libération nationale [Lacoste-Dujardin, 1997, p. 80-81
et 229-230]. Les islamistes reprochent cette forme particulière d’islam aux
Kabyles en rejetant le maraboutisme, qui n’existait pas dans l’islam des origines.
Ils leur reprochent pareillement d’être trop francophones (conséquence de la scolarisation
et de l’émigration), en les accusant d’être « du parti de la France », bien
injustement pour eux qui ont toujours donné tant de preuves de leur patriotisme.
Quoi qu’il en soit, l’islam pratiqué par les Kabyles est, en accord avec leur
idéologie égalitariste, aux antipodes du fondamentalisme universaliste et fascisant
des intégristes musulmans, ce qui explique son absence parmi eux. Les jeunes
Kabyles se reconnaissent plus volontiers dans l’islam patriotique et démocratique
de leurs pères, même si, aujourd’hui, leur ardeur religieuse est parfois attiédie et
si leurs soucis sont devenus essentiellement politiques.
Les jeunes d’aujourd’hui, informés et exaspérés
Le souci de la démocratie a été toujours si constant qu’il est partagé par tous
et trouve même un regain de vigueur parmi les jeunes d’aujourd’hui, désespérant
de leurs mauvaises conditions de vie, dont ils rendent responsable le gouvernement
algérien, avides de jours meilleurs pour lesquels ils sont résolus à lutter.
Des jeunes, exaspérés par la hogra, le « mépris »
Car, depuis un certain temps déjà, les jeunes ont pris presque partout le relais
des anciens. Or les nouvelles générations, élevées dans l’idéologie égalitariste
kabyle, et bien au fait de la vie politique contemporaine, critiquent le gouvernement
actuel et souhaitent, pour l’Algérie, davantage de démocratie qu’ils tentent
déjà, eux-mêmes, de mettre en oeuvre à l’échelle locale. La jeunesse d’aujourd’hui
sait occuper son oisiveté forcée. Dans les « associations culturelles et scientifiques
» qu’ils animent aux villages comme en ville, les jeunes gens travaillent
en compagnie des jeunes filles : considérable innovation démocratique dans une
société encore patriarcale ; quelques femmes seront-elles bientôt admises à participer
aux réunions des assemblées de village ? [21] Car ce sont en effet ces jeunes hommes adultes qui, à présent, redynamisent ces assemblées, eux qui ont été instruits certes par l’expérience des anciens, émigrés ou non, par la scolarisation
–même défaillante–, mais aussi par les relations maintenues fort actives avec les
émigrés, et plus encore désormais par les moyens modernes de communication.
Ce sont les médias, les journaux, la radio, avec par exemple Beur FM, aux trois
cent mille auditeurs en France et fort écoutée en Algérie, les chaînes de télévision
françaises ; ce sont aussi des chaînes spécialisées comme la BRTV (Berbère Radio
Télé Vision), la chaîne berbère qui, relayée par satellite, émet depuis Paris et qui,
selon le Haut Conseil de la francophonie, compte quatre millions de téléspectateurs.
Les jeunes y trouvent de précieuses sources d’information, des soutiens et
des liens de communication entre berbérophones à travers le monde, parmi la
nombreuse diaspora kabyle, des lieux aussi d’expression politique. Les communications
aujourd’hui dépassent les frontières, se mondialisent, grâce à la navigation
sur Internet – par les satellites Arabsat et Europe on line –, dans les 787 cybercafés
que compte actuellement l’Algérie – dont 347 à Alger –, ouverts jour et nuit. On
y échange du courrier électronique, on y a son adresse, on s’informe, et surtout on
débat dans des forums de discussion qui occupent à 90% l’activité des cybercafés
; le succès est tel que le réseau est fréquemment engorgé et que, souvent, on
se connecte directement sur le réseau français [22].
Les jeunes Algériens font ainsi partager leur mécontentement contre leurs
considérables difficultés d’accès au travail, l’accaparement par quelques privilégiés,
à la faveur de la privatisation, du commerce extérieur autrefois monopole
d’État, comme la confiscation de la rente pétrolière non redistribuée, l’absence de
démocratie dans l’État, l’excès de pouvoir des généraux. Toutes ces revendications
sont contenues dans leur dénonciation de la hogra (terme arabe emprunté par les
Kabyles), [23] qui signifie « mépris » et aussi « désintérêt et injustice », dans laquelle, estiment-ils, les tiennent les hommes au pouvoir, les privant de possibilités d’accès à une ascension sociale à laquelle ils aspirent.
Curieusement, les gouvernants de l’Algérie se trouvent accusés par ce même
terme de « mépris » de la même attitude autrefois reprochée au pouvoir colonial.
C’est ce même terme que, dans la fraîcheur de son arrivée en Algérie en 1955 et
son ambition d’un nouveau « plan d’action », l’ethnologue et gouverneur général
Jacques Soustelle dénonçait, en prônant d’y remédier par une « politique des
égards et de la confiance » [Lacoste-Dujardin, 1997, p. 260]. Était-ce alors par
innocence, inconscience ou bien aveuglement, après cent vingt-cinq ans de colonisation
et de pratique de ce même « mépris » ? Or, à ce « mépris » on sait quelle
fut la réponse, puisque la guerre d’indépendance, alors déjà commencée depuis un
an, devait durer encore sept années pour s’achever par la victoire des « méprisés » !
Gageons que l’effervescence qui se développe aujourd’hui en Algérie parmi les
victimes de cette hogra -ci ne retombera pas, elle non plus, de sitôt !
Des jeunes excédés par la violence généralisée
Car, en dépit de tous ces freins, la jeunesse bouillonne d’idées et piaffe, exaspérée,
révoltée, plus que jamais rebelle à un pouvoir qui se discrédite par ses exactions.
Beaucoup de ces jeunes sont de plus en plus en colère. Ils ne veulent plus
accepter toute cette violence dans une Algérie où elle est partout présente.
Si les islamistes ont été assez peu actifs en Grande Kabylie même, à quelques
exceptions près, il y a, ailleurs, la violence terroriste exercée depuis des années.
Il y a eu celle du FIS (Front islamique armé), mais son bras armé, l’AIS – dont
six mille membres ont été amnistiés par la politique de « concorde civile » du
président Bouteflika –, a déposé les armes en 1997. Il y a celle des GIA (Groupes
islamiques armés), autour d’Antar Zouabri, surtout actif dans l’ouest du pays (où
cent soixante villageois ont été massacrés en juillet 2001) et jusqu’aux environs
d’Alger, ou, récemment encore, le GSPC (Groupe salafiste [24] pour la prédication
et le combat) de Hassan Hattab, dans l’est algérien et jusque, sur la côte, à l’ouest
de Béjaïa. Cet été 2001, deux cents personnes auraient été assassinées par des
« groupes armés » dans l’Ouest algérien, et depuis le début de l’année 2001. On en
compte plus de mille deux cents dans toute l’Algérie. Des villageois ou habitants
de hameaux isolés fuient la campagne pour se réfugier dans des bidonvilles à
proximité des villes, où ils seraient près d’un million. Les extrémistes islamistes
peuvent, certes, recruter parmi la jeunesse algérienne en quête d’engagement, mais
il ne semble guère y avoir parmi eux de jeunes Kabyles qui ont d’autres modes
d’action et d’autres perspectives. Ce 4 septembre dernier, des attentats ont
été commis aux environs de la capitale, dont on craint qu’ils n’inaugurent un
nouveau cycle. Les Algérois ont peur, surtout à l’approche du mois de ramadan,
en novembre [25].
Il y a la violence exercée par la police, aux ordres du gouvernement, qui
réprime durement les manifestations de jeunes, les rouent de coups et vont même
jusqu’aux lynchages, par exemple lors de la marche pacifique du 14 juin à Alger,
et auxquels s’ajouteraient sept morts (source américaine).
Il y a, en Kabylie tout particulièrement, la violence des gendarmes, qui sont la
cause première du soulèvement, gendarmes qui, intentionnellement originaires
d’autres régions que celles où ils sont affectés, sont par peur fermés au dialogue
avec les populations et prompts à saisir leurs armes. S’y ajoute le fait qu’en
Kabylie, lors des dernières manifestations, les gendarmes n’ont pas reçu de leur
autorité (en remontant jusqu’à quel niveau hiérarchique ?) l’interdiction de tirer à
balles réelles. « Tirs à balles réelles, saccages, pillages, provocations de toutes
sortes, propos obscènes et passages à tabac sont autant d’exactions dont les
gendarmes ont pris l’habitude », cite, le 3 juillet 2001, le rapport de la commission
nationale sur les événements de Kabylie chargée par le président Bouteflika
d’enquêter sur les troubles du printemps en Kabylie et présidée par Mohand Issad,
un juriste kabyle réputé pour son intégrité. Le bilan établi par la même commission
est lourd de victimes : du côté des manifestants, on compte 49 morts par
balles (31 à Tizi-Ouzou, 16 à Béjaïa, 1 à Sétif, 1 à Bouïra) et 900 blessés dont
218 par balles. Du côté des forces de l’ordre : 1 gendarme tué par électrocution,
416 policiers et 181 gendarmes blessés. Et le rapport de conclure : « Les causes
profondes [sont] sociales, économiques, politiques, identitaires et dues aux abus
de toutes sortes. »
Toute cette violence est celle d’une guerre civile qui n’en finit pas de durer, où
les Algériens sont pris en tenaille entre les attentats terroristes attribués aux islamistes
et les répressions des manifestations.
Il y a aussi toutes les violences endémiques, latentes, durables, épuisantes,
celles liés au cntexte général dans lequel vit la société algérienne.
C’est la violence du pouvoir, qui fraude les résultats des élections (fraudes
dûment constatées), pouvoir incapable de remédier à la corruption quasi généralisée,
à la misère sociale qui affecte tant de monde, à la marginalisation de la
jeunesse, au chômage qui touche 30% de la population active (encore ne compte-t-on pas les femmes).
C’est la violence faite aux femmes, maintenues en position d’éternelles
mineures par un Code de la famille rétrograde quoique le plus récent des trois pays
du Maghreb (en 1984), toujours en attente d’un statut plus égalitaire. Elles sont
aussi et trop souvent victimes d’attaques, parfois criminelles, comme à Tébessa,
à Bordj Bou Arreridj ou ailleurs. Elles sont souvent victimes d’exactions, comme,
en ce début du mois de juillet 2001, ces femmes de l’Ouest algérien, émigrées de
l’intérieur dans le Sud, à Hassi Messaoud, qui ont été battues à mort, violées,
enterrées vivantes, massacrées, parce qu’elles étaient venues s’employer, seules,
comme femmes de ménage, cuisinières, au service des installations pétrolières
–souvent étrangères–, ces femmes qu’à la mosquée de Sidi Messaoud un imam
a dénoncées comme « les femmes sans mari qui salissent nos quartiers ». Ces événements ont suscité la réaction d’un « collectif » intitulé Réseau de réflexion et d’action en faveur des femmes et des enfants victimes de violences, qui déclare : « Tant que la moitié de la population sera considérée comme responsable de tous les maux et tant qu’elle n’aura pas droit aux “droits de la personne humaine”, ces mêmes exactions se répéteront dans l’indifférence sinon dans l’approbation de la “majorité silencieuse”. » (Correspondance particulière.) Certes, ce n’est pas propre à la Kabylie, mais il est certain que toutes ces violences faites aux femmes en
Algérie ne sont pas pour rien dans le développement des mouvements islamistes, qui ont trouvé, chez certains, un écho susceptible de conforter leurs convictions et comportements patriarcaux ; c’est ainsi qu’en Kabylie une « coordination des villages » a, le 15 juin 2001, renoncé à placer dans ses revendications la suppression de ce Code de la famille !
C’est la violence exercée par l’armée et son omniprésence dans le champ politique et gouvernemental. Déjà, dans les années soixante-dix, un vieux Kabyle me disait pour s’en indigner : « L’armée est partout, c’est elle qui gouverne et elle possède tout. »
C’est encore la violence dans l’enseignement arabisé en arabe moderne, au
mépris des langues maternelles dialectales, tamazight ou arabe algérien, alors que
ces langues maternelles pourraient être une étape dans l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture, avant que d’acquérir des langues de plus grandes diffusion et
communication. Mais il y a bel et bien violence – doublée de mépris – par choix
délibéré de ne tenir aucun compte des langues maternelles puisqu’un wali (préfet)
a pu me dire, au début des années soixante-dix, qu’il ne fallait pour cette arabisation
par l’enseignement que « sacrifier une ou deux générations » !
N’est-ce pas encore des violences faites à la population algérienne, que
l’incurie des gestions, de l’eau par exemple, et sa pénurie, qui s’aggrave chaque
jour davantage par des coupures fréquentes et durables – au point que, dans une
ville, l’arrivée d’eau aux robinets signifie qu’un responsable va venir ? Mais aussi
pénuries de gaz, d’électricité, d’écoles, réseau routier mal entretenu, et la faim,
la misère dont sont victimes trop d’Algériens, tandis que quelques privilégiés
s’enrichissent.
Maîtrise dans la révolte
Comment, à toutes ces violences, les jeunes ne seraient-ils pas tentés de répondre
pareillement ? En réalité, d’une telle attitude violente le gouvernement pourrait tirer
profit : les nécessités de la restauration de l’ordre, la peur des autres Algériens,
surtout lorsque la télévision algérienne diffuse largement les images de ces actions
et de leur répression, peuvent être dissuasives. D’autant que la menace de retour du
danger islamiste risque fort de servir à mieux étouffer d’autres manifestations. Le
général Khaled Nezzar (un Aurésien), ancien ministre de la Défense, ne vient-il
pas d’appeler les Algériens à la mobilisation contre le « péril intégriste » ? En effet,
les ripostes gouvernementales consistent à tenter de discréditer le mouvement
kabyle sous la stigmatisation habituelle de séparatisme ethnique (antienne bien
connue des gouvernants de l’Algérie depuis l’indépendance), accusant le mouvement
des jeunes d’avoir des revendications purement kabyles alors qu’elles sont
clairement nationales, et aussi de complicité avec des « puissances étrangères ».
Un Mouvement de la Kabylie libre a bien été lancé, mais il a eu fort peu d’écho,
et quelques revendications d’autonomie – d’abord linguistique et culturelle
[Chaker, 1998] – sont demeurées extrêmement minoritaires, nettement condamnées
par la plupart des autres jeunes manifestants.
En revanche, les images de violences retransmises par la télévision pourraient,
en retour, inciter les jeunes à répondre de la même façon, tant est grande leur
exaspération contre l’armée au pouvoir. « On ne veut plus être gouvernés par des
généraux » est un slogan souvent repris, qui traduit une large prise de conscience
de la mainmise de l’armée sur l’Algérie, déjà constatée de longue date par de
vieux émigrés kabyles de retour et fort lucides.
Pourtant, privés d’emploi, ces jeunes ne peuvent même plus faire de projets, ils
se voient dans l’impossibilité d’envisager une vie correcte. Même les rêves d’évasion
leur sont aujourd’hui interdits puisqu’il n’est plus de départ, plus d’émigration
possible (excepté, pour très peu d’entre eux, le « regroupement familial ») : leur seule perspective est le chômage. Alors que d’autres ont pu, un temps, se retourner vers les terroristes islamistes, les jeunes Kabyles ne sauraient se résoudre à emprunter ce chemin. Non. Il ne reste plus de perspective à tous ces jeunes hommes que cette seule alternative : se révolter ou être de ceux que l’humour algérien appelle, par dérision, les « hittistes » (de hid , « mur ») parce que, passant leur temps,
oisifs, assis au pied des murs, ils serviraient au moins à les empêcher de tomber !
Si leur expression se laisse parfois emporter à l’excès, elle demeure bien
souvent contenu, les jeunes Kabyles faisant alors preuve de ces qualités tant célébrées dans leur culture : la dignité dans l’honneur masculin (tirugza, la vertu majeure de argaz, l’« homme ») et la maîtrise de soi, la mesure (lekyasa). Ainsi cherchent-ils à s’organiser en refusant la violence, par des manifestations pacifiques et néanmoins massives, étonnantes pour une jeunesse exaspérée contre ses gouvernants jugés responsables de les priver d’avenir. La marche du 14 juin à Alger a réuni, dans le calme, sans nulle violence, environ cinq cent mille manifestants aux seuls cris de « Pouvoir assassin » et de « Y en a marre des généraux ». Tel encore le sit-in organisé en réponse à l’interdiction de la manifestation du 8 août à Alger.
Ces jeunes proclament clairement leurs revendications, même si des dérapages peuvent être commis par certains, manipulés ou non.
Des organisations nouvelles, dans la citoyenneté
Héritiers de représentations égalitaristes, ils n’hésitent pas non plus à innover
en s’organisant sous des formes variées, nouvelles, occasionnelles ou durables.
Ainsi en est-il d’une certaine « Coordination des comités de villages », qui semble
bien être une nouveauté, puisque le terme de « coordination » fait référence à
nombre d’organisations spontanées de revendications ainsi nommées aujourd’hui,
en France, tandis que les comités de villages pourraient bien désigner les nouvelles
jemaâs kabyles (déjà activées lors du « printemps berbère » d’avril 1980) et constituer
ainsi la base d’une nouvelle et plus large organisation qui les regrouperait
avec une certaine périodicité. Ainsi en est-il encore de la Coordination des aârch
(« tribus »), daïra (« cantons ») et communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, qui
comprend quarante et une « délégations » ; elle s’est périodiquement réunie et, le
1er juin 2001, a exprimé ses revendications : « Le drapeau de l’Algérie, la langue
nationale tamazight à côté de l’arabe, dans un pays (l’Algérie) de Maghnia (à la
frontière marocaine) à Tebessa (à la frontière tunisienne, au nord) et de Tindouf à
Tamanrasset (au sud). » D’autres organisations ont été créées occasionnellement,
comme une réunion des ourouch (« tribus ») à El-Kseur (le 11 juin 2001), pour
concevoir une plate-forme de revendications amazigh qui a été signée par les
représentants des wilayas (préfectures) kabyles. Ayant reçu l’appui d’un Collectif
des universités d’Alger, cette plate-forme qui se veut « identitaire, civilisationnelle,
linguistique et culturelle », réclame outre la « consécration de la tamazight
en tant que langue nationale et officielle », des droits économiques et des libertés
démocratiques, ainsi qu’un « plan d’urgence socio-économique pour toute la région
de Kabylie », et encore le droit à une allocation de chômage évaluée à la moitié
du SNMG (salaire national minimum garanti). Des organisations de ce genre se
sont aussi créées en émigration : une Coordination des villages kabyles a vu le
jour à Paris le 13 mai 2001, et une Coordination des taxis kabyles à Paris a manifesté
devant le Parlement de Strasbourg le 4 juillet 2001 (Algeria Interface).
Ces formes d’organisation citoyennes, si elles s’inspirent des structures
kabyles, se veulent cependant avant tout algériennes. On a vu ci-dessus que la
première des revendications exprimées par la Coordination des aârch, daïras et
communes de la wilaya de Tizi-Ouzou était le « drapeau algérien ». Le 14 juin
2001, les jeunes Kabyles qui ont manifesté là Alger défilaient tous derrière le
même drapeau algérien, brandi au premier rang des participants. Et c’est dans
le drapeau algérien que le chanteur kabyle Lounès Matoub, assassiné dans des
conditions non encore élucidées, a été enseveli. Les Kabyles savent que l’insuffisance
économique de la Kabylie lui interdit toute revendication d’indépendance
et que leur région, si originale soit-elle, est de dimensions modestes tout en étant
de longue date très intégrée à l’ensemble algérien. La seule revendication d’indépendance clairement exprimée par les jeunes, non sans humour, est l’« indépendance de l’Algérie... de l’armée » [26].
D’ailleurs le gouvernement algérien ne comporte-t-il pas un certain nombre de
berbérophones, à commencer par la moitié des généraux dits du « cabinet noir »
(le clan des « éradicateurs »), qui sont d’origine berbère ? [27] Certains approchent même de très près le gouvernement puisqu’un des conseillers officieux auprès du
président Bouteflika, rallié un temps au RCD du Dr Saïd Sadi (Rassemblement pour la culture et la démocratie) est un Kabyle (Rachid Aïssat, du village de Tazmalt). Les Kabyles sont aussi présents – peut-être davantage, mais peut-être
aussi qu’alors on ne les remarque plus ? –dans les cadres des syndicats ou des partis politiques d’opposition, tels, à la tête du PAGS (ex-Parti communiste algérien, Parti pour l’avant-garde socialiste), le Dr Sadek Hadjerès, auquel a succédé Chérif el-Hachemi, ou à la tête du RCD (Rassemblement pour la culture et la démocratie) le Dr Saïd Sadi, ou encore au FFS (Front des forces socialistes) Hocine Aït Ahmed. Certes, il peut aussi se trouver qu’un Kabyle soit émir de l’AIS (l’Armée islamique du salut), tel Madani Mezrag, de la Kabylie de Jijel, une des « Petites Kabylies ».
Prenant une part importante dans les instances politiques ou économiques nationales,
il est certain que les Kabyles ont des revendications nationales algériennes.
Les nouvelles coordinations vont-elles concurrencer les partis, actuellement
quelque peu marginalisés ? Le RCD a été compromis par sa participation de
quelques mois au gouvernement, et le FFS doit assumer une stratégie électorale marquée par des consignes d’abstention restées incomprises, ce qui, dans la conjoncture actuelle, n’est pas pour déplaire au gouvernement. Mais peut-être les partis, voire les syndicats, pourraient-ils ultérieurement, et à la condition d’unir leurs forces, sinon remplacer du moins soutenir et relayer les coordinations dans le
domaine politique ? Car seule une union des forces démocratiques peut avoir des chances de faire prendre en compte leurs revendications avant que la crise n’empire.
Conclusion
Au sein de ce foisonnement d’associations, de coordinations et d’organisations, on peut se demander jusqu’où les jeunes Kabyles pourront persévérer dans la structuration de ce mouvement. À moins que de nouvelles options prises par l’État algérien n’engagent une autre voie en satisfaisant dès maintenant à certaines des revendications de cette jeunesse ?
Cependant, la révolte risque de s’étendre et de prendre une ampleur généralisée. En effet, le mouvement de revendications s’est étendu hors de Kabylie et a gagné d’autres régions, une vingtaine de wilayas. Des manifestations ont eu lieu à Alger, dont la population est à 60% kabyle, et dans l’Est algérien, comme dans d’autres régions berbérophones, en Aurès (la région d’origine du général Nezzar, qui jusque-là soutient le pouvoir), et dans de nombreuses villes, même dans l’extrême Sud et hors des zones berbérophones, où les manifestants ne veulent pas laisser aux seuls Kabyles l’initiative de déclencher des changements vers plus de
démocratie. [28]
Le mécontentement gagne partout, car le malaise est général. Les mouvements
trouvent même des échos hors frontières, en émigration, à Paris bien sûr où, selon
les sources, huit mille voire cinquante mille personnes ont défilé, accompagnées par les chanteurs kabyles très populaires que sont Idir ou Aït Manguellat.
N’assiste-t-on pas aussi à une renaissance des revendications amazigh au Maroc,
où un manifeste berbère a été remis au roi Mohammed VI, portant les signatures
d’un million de Marocains ? Mais cela est une autre affaire, dans un autre contexte,
et une revendication panberbère est illusoire dans un Maghreb qui semble avoir
échoué à se réunir en un « Grand Maghreb » un temps rêvé.
Des élections sont prévues pour le printemps 2002. Y aura-t-il, à cette occasion, une mobilisation plus ample ? En tout état de cause, nombreux sont ceux qui pensent que seule une union des forces démocratiques, avec ou à côté des partis déjà constitués, peut parvenir à peser sur le gouvernement.
Bibliographie
Site http://www.algeria-interface.com
AUCAPITAINE Henri (baron), Les Kabyles et la colonisation de l’Algérie , Challamel, Paris, H. Bastide, Alger, 1864, 180 p., p. 35.
CARETTE E., Études sur la Kabylie proprement dite , Imprimerie nationale, Paris, 1848, 2 t., 500 et 459 p. (exploration scientifique de l’Algérie pendant les années 1840 à 1842).
CHAKER Salem, Berbères d’aujourd’hui , L’Harmattan, Paris, 1998.
COLONNA Fanny, Les Instituteurs algériens, 1883-1939 , Office des publications universitaires, Alger, 1975.
INED, Les Algériens en France. Étude démographique et sociale, Travaux et documents , cahier n° 24, Paris, 1955.
LACOSTE-DUJARDIN Camille,
- Le Conte kabyle. Étude ethnologique , François Maspero, Paris, 1970, 534 p., rééd. La Découverte, Paris, Bouchène, Alger, 1991.
- Un village algérien, structures et évolution récente , SNED, Alger, 1976a.
- « Changement et mutation à travers quelques rites paysans dans l’Algérie nouvelle » , L’Autre et ailleurs (hommage à Roger Bastide), Berger-Levrault, Paris, 1976, p. 398-415.
- « Genèse et évolution d’une représentation géopolitique : l’imagerie kabyle à travers la production bibliographique de 1840 à 1891 » , Connaissances du Maghreb, CNRS, Paris, 1984, p. 257-277.
- « Démocratie kabyle. Les Kabyles : une chance pour la démocratie algérienne ? » , Hérodote, n° 65-66, 2e-3e trim. 1992, p. 63-74.
- « Pourquoi n’y eut-il pas de villes en Kabylie marchande ? », La citta méditerranea. Atti del congresso internazionale de Bari, 4-7 maggio 1988, Istituto universitario di Napoli, Naples, 1993, p. 381-394.
- Opération « Oiseau bleu » . Des Kabyles, des ethnologues et la guerre d’Algérie , La Découverte, Paris, 1997, 308 p.
- « Une intelligentsia kabyle en France : des artisans d’un “pont transméditerranéen” » , Hérodote (Europe du Sud, Afrique du Nord), n° 94, 3e trim. 1999, p. 37-45.
- « La montagne pour les Kabyles : représentations et réalités » , Montagnes méditerranéennes (La montagne et le savoir), n° 12, Grenoble, 2000, p. 95-100.
MAMMERI Driss, Expérience de cinq années de pratique médicale en pays kabyle (1950-1955). Perspectives d’avenir , université d’Alger, faculté mixte de médecine et de pharmacie, 1962, 59 p. ronéo.
MAMMERI Mouloud, La Colline oubliée , Plon, Paris, 1953, 255 p.
RAMBAUD Alfred, « L’enseignement primaire chez les indigènes musulmans et notamment dans la Grande Kabylie » , Revue pédagogique, novembre 1891 et décembre 1892.
RINN Louis, « Deux documents indigènes sur l’histoire de l’insurrection de 1871 » , Revue
africaine, 1891, p. 21-37.
GRANDE KABYLIE :
DU DANGER DES TRADITIONS MONTAGNARDES
Hérodote, N°107 –2002/4
Il y a un an, dans un précédent article d’Hérodote (4e trim. 2001),
[29] j’ai présenté une première analyse de géographie culturelle et politique en montagne
kabyle, pour tenter d’éclairer la conjoncture actuelle, préoccupante, de la révolte
de sa jeunesse réclamant davantage de démocratie. J’ai montré comment, fondant
leur identité sur une culture à laquelle ils manifestent un profond attachement,
mais, excédés par les violences des forces de l’ordre et dénonçant le « mépris »
(hogra ) dans lequel ils reprochent au gouvernement algérien de les tenir, ces
jeunes gens tentent d’organiser leur mouvement. Or, s’ils viennent à rejeter les
cadres des partis modernes ou des mouvements implantés plus particulièrement en
Kabylie, tels que le RCD (Rassemblement pour la culture et la démocratie, du
Dr Saïd Sadi) et le FFS (Front des forces socialistes, de Hocine Aït Ahmed), ou
même le MCB (Mouvement culturel berbère), avec lesquels ils proclament leur
désaccord très critique, en revanche ils prétendent s’inspirer des valeurs culturelles
et des structures montagnardes traditionnelles, qu’ils pensent ainsi ranimer.
J’avais conclu cette étude par une interrogation : quelles formes d’organisation
pourront donc, à partir de ce mouvement de révolte des jeunes de Kabylie, se
mobiliser et se structurer de façon à exercer une pression suffisamment forte sur le
gouvernement algérien pour faire aboutir leurs revendications ?
Or les dépêches en provenance d’Algérie ne décèlent guère de changement en
Kabylie depuis plus d’une année de troubles graves. Elles citent, encore et toujours,
les mêmes « rassemblements » de jeunes, les attaques de « sièges de daïras »
(sous-préfectures), pour tenter d’en « expulser » les responsables, les « barricades enflammées » et autres « émeutes sporadiques » contre lesquelles ripostent non
moins violemment les « forces de sécurité » et autres brigades anti-émeutes ».
Bref, on constate la permanence des « affrontements », des « heurts », avec un bilan
de victimes fort lourd puisque désormais, dans la région, durant ces quinze derniers
mois, on compte « une centaine de morts et plus de deux mille blessés ». Et
l’AFP de conclure par ce constat : « La Kabylie est en révolte larvée contre le pouvoir
central depuis le 18 avril 2001 » (19 juillet 2002, AFP, algeria-interface.com),
date de l’assassinat, dans la gendarmerie de Beni Douala, du jeune lycéen
Massinissa Guermah.
C’est dire que si, depuis plus d’une année, ce mouvement des jeunes Kabyles
se poursuit par cette révolte que certains dénoncent comme une anarchie, il
demeure pourtant jusque-là impuissant à prendre de l’ampleur à travers la population
algérienne et à peser de façon efficace sur les instances gouvernementales.
Certes, le gouvernement algérien a bien accordé un statut officiel à la langue
tamazight (berbère) parlée en Kabylie, mais la mise en oeuvre de ce statut n’a pas
suivi. Certes, le président Bouteflika a fini par gracier et libérer les détenus
kabyles, condition réclamée par les jeunes pour ne pas boycotter les élections
locales prévues le 10 octobre 2002, mais les mêmes jeunes condamnent le FFS,
qui a décidé d’y participer. Certes, le gouvernement se soucie surtout de temporiser,
et l’on ne peut négliger, face à cette « révolte larvée », l’inertie voulue des instances
au pouvoir, qui jouent le pourrissement et l’usure du mouvement. Car
« aucune issue ne se profile », et « à moins d’un retournement de situation spectaculaire
qui verrait le mouvement des âarchs entrer dans le rang, la Kabylie devrait
encore boycotter ce scrutin et accentuer la situation de pourrissement » (2 août
2002, www.algeria-interface.com).
Or ces aârchs (pluriel arabe : aârouch ), ou « tribus », étaient des structures
sociales et politiques traditionnelles, autrefois répandues dans l’ensemble de
l’Algérie précoloniale, qui rassemblaient seulement un certain nombre de villages.
Pourtant il y a bien, dans ce même mouvement de jeunes, des « coordinations d’aârchs » créées dans les différentes circonscriptions administratives de Kabylie :
les wilayas (préfectures) et les daïras (sous-préfectures). Mais aucune structuration
d’ensemble n’existe de façon permanente au niveau régional, et à fortiori
national, qui réunirait toutes ces manifestations de la jeunesse surgies dans différents
centres de cette région de la montagne kabyle, et qui, en dehors de la Kabylie,
gagnent çà et là, sporadiquement et comme par contagion de cet exemple,
quelques autres régions du territoire algérien.
Qu’est-ce à dire ? Quelle est la nature de ces mouvements d’aârch ? Comment
sont-ils organisés ? Quelles sont leurs motivations ? Et pourquoi sont-ils particulièrement
développés dans cette région de montagne, dont les habitants se retrouvent
ainsi, comme en tant d’autres précédentes occasions, à la pointe de l’agitation nationale et de la revendication démocratique en Algérie, mais qui refusent
d’adhérer à d’autres mouvements antigouvernementaux, tels les mouvements
islamistes dont ils condamnent les thèses ? [30]
Il y a là une intéressante particularité montagnarde, et il faut en revenir à l’analyse
de cette région de montagne et à la forte spécificité de la Kabylie, qui n’a
cessé de se manifester à maintes reprises au sein de la nation algérienne.
Spécificité et fierté montagnardes
On sait que l’Afrique du Nord a été appelée, par les géographes arabes, Djezirat
al-Maghrib, l’« île du Couchant », car ses hautes terres et ses montagnes se
dressent comme une île entre les immensités de la mer et du désert. Les géographes
français distingueront deux grands ensembles montagneux plus ou moins
parallèles : en bordure de la Méditerranée et relativement bien arrosées, les montagnes
du Tell : le Rif au Maroc, et, en Algérie, les montagnes de l’Ouarsenis et les
Kabylies. Au sud, dominant le désert, le Haut Atlas à l’ouest (djebel Toubkal,
4167 m) et, en Algérie, l’Atlas saharien.
Ces montagnes se caractérisent par de relativement fortes densités de population
et par la persistance d’agricultures que l’on peut schématiquement qualifier
de « traditionnelles ». En effet, les colons ne se sont pas installés dans les montagnes.
Dans les plaines, directement touchées par l’extension des domaines coloniaux
(ou ceux des notables alliés à la colonisation), la vie pastorale traditionnelle,
associée à la culture des céréales, a beaucoup régressé. En revanche, dans les
montagnes, l’arboriculture villageoise traditionnelle (figuiers, oliviers, etc.), associée
à une maigre céréaliculture, s’est maintenue. Au Maroc, dans la partie occidentale
du Haut Atlas, les versants de vallée ont été aménagés en terrasses pour la
culture irriguée. En revanche, la partie orientale est encore le domaine de l’élevage
transhumant, et il en est encore plus ou moins de même dans le Moyen Atlas
(qui raccorde en oblique le Haut Atlas au Rif), bien que la colonisation ait accaparé
les terres de plaine où les troupeaux descendaient l’hiver.
Les populations montagnardes du Maghreb ont une autre caractéristique
commune : c’est de conserver, bien plus que dans les plaines et dans les villes, les
traits majeurs de la culture berbère. En effet, tout en faisant partie du monde arabe
et musulman, le Maghreb se distingue par une spécificité africaine marquée : l’existence, dans la quasi-totalité de ces montagnes, d’une riche culture particulière,
héritage de l’ancien peuplement autochtone du Maghreb, dont la langue
est distincte de l’arabe, quoique de la même grande famille chamito-sémitique :
c’est la langue berbère, appelée plus souvent à présent langue tamazight, la langue
des « hommes libres », autrefois parlée des Canaries à l’ouest jusqu’en Égypte à
l’est, où elle existe encore dans l’oasis de Siwa, à la frontière de la Libye.
La Grande Kabylie est l’unité montagneuse berbérophone la plus remarquable
de l’Algérie, dans le Tell, à peine à une quarantaine de kilomètres d’Alger. Elle se
distingue des Petites Kabylies, également berbérophones, qui lui succèdent à l’est
et au sud de la vallée de l’oued Sahel Soummam : la Kabylie des Bibans et la
Kabylie des Babors. À 50 km à peine d’Alger, la Grande Kabylie [31] s’étend sur
200 km d’ouest en est depuis Thenia jusqu’à Bejaïa, et sur 100 km du nord au sud,
entre la Méditerranée et la vallée de l’oued Sahel Soummam. Son relief est constitué
de trois parties : au nord, une chaîne côtière, dite « de Kabylie maritime »,
culmine à 1 278 m au tamgout (« sommet ») des Aït Jennad ; au sud, une haute
barre rocheuse, l’arc de cercle convexe de la grande sierra calcaire du Djurdjura,
porte un des sommets de l’Algérie : le tamgout de Lalla Khadîdja, à 2 308 m ; et
entre ces deux chaînes se trouve le coeur de la Grande Kabylie, un massif ancien
découpé par un ensemble de vallées entre lesquelles se dressent de longues digitations
(comparables aux serres cévenoles). Elles s’abaissent depuis le Djurdjura au
sud, vers l’oued Sebaou, jusqu’au Nord maritime, haché de ravins très creusés.
À 800 m d’altitude moyenne, c’est la partie des Kabylies la plus densément peuplée,
par les Igawawen ( Zouaoua en arabe), d’où son nom de massif Agawa. Partout,
en quelque point que ce soit de ce massif kabyle, l’horizon se confond au sud
avec les cimes du Djurdjura, aux neiges persistantes jusqu’en avril ou mai.
La montagne constitue donc la majeure partie du pays kabyle. Elle est partout
présente, et la distinction est souvent difficile à établir entre la plus haute montagne
inhabitée et les hautes collines montagneuses et très densément peuplées
qu’elle domine. En fait, les Kabyles sont aussi très conscients et fiers de leur forte
identité fondée tant sur leur qualité d’ imazighen (« hommes libres ») que sur celle
d’ imesdura r (« montagnards »), jamais colonisés dans leur montagne. En fait, tout
en préservant l’isolement de leurs familles, à l’abri dans leurs villages, les
hommes ont pris la liberté de se déplacer souvent à l’extérieur de la Kabylie, dans
les plaines et villes d’Algérie et même de tout le Maghreb, mais sans aucunement
modifier leurs structures internes fondamentales, auxquelles ils marquent même
un farouche attachement.
La haute montagne sacralisée
La haute montagne accidentée est pourtant, pour eux, un pays inquiétant et
dangereux par nature. Dans les contes traditionnels kabyles, un des objets de quête
est « l’eau d’entrechoquement des montagnes », [32] que le valeureux héros doit aller
quérir au péril de sa vie, une eau qui sourd des anfractuosités entre les rochers, eau
magique, source de vie et de jouvence, et remède miraculeux. Cette représentation
s’appuie sur la réalité du djebel Djerdjer, ou adrar budfel , la « montagne de neige », la sierra du Djurdjura, dont les nombreuses diaclases fissurent en tous
sens les parois calcaires en y abritant tout un réseau hydrographique souterrain.
Cette grande montagne pierreuse, creusée de profondes grottes, de puits sans fond
(avens karstiques nommés anou en kabyle) et autres gouffres, est considérée par
les Kabyles comme le domicile d’êtres surnaturels, de génies de toutes sortes, serpents,
ogresses, ogres, hydres, occupants des nombreuses profondeurs caverneuses : autant de portes vers le monde chtonien, et que seuls des hommes d’exception, tels les courageux héros des contes, peuvent affronter et vaincre. On
associe aussi volontiers à la montagne kabyle l’asile qu’elle offre à des voleurs de
grands chemins et à bien d’autres bandits, [33] dont elle garantit la solitude. C’est aussi dans cette montagne que les Kabyles situent leurs mythes antéislamiques
encore connus, par exemple celui de l’origine des animaux sauvages, engendrés
par la semence d’un buffle fécondée par le soleil dans un creux de rocher, dans le
massif de l’Haïzer, une des cimes occidentales du Djurdjura, ou celui du premier
homme et de la première femme surgis sur terre par des fentes de la montagne,
depuis les profondeurs souterraines. C’est encore dans ces rochers élevés de la
sierra que la « Première Mère du Monde » aurait déchaîné les intempéries qui
depuis, dit-on en Kabylie, provoquent la mort de nombreux animaux à la fin du
mois de février, pendant les jours de froidure dits « jours de la Vieille ».
Cette nature sauvage et vide d’hommes, aux rochers escarpés et calcaires, percée
en tous sens de profondes diaclases et de grottes souvent réputées sans fond,
aux hautes surfaces karstiques creusées de lacs et de lapiaz, fut de tout temps
tenue pour lieu sacré, résidence de génies ou d’ogresses redoutées, en communication
avec le monde souterrain et l’au-delà. Nombre des sommets remarquables
du Djurdjura suscitent aujourd’hui encore des invocations des forces chtoniennes
et accueillent des pèlerinages lors desquels sont célébrés des rites contre la stérilité.
Ces hauts lieux sacralisés, dans la partie déserte de la montagne, celle des
sommets rocheux de la sierra, sont pourtant particulièrement islamisés. Ils ont
même accueilli des retraites d’ermites, comme celle de cette sainte femme, Lalla
Khadîdja, « Madame Khadîdja », éponyme du sommet, qui y trouva refuge, et
aussi celles des quatre premiers imrabden (« marabouts »), saints hommes fondateurs
de l’islam en Kabylie, venus au XVIe siècle depuis les ribat, monastères forteresses
de la Seguiet el-Hamra dans le désert du Sud marocain, jusqu’à un ermitage
temporaire dans le Djurdjura, [34] pour s’installer ensuite en différents centres religieux,
les zaouïas , dispersés à travers la Kabylie où leurs descendants prêchent,
enseignent le Coran et servent de médiateurs entre les tribus.
Cette sierra inhospitalière est aussi jugée bien propre à désespérer le paysan.
Les pierres et le maquis méditerranéen qui en couvrent les pentes en sont les deux
aspects complémentaires. Mais la haute montagne des rochers est plus dangereuse
que le maquis, car elle cumule la difficulté du relief et l’éloignement en altitude,
alors que toute la Grande Kabylie habitée s’étend à ses pieds depuis le nord du
Djurdjura jusqu’à plus d’une cinquantaine de kilomètres de distance à vol d’oiseau,
et le double ou le triple par les chemins accidentés. Un des exploits que doivent
accomplir les héros des contes, à valeur initiatique, est le défrichage d’une montagne
qu’il leur faut aplanir et transformer en jardin, tâche impossible à mener à
bien sans le secours de puissances surnaturelles. Pourtant, la sierra est aussi
reconnue comme source de vie ; elle est à la fois dissuasive par sa rudesse et bienfaisante
par l’eau qu’elle dispense, telle une vaste éponge, grâce à son karst réservoir
au point que, dans certaines grottes profondes, la glace demeure jusqu’en été,
exploitée par les Kabyles des Aït Koufi, la tribu la plus proche, autrefois fournisseurs
attitrés des deys turcs d’Alger.
La montagne habitée, très peuplée
Au-dessous et au nord de la haute montagne sacralisée à la fois familière et
redoutée, le massif Agawa est donc la montagne peuplée, habitée, la montagne
refuge que des hommes nombreux forgés à la rude vie montagnarde habitent en
très fortes densités (de l’ordre de 200 hab./km2). Sur les longues croupes qui descendent
du Djurdjura sont installés de très nombreux et gros villages, qui jalonnent
les crêtes de leurs maisons jointives aux toits de tuiles rouges, [35] serrées en gros bourgs perchés. C’est tamourt leqbayel , le « pays des Kabyles », auquel ils
manifestent un attachement indéfectible. Le massif possède, à 1000 m, sa plus
grosse agglomération : Larbaâ n’aït Iraten (autrefois Fort-National et aussi, auparavant,
quelques années, Fort-Napoléon), petite ville qui s’est développée autour
d’une citadelle construite par l’armée française. Toutes ces hauteurs, à une
moyenne de 800 m environ, sont entaillées de profonds ravins où roulent des
torrents dévastateurs lors des pluies méditerranéennes d’automne ou de printemps.
Les hommes trouvent à grand-peine quelques hauts replats et des fonds
de ravins à cultiver temporairement. Mais la plupart des versants convexoconcaves,
trop raides, ne sont guère propices qu’à l’arboriculture (oliviers,
figuiers surtout), que les Kabyles pratiquent avec beaucoup d’art, de soin et de
peine, allant autrefois jusqu’à s’encorder sur les pentes excessives où, cependant,
parviennent à s’accrocher les racines des figuiers et de nombre de variétés
d’autres arbres fruitiers.
En réalité, pour vivre décemment, les Kabyles, entreprenants, ont toujours
cherché des compléments de ressources hors de l’agriculture, d’abord dans différentes
formes d’artisanat : orfèvrerie, armurerie, travail du bois, fabrication de
tissus, de tentures et de tapis, poterie, etc. Enfin, nombre d’entre eux ont tiré la
subsistance de leur famille du commerce, de boeufs de labour près de la haute
montagne, et d’entreprises de colportage au long cours à travers le Maghreb, à
partir des villages du massif Agawa, enfin de l’émigration plus lointaine et
durable. Les hommes laissaient femmes et enfants bien à l’abri des villages perchés
dans la montagne, tandis qu’eux-mêmes s’aventuraient au-dehors, dans les
villes algériennes, Alger, Oran. Ils allaient aussi jusqu’à Tunis, travailler comme
maçons, épiciers, voire, grâce à leur réputation guerrière, comme soldats (ils
furent les célèbres Zouaouas – les « Zouaves » – du bey de Tunis ou du dey d’Alger,
chargés de châtier les révoltes des janissaires turcs) ou sur mer, comme marins à
bord des galères corsaires. Enfin, à partir des années 1900-1910, de l’autre côté de
la mer jusqu’en France, les Kabyles furent les premiers Algériens à venir travailler.
Aujourd’hui, la Kabylie vit encore en grande partie de cette émigration à
présent stabilisée en immigration.
La montagne bastion
En réalité, pour subvenir à leurs besoins vitaux par l’agriculture, les Kabyles
ont toujours eu besoin des compléments de céréales que seules leur permettaient
d’obtenir les plaines et les grandes vallées bordières du massif, certaines d’entre
elles pénétrant même la montagne, et où ils se gardaient d’habiter. Elles ne furent
guère colonisées non plus, les grands domaines européens occupant davantage la Mitidja, la vallée du Chélif ou les hautes plaines plutôt que de s’installer à proximité
des remuants Kabyles, si prompts à prendre les armes. [36] Cependant, pour cultiver ces plaines où peu d’entre eux avaient des terres, il leur avait fallu s’entendre
avec leurs occupants et propriétaires, avec qui ils s’engageaient par différentes
sortes de contrats. Mais ils s’y trouvaient à la merci de multiples pillards, et
surtout des soldats du dey d’Alger (en partie cantonnés dans les bordjs des
plaines), qui prétendaient leur faire payer des impôts, ce qui les a longtemps
contraints à ne descendre qu’en armes pour labourer et moissonner dans la plaine,
dans la crainte de perdre leur récolte. Pour les cultivateurs montagnards, le danger
était tel que le laboureur de la plaine est, en kabyle, comparé au lion dont il est
supposé avoir la force. La plaine est donc, pour les Kabyles, un lieu de défi et de
combat où le courage des hommes est mis à l’épreuve : « Qui veut acquérir des valeurs viriles descend dans la plaine... », chante-t-on pour exhorter les jeunes gens
au courage. Une maxime dit encore : « Qui a des fils dans la montagne n’a rien à
redouter dans la plaine. » Aussi les Kabyles se sont-ils fait une réputation de
farouches guerriers, experts en tactique d’embuscade appropriée à leur armement
et au terrain montagnard, exprimant souvent un amour-propre fort susceptible,
fondé sur un sentiment de l’honneur qui leur a fait une réputation telle que nul
étranger ne s’avise de le provoquer, et d’autant plus redoutable qu’il s’appuie sur
la solidarité du village ou de l’ aârch , la « tribu ».
Les Kabyles entretiennent et cultivent leur valeur la plus précieuse, la taqbaylit,
ou « kabylité », à la fois honneur kabyle et vertu montagnarde. Leur disposition
de défense permanente contre les intrusions extérieures a amené leurs tribus à
résister farouchement à tous les envahisseurs, dont successivement les Turcs et les
Français, au point que ces derniers ne purent conquérir la Kabylie avant 1857, soit
pas moins de vingt-sept années après avoir débarqué en Algérie (1830). Encore
fallut-il s’y prendre à plusieurs reprises et jusqu’à sévèrement réprimer, quatorze
années plus tard, l’insurrection de 1871 qui embrasa surtout la Kabylie. L’on
connaît aussi la part capitale que les Kabyles ont prise à la guerre d’indépendance
de l’Algérie de 1954 jusqu’en 1962, puisque la wilaya III, celle de la montagne
kabyle, fut un des lieux de maquis et de combats les plus constants et les plus
acharnés tout au long de ces huit années de guerre, à laquelle toute la population
kabyle a payé un tribut particulièrement lourd [Lacoste-Dujardin, 1997].
LA KABYLIE EN ALGÉRIE
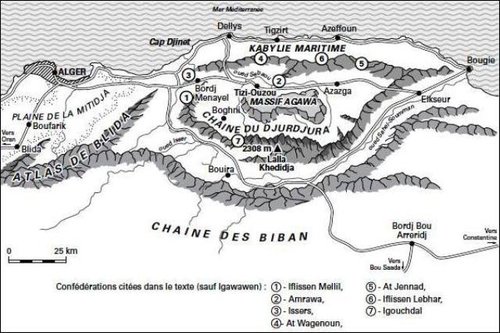
Une tradition montagnarde égalitariste
Cette dure réalité entretient la force des représentations en attisant, chez les
Kabyles, un souci constant et quasi obsédant d’avoir à se défendre constamment
contre toute intrusion extérieure. Cette disposition apparaît dans les représentations
populaires et jusque dans les structures sociales elles-mêmes, dominées par
une tendance au repli défensif dans l’« entre-soi » et la solidarité fraternelle, qui se
manifeste jusque dans toutes les modalités de la vie des hommes. C’est ainsi que
les Kabyles marquent une nette préférence pour tout négocier, échanger, surtout à
l’intérieur de la parenté, y compris les mariages si possible endogames. Ils affirment
en effet préférer le mariage « dans la famille » (paternelle s’entend), l’idéal
étant pour un jeune homme d’épouser sa cousine parallèle paternelle : la fille du
frère de son père. Ainsi, disent-ils, tout le patrimoine en biens, valeurs morales et
honneur est assuré de rester sans risque au sein de la famille patriarcale. De même,
les propriétés demeurent le plus possible en indivision dans la même famille
paternelle qui prévaut dans ce système patriarcal et condamne tout manquement
individualiste à cette règle. Cela afin que les produits du travail des hommes, les
ressources, éventuellement les biens et richesses et peut-être surtout le capital
symbolique –l’honneur kabyle– soient jalousement sauvegardés au sein du
groupe de parenté dans lequel chacun est inscrit.
Un égalitarisme anti-individualiste, redoutant l’accaparement du pouvoir personnel
En effet, l’identité de chacun est définie par l’appartenance à la famille du père dans une stricte égalité entre les frères. En Kabylie, l’on ne demande pas à un homme « Qui es-tu ? », mais « De qui es-tu ? » ou « De quelle famille es-tu ? »,
accordant ainsi la priorité à la parenté sur l’individu. De même, toute accumulation
est comprise comme ne pouvant être le fruit que de la seule fécondité naturelle,
interne à la famille. Chacun y est placé au service de la prospérité familiale,
à laquelle il doit oeuvrer conjointement avec ses frères. L’extrême solidarité est
parfois traduite comme « moi et mes frères contre les autres » et parvient à s’étendre par cercles concentriques de parenté, réelle ou fictive, en passant par
« moi et les hommes de mon village contre le village voisin », jusqu’à « nous, les Kabyles, contre les étrangers ». Car, selon la même conception, cette représentation
implique non seulement le souci d’une stricte égalité des frères entre eux,
pour le plus grand bien de la communauté familiale, mais aussi des villageois
entre eux, pour le plus grand bien de la communauté villageoise, comme encore
des Kabyles entre eux, pour le plus grand bien de la communauté kabyle, celle des imazighen (« hommes libres ») et imesdurar (« montagnards »), habitants de tamourt leqbayel , le « pays », la « patrie kabyle ».
Un très fort souci d’égalité est manifesté en toute occasion, comme lors des
sacrifices de partage de viande ( timechret ou ouziaâ ) organisés par l’assemblée
villageoise, où les participants veillent scrupuleusement au nombre et à la taille
identiques de morceaux de viande de mouton ou de boeuf, de chaque catégorie
(parties les plus grasses, les plus maigres, osseuses, de différents abats), disposés
en tas et dont on procède ensuite à la répartition, en une cérémonie accomplie en
un lieu public, et où la présence de chaque homme du village est obligatoire
[Lacoste-Dujardin, 2001, article ci-dessus] . [37]
Pour les participants, cette cérémonie donne à voir
l’unanimité de la solidarité et de l’égalité villageoises, en offrant aux plus démunis
l’occasion de consommer de la viande. [38] Mais ce souci égalitariste a pour contrepartie
un véritable anti-individualisme, manifesté collectivement dans une sorte
de hantise de l’accaparement du pouvoir personnel par un individu : il n’est pas
souhaitable de l’emporter individuellement sur un homologue (exception faite
d’un étranger ou de forces du surnaturel magique).
C’est pourquoi les structures sociales sont organisées en Kabylie de telle façon
que, en dehors de la supériorité reconnue à l’âge et au sexe masculin, il n’est d’autorité
licite que partagée entre égaux, et de fonction de responsabilité que temporaire.
Ce souci jaloux d’égalitarisme peut être poussé à certains excès, jusqu’à
imposer une limite à l’enrichissement personnel. Ainsi, il y a plus d’un siècle, un
riche commerçant du village kabyle d’El Kalaâ des Aït Mansour en a fait l’amère
expérience : sommé par le qadi [39] et l’assemblée du village de cesser d’accroître sa
fortune accumulée, il s’est trouvé alors contraint d’entreposer désormais stérilement
ses richesses. Elles comprenaient plusieurs dizaines de milliers de litres
d’huile d’olive, cinq pièces remplies de figues sèches, trois d’olives, et beaucoup
d’argent, qu’il lui fut enjoint de redistribuer en aumônes aux pauvres [Carette,
1848, p. 327-328]. Cette représentation jalousement égalitariste est présente jusque
dans la littérature orale, où, dans les contes, le véritable héros kabyle est avant tout
défenseur de la cohésion de la communauté villageoise, tandis que l’aventurier
qui conquiert un pouvoir personnel, celui, par exemple, qui devient sultan grâce à
un anneau magique, sur le modèle des Mille et Une Nuits, s’en va poursuivre ses exploits loin de la Kabylie, en terre étrangère [Lacoste-Dujardin, 1970].
L’assemblée villageoise consensuelle
Dans les organisations politiques traditionnelles du village, ce sont les familles
et non les individus qui sont représentées, et l’autorité de chaque participant à
l’assemblée des hommes du village, la jemaâ , est en premier lieu fonction de la
réputation de sa famille, du nombre d’hommes qu’elle comporte, et aussi de sa
compétence personnelle dans l’art oratoire. Car les décisions y sont traditionnellement
prises au consensus, après que les hommes ont longuement discuté et jusqu’à
ce que tous se rallient à une seule et même opinion, celle qui, la mieux
défendue, a emporté la conviction et sera suivie de décision. C’est ainsi que les
hommes d’âge, chefs de familles importantes (les iqurray n’taddart , « têtes de village » ou « chefs »), pourvu qu’ils soient doués de sagesse et surtout de tamusni
(« science du discours »), ont dans le passé été les mieux entendus, réalisant une
véritable gérontocratie. L’assemblée des hommes du village, la jemaâ , a toujours
été la seule instance organisée de façon constante, avec des réunions périodiques
régulières, dans un bâtiment propre, la tajmaât (« maison des hommes »). L’assistance
y est obligatoire pour tous les hommes et représentants de chaque famille du village (à l’exclusion des femmes, sauf cas exceptionnel). La jemaâ décide des
lois que le village se donne et sanctionne par des amendes les manquements à ces
lois commis par les membres du village, homme, femme ou enfant ; elle assure et
gère aussi l’entretien des terres, chemins, bâtiments communs, fontaines.
C’est ainsi le consensus villageois, à défaut de majorité et de minorité et sans
vote, qui résout et décide, à l’unanimité de principe, des affaires administratives,
juridiques et politiques de chaque village. Cependant, puisque la langue tamazight
ne dispose pas de l’écrit, l’oralité des affaires et des lois a toujours permis une
grande souplesse d’adaptation selon l’occasion : rien n’a jamais été figé, tout a
toujours été débattu, négocié et, selon l’opportunité, adapté ; il suffisait pour cela
que tous les villageois se mettent d’accord. L’assemblée elle-même était présidée
la plupart du temps par l’ amin , chef temporaire du village, le plus souvent
patriarche d’une famille honorable, respecté pour sa sagesse. Il n’y avait pas
d’instance supérieure régulière. Un conseil de tribu, réunissant les responsables
des différents villages, pouvait être réuni lorsqu’une conjoncture particulière le
requérait : un casus bell i, une volonté de sécession d’un village ou le désir d’adhésion d’un autre, une atteinte à l’honneur tribal ; mais à ce niveau de l’ aârch (la « tribu »), rien de régulier n’existait.
Aujourd’hui, la pression d’une jeunesse nombreuse
Or, ces jemaâs ont survécu jusqu’à aujourd’hui, malgré la guerre et la mise en
place de structures administratives. La gérontocratie d’autrefois s’y est trouvée
dépassée. Car la population de Kabylie a beaucoup changé dans sa composition,
du fait des multiples événements du siècle dernier. En effet, l’émigration en
France a très tôt séduit les hommes kabyles, qui ont poursuivi ainsi leurs déplacements
traditionnels jusqu’en dehors du Maghreb. Ils ont été d’autant mieux à
même d’aller travailler en France qu’une politique de scolarisation en français a
été, depuis la fin du XIXe siècle, tout particulièrement mise en place en Kabylie par
le gouvernement français, plus précocement ici en l’absence de colonisation que
dans les autres régions d’Algérie, où les colons s’opposaient à la scolarisation des
indigènes. Très tôt, dès les années 1900-1910, des Kabyles ont été chercher jusque
au-delà de la mer, dans les usines marseillaises, parisiennes, ou dans celles des
régions du nord ou de l’est de la France, les compléments de ressources que leur
terre de Kabylie ne parvenait pas à leur fournir en suffisance. Les émigrants ont
été bientôt surtout des jeunes hommes scolarisés, aptes à lire et écrire en français.
Conséquence de l’émigration et de l’indépendance : beaucoup de jeunes
Ce fut d’abord ce que l’on a appelé l’« émigration noria », organisée par les
familles, où un frère remplaçait l’autre pour quelques années, souvent du plus âgé jusqu’au plus jeune, avant de revenir se marier au pays. Puis les hommes ont émigré plus durablement, pour une dizaine d’années ou plus, dans ce que l’on désignait en Kabylie comme « partir travailler à gagner de l’argent », mais toujours pour envoyer régulièrement les mandats à la famille, parents, frères et soeurs, femme et enfants, restés au pays. Sur ces entrefaites, la guerre d’indépendance algérienne (1954-1962) a pérennisé plusieurs années cette immigration masculine, tout en aggravant le déficit masculin sur place, en Kabylie, en ponctionnant sévèrement
en hommes, victimes de guerre, la population locale. Enfin, tout a changé
à partir de 1975, lorsque l’immigration dite « de travail », d’hommes seuls, a été interdite, tandis qu’était autorisé le seul « regroupement familial ». Les femmes ont alors rejoint leur mari, puis les enfants ont suivi ou sont nés en France. Ce changement de nature de la population kabyle immigrée en France a, en Kabylie, non plus seulement privé les familles étendues et nombreuses restées au pays d’un ou deux hommes seuls, mais les a amputées d’un foyer conjugal qui, en France, s’est installé durablement, avec un niveau de vie nettement supérieur à celui de la Kabylie. Alors, les mandats envoyés à la montagne se sont faits moins réguliers, plus rares, leurs montants moins élevés, et le transfert de fonds de France en Algérie a considérablement chuté. Si bien que les hommes actifs, en même temps que les revenus de l’émigration et les ressources, ont bientôt commencé à faire défaut au pays.
Et pourtant, en Algérie même, les familles kabyles appauvries ont encore, dans la vague démographique qui a suivi l’indépendance, vu naître de nombreux enfants qui ont survécu du fait de la réduction de la mortalité, ou du fait des émigrés de retour qui, souvent, se sont remariés à la fin de leur vie de travail, à l’heure de la retraite, et ont eu sur place de nouveaux enfants, ou du fait, plus simplement, des hommes et femmes restés en Algérie, jeunes devenus adultes. Car l’État algérien a attendu très longtemps avant de lancer et développer des campagnes de limitation des naissances, de sorte que, les conditions sanitaires s’améliorant, la mortalité infantile a régressé et la natalité a considérablement augmenté, jusqu’à faire prendre finalement conscience aux autorités de l’augmentation inquiétante du nombre des jeunes, prélude à un futur problème de la jeunesse.
Si, après l’introduction de la contraception, la scolarisation accrue, y compris celle des fillettes, et les multiples changements dans les mentalités, la natalité diminue aujourd’hui réellement de façon spectaculaire, il n’en reste pas moins que le pic des naissances des années passées se ressent encore dans la pyramide des âges : les jeunes de moins de vingt-cinq ans représentent, en 2001, 57% de toute la population algérienne. En l’absence de nombreux hommes émigrés, ce sont ces jeunes qui, très nombreux et dynamiques, prennent à présent place sur la
scène politique.
Les jeunes raniment les jemaâs villageoises, où ils prennent le pouvoir
Désormais, dans les assemblées villageoises et même dans les rues des villages et des villes kabyles, ces jeunes sont très nombreux. Or, privés de la possibilité d’émigrer, ils sont aussi privés de possibilités de travail, car le chômage sévit dramatiquement. Ils ne trouvent pas leur place dans l’agriculture ou l’artisanat local, jugés non rentables et de plus en plus abandonnés, non plus que dans l’activité nationale où ils ne peuvent être intégrés, si bien qu’ils demeurent aujourd’hui marginalisés. Alors ils veulent faire entendre leur voix, réclamer leur place dans la société algérienne. Ils n’hésitent pas à prendre souvent la parole, et aussi le pouvoir puisque, dans les assemblées, leurs voix conjuguées, leur détermination, leurs
revendications coïncident avec l’insatisfaction générale en Kabylie et emportent l’adhésion.
Or, dès l’indépendance en 1962, l’État algérien avait laissé ranimer officieusement les assemblées villageoises, croyant calmer cette Kabylie volontiers frondeuse qui n’avait guère été récompensée de sa massive participation à la lutte pour l’indépendance. Il est à penser qu’alors, et jusque encore aujourd’hui, l’État a prudemment jugé préférable de concéder ces expressions politiques, organisées sur le mode de la parenté sans dépasser le cadre du village, plutôt que d’encourager le développement de partis plus larges, fondés sur une adhésion à un programme préétabli et aptes à réunir un plus grand nombre de partisans individuels, structurant un plus vaste mouvement, de dimension régionale, voire éventuellement nationale. Toujours est-il qu’aujourd’hui, du fait ou non de la bienveillance du pouvoir, les jeunes ont choisi de se réunir selon les modalités traditionnelles de ces jemaâs anciennes, qu’ils estiment encore constitutives de leur identité kabyle, et expressives des valeurs fraternelles et égalitaristes de leur culture.
Des assemblées populaires communales aux aârchs des « coordinations » actuelles
En fait, plusieurs structures dépassant le cadre strict du village existent aussi aujourd’hui. Il y a d’abord les APC, « assemblées populaires communales », structures administratives, comme dans l’Algérie tout entière, créées au lendemain de l’Indépendance selon les modalités des communes françaises. En Kabylie, elles regroupent un certain nombre de villages (d’une dizaine à une quarantaine) et leurs membres sont élus par l’ensemble des habitants de la commune. L’APC est dirigée par un président (on l’appelle volontiers « maire ») élu par les membres, et
son secrétaire est nommé par l’État. Le plus souvent, les élus représentent surtout les familles les plus importantes du territoire communal, et ce n’est qu’accessoirement qu’ils affichent l’étiquette de l’un des partis kabyles, comme le FFS ou le RCD, a fortiori celle des partis nationaux comme le FLN (Front de libération nationale) ou le récent gouvernemental RND (Rassemblement national démocratique). À noter l’absence quasi générale en Kabylie de votes favorables aux partis islamistes, spontanément interdits lors des précédentes élections municipales par
certaines jemaâs de Kabylie, sous peine de bannissement des coupables, comme j’ai pu l’observer sur place.
Mais, pour structurer leur mouvement de révolte, les jeunes, en ranimant les jemaâs , ont donc choisi de négliger la moderne organisation communale des APC. Et, au-delà des jemaâs , ils ont surtout été tentés par un système d’organisation traditionnelle –de dimension voisine de celle des actuelles APC– qui a eu effectivement quelque réalité dans le passé en regroupant plusieurs villages : ce sont les aârchs ou « tribus » ; les jeunes ont même choisi parfois des organisations plus
vastes encore sur le terrain, de nouvelles « coordinations d’ aârchs ». Il convient d’examiner de près ces anciennes structures auxquelles les jeunes ont choisi de se référer et qu’ils prétendent ranimer, afin d’en apprécier la validité politique dans les circonstances présentes.
Les structures politiques traditionnelles
En fait, l’ aârch ou laârch/aârach , « tribu » en berbère (pluriel arabe : aârouch ),
était bien autrefois une unité sociopolitique traditionnelle, composée d’un
ensemble de plusieurs villages voisins, aux intérêts politiques ou administratifs
solidaires. Comme la plupart des autres groupements sociaux de différentes
tailles, depuis la famille jusqu’à la confédération, l ’aârch était et est encore souvent
appelé par un nom qui le désigne comme l’ensemble des descendants d’un
même ancêtre, parenté beaucoup plus souvent fictive que réelle. Plus grand que le
village, puisqu’il en regroupait un certain nombre (jusqu’à une dizaine ou plus), l’ aârch était en revanche plus petit que la confédération ( qabila ou taqbilt ), dont à l’occasion il pouvait faire partie, qui regroupait de trois à éventuellement près de
vingt aârchs. Le territoire de l’aârch est encore reconnu aujourd’hui, mais ses frontières ont pu varier dans l’Histoire, incluant ou excluant tel ou tel village ou hameau, dont les habitants ont pu choisir de faire sécession ou changer de ralliement tribal.
Mais tandis que, dans le passé, le village a toujours été la seule structure
sociale communautaire vraiment permanente, avec son assemblée, la jemaâ , et ses chefs et responsables durables, l’ aârch n’était plutôt qu’une organisation relativement occasionnelle et temporaire (en cas de rivalité avec une tribu voisine ou de guerre contre l’étranger). Le plus souvent, il était dépourvu d’instance constante de concertation, ses réunions n’étaient décidées qu’au coup par coup et, surtout, il n’avait pas de chef permanent. Les hommes (toujours à l’exclusion des femmes)
des différents villages de l’a ârch ne se rassemblaient ainsi qu’occasionnellement,
lorsque des délibérations importantes pouvaient concerner plusieurs villages à la
fois, par exemple en cas de guerre contre un ennemi extérieur. À cette réunion de « tribu » constituée des représentants de chaque village, les décisions étaient prises
au consensus, comme à l’assemblée villageoise. De même que la plupart des autres structures sociales kabyles, l’ aârch était très souple, mais ses compétences, comme sa composition, pouvaient varier dans le temps. Dans la tradition historique, on a retenu des exemples de délibérations mémorables qui ont mobilisé la réunion de l’ aârch , voire, exceptionnellement, de la taqbilt (« confédération »), un
groupement de plusieurs aârchs (de trois à une vingtaine) ; ç’aurait été le cas par exemple pour décider de l’exhérédation des femmes (l’interdiction d’hériter) qui aurait eu lieu en 1748 chez les At Fraoucen, à Djemaâ Sahridj [Mahé, 2001] et en 1769-1770 chez les At Iraten [Boulifa, 1925]. Mais ni l’ aârch ni leur réunion en taqbilt , la « confédération » qui un temps coalisait un plus grand ensemble de villages, n’avaient de structure permanente, non plus que de conseil périodique, ni a fortiori de chefs stables. Aucune instance de concertation à périodicité régulière,
durable dans sa composition, sa fonction et sa direction, ne dépassait le cadre villageois de la jemaâ . Mais aujourd’hui, puisque le mouvement des jeunes prétend s’organiser dans le cadre de chaque aârch , il importe d’examiner quelle en était la réalité autrefois, et surtout avant la conquête coloniale.
Laârchs et confédérations dans le passé : une répartition inégale
Deux études de militaires, respectivement de 1848 (capitaine Carette) et 1872-1873 (général Hanoteau et A. Letourneux), ont détaillé les « tribus » et « confédérations » de Kabylie et évalué leurs populations, leur économie et leur importance
locale. Alors que la Kabylie n’a été conquise qu’à partir de 1857, le premier
auteur a cependant pu, près de dix années auparavant, établir son bilan à partir
d’enquêtes auprès d’informateurs. Quant aux seconds, ils ont publié après l’insurrection
kabyle de 1871 et eu accès à des premiers recensements, dont celui de
1866. Or, si les résultats des deux études diffèrent en de nombreux points, on peut
pourtant, à travers elles, se faire une idée de la répartition de ces formes d’organisations
sociopolitiques en Kabylie, ainsi que de leurs forces respectives, car les
évaluations sont souvent concordantes dans leurs rapports relatifs. À dire vrai,
plus que d’une évolution à plus de quelque vingt années d’écart, ces divergences
sont très révélatrices d’une caractéristique fondamentale de ces structures. C’est,
d’une part, la fluidité des découpages tribaux », par la décision de villages de se
rattacher tantôt à un aârch , tantôt à un autre, comme la mobilité consécutive des
définitions d’ aârch , et, d’autre part, l’instabilité des regroupements des aârchs eux-mêmes en « confédérations » comme l’appréciation que peuvent en avoir tant
l’observateur extérieur que les habitants eux-mêmes. Bref, ces variations sanctionnent
la mouvance d’une réalité changeante, instable. Il n’en reste pas moins
que, cette réserve faite, l’examen de ces deux bilans fait apparaître des points de
convergence intéressants. En effet, la répartition d’ensemble, par ordre de grandeur,
à commencer par les regroupements les plus nombreux, se révèle tout à fait similaire dans les deux observations. [40]
Leur examen permet de constater en quels emplacements se trouvaient localisées plus volontiers ces confédérations (voir carte ci-dessus).
Des regroupements en confédérations sur les marches au-dessus des plaines
Le plus important des regroupements nommés « confédération » est celui des Iflissen Mellil, qui aurait réuni pas moins de dix-neuf tribus de taille moyenne chez Carette (19 200 habitants en 1848, soit un peu plus de 1000 par tribu) et treize tribus pour Hanoteau et Letourneux (24 422 en 1873, soit un peu plus que 1800 personnes par tribu). [41] Mais, première caractéristique importante, ces tribus
sont émiettées en de très nombreux (cent sept) petits villages (230 habitants en moyenne, le plus grand de 1267 habitants, le plus petit de 24). En effet, deuxième particularité, les Iflissen Mellil sont situés à la plus grande proximité d’Alger, les premiers rencontrés depuis la capitale en direction de l’est. Dans cette partie la plus occidentale de la Kabylie, ils habitent les hauteurs d’un premier ensemble de moyenne montagne qui, entre les vallées du fleuve Isser, à l’ouest, et de la rivière Bougdoura, affluente du Sebaou, à l’est, domine les basses plaines et collines
entre les fleuves Sebaou et Isser, où passent à la fois deux routes qui les contournent : au nord celle d’Alger à Tizi-Ouzou, gardée par les bordjs [42] turcs de Menayel et de Sebaou, et, à leur flanc est, celle autrefois suivie par les Turcs d’Alger à Constantine par leur bordj de Boghni. Ils se sont ainsi trouvés postés en situation exposée de « gardiens des portes de la Kabylie ». Leur territoire, assez étendu, est peu élevé, arrosé par quatre rivières, et ils y ont produit un peu de blé et d’orge, de l’huile d’olive, des figues, des raisins secs, tout en complétant ces ressources agricoles
par l’artisanat (armurerie, orfèvrerie et tissage de la laine). Pourtant, peut-être est-ce en raison de la dangerosité de leur position d’avant-poste de la Kabylie que non seulement le territoire des Iflissen Mellil n’était pas très densément peuplé, dans des villages dispersés en petites unités, mais encore que, en conséquence, les tribus qui l’occupaient se sont réunies durablement en une seule confédération, dans une attitude de constante veille armée. En outre, s’ils avaient cependant quelques plaines dans le fond de leurs rivières ou sur quelques replats où ils cultivaient un peu de céréales, c’était en quantité très insuffisante pour leurs besoins, alors que les basses terres qui les bordent au nord, dans les vallées de l’Isser
et du Sebaou, étaient occupées par des tribus soumises aux Turcs (les Amrawa et les Issers). Leurs relations étaient conflictuelles avec ces voisins immédiats. En effet, les Iflissen Mellil, qui, eux, n’ont jamais payé d’impôt aux Turcs, étaient en état quasi constant de guerre avec les Amrawa et les Issers, chez lesquels ils descendaient fréquemment voler des bestiaux. Les Iflissen Mellil ont connu d’ailleurs au XIXe siècle une certaine célébrité grâce à l’une de leurs grandes familles, les Ben Zamoun, qui dominèrent la confédération et défrayèrent la chronique guerrière de la région.
Dans une position semblable de marche dominant immédiatement la plaine, au contact avec les incursions étrangères, se trouvaient encore situés quelques autres groupements kabyles qualifiés de confédérations, comme, sur la rive droite du Sebaou, à cheval sur la crête de la Kabylie maritime, les Aït Waguenoun, « confédération » de neuf « tribus » pour Hanoteau et Letourneux (11593 hab.), [43] et de « tribu » en sept « fractions » pour Carette (7800 hab.), soit un effectif peu dense,
semblable à celui des Iflissen Mellil, d’un peu plus d’un millier de personnes par tribu, dans de petits villages dispersés (173 habitants en moyenne, le plus grand peuplé de 1150 personnes, le plus petit de 16). Ces Kabyles occupent la partie occidentale de la chaîne de Kabylie maritime, une zone de moyenne montagne le long du littoral méditerranéen et sur le versant sud dominant la plaine du Sebaou, qui comporte, au nord, quelques plaines céréalières près du rivage, et quelques autres sur le versant sud de la chaîne maritime, qu’ils devaient disputer avec les Amrawa. Mais surtout, le territoire des Aït Waguenoun était traversé par une voie importante au temps des Turcs, qui le prenait en écharpe, depuis Dellys, sur la côte au nord-ouest, jusqu’à Tizi-Ouzou, au coeur de la plaine du Sebaou, au sudest.
Cet itinéraire était suivi par les Turcs pour ravitailler par mer jusqu’au port de Dellys leurs bordjs de Tizi-Ouzou et de Sebaou, d’où ils pouvaient surveiller la Grande Kabylie. Comme les Iflissen Mellil, les Aït Waguenoun se sont toujours refusés à payer l’impôt aux Turcs, qui leur réclamaient le passage pour leurs convois et s’étaient établis en voisins à leurs pieds, dans la plaine du Sebaou.
Dans cette plaine, les Turcs avaient en effet installé autour de leurs bordjs (Sebaou, Tizi-Ouzou, Menayel, entre autres) leurs colonies militaires ( zmoul ) ou milices maghzen [44] des Amrawa, groupements hétéroclites d’Arabes, de Noirs, de Kouloughlis (métis de Turcs) et de Kabyles transfuges, à leur solde (comptés 10000 en 1848 et 11855 en 1973).
Une autre confédération de Kabylie maritime se trouve aussi au contact de ces Amrawa de la plaine du Sebaou, mais plus éloignée sur les hauteurs de la partie orientale de la chaîne maritime, c’est celle des Aït Jennad (évalués à 12600 habitants en 1848 et à 15839 en 1873), concentrés en trois grosses tribus [45] (entre 4000 et 5000 personnes chacune) et en assez gros villages (de 300 habitants en moyenne en 1873). Leur territoire s’étend au long du versant exposé au sud, qui descend en pente douce depuis le tamgout des Aït Jennad, le sommet de la Kabylie maritime (1278 m), jusqu’à la large et basse vallée du Sebaou. Depuis leurs villages établis prudemment à l’abri en haut de la montagne, ils descendaient cultiver des céréales dans leur azaghar (« plaine ») d’amont. Ils avaient un marché réputé et très fréquenté par tous les Kabyles des environs et même d’outre-Sebaou, sur la crête, aux Agribs. Leurs démêlés avec les Turcs et leurs séides leur
avaient valu une réputation de « très guerriers » [Carette, 1848]. En effet, comme les Iflissen Mellil, et comme aussi les Aït Waguenoun, les Aït Jennad ont souvent été en lutte avec les Turcs, qui cherchaient à traverser leurs terres pour aller couper du bois de charpente de marine dans leurs forêts du tamgout . Mais, à l’abri dans la montagne, gardant autrefois, avec les Aït Waguenoun, l’accès à l’arsenal d’armes blanches des Iflissen Lebhar [Lacoste-Dujardin, 1997], leurs villages perchés ont résisté aux attaques.
Ces trois confédérations-ci (Iflissen Mellil, Aït Waguenoun et Aït Jennad)
avaient donc en commun une certaine proximité de l’ennemi turc, installé dans les plaines proches des fleuves ouvrant la montagne, et la nécessité de pouvoir se mobiliser rapidement contre le danger qu’ils représentaient. Cette conjoncture justifie sans doute leur cohésion durable en confédérations (ailleurs plus souvent occasionnelles, ou même inexistantes), en réponse à leur exposition à un danger proche et constant : les Turcs et Amrawa. Ainsi peut-on peut-être aussi rendre compte de la
relative modération de l’effectif moyen de leurs tribus, surtout chez les Iflissen Mellil et les Aït Wagenoun (1000 à 1700 en 1873), cependant plus fort chez les Aït Jennad (4000 à 5000 en 1873), plus loin d’Alger, à moindre exposition au danger. Cette hypothèse se vérifie pour d’autres confédérations dans la même situation en marge des plaines et des Turcs : ainsi en était-il des Igouchdal ou Guechtoula, [46] qui, au sud-est et en amont de leurs voisins Iflissen Mellil, habitent les hauteurs, certes plus élevées, mais entourant immédiatement le bassin de Boghni – Dra el-Mizan, longtemps tenu par les Turcs installés au bordj de Boghni (colonies zmoul ), [47] sur la route turque d’Alger à Constantine. Même structure en confédération, assez nombreuse (respectivement 16500 pour huit tribus en 1848, et 17060 pour neuf en 1873, soit environ 2000 par tribu), en villages de moyenne importance (416 habitants en moyenne). Ils occupent un territoire de montagne cependant plus sévère par le relief et le climat, mais davantage préservé que celui
des portes de Kabylie, tenues par les Iflissen Mellil, ou que celui des confédérations de Kabylie maritime (Aït Waguenoun et Aït Jennad), puisqu’en grande partie sur les pentes nord du Djurdjura, en amont des vallées de Boghni et de la rivière Bougdoura. Les Igouchdal sont déjà à une altitude telle que fréquents étaient chez certains d’entre eux les toits en terrasse, plus appropriée que les tuiles pour soutenir le poids de la neige en hiver. Montagnards d’altitude, vivant surtout d’arbres fruitiers, ils cultivaient cependant quelques céréales dans les fonds des rivières lorsqu’ils n’y étaient pas en conflit avec les tribus soumises aux Turcs. En
cas de déficit en céréales, ils complétaient, comme tous les autres montagnards, par la farine des glands du chêne à glands doux ( abelloud ).
Les fortes concentrations dans le massif Agawa
Ainsi, cette première approche des confédérations et des tribus conduit à
observer que plus on pénètre dans la montagne, plus la population des tribus et des villages augmente, si bien que la densité paraît croître en même temps que l’altitude (jusqu’à 1200 à 1500 m). Cette hypothèse se vérifie dans le massif Agawa, qui constitue le coeur de la Grande Kabylie. C’est dans ce massif refuge en effet que s’observent jusqu’à aujourd’hui les plus fortes densités de population, les plus grosses tribus et les plus gros villages aussi, au point que l’on a pu parler à leur sujet de petites villes (voir tableau à la fin).
En vérité, la délimitation de l’aire occupée par les Igawawen (ou Zouaouas en arabe) a toujours été, et est encore, objet de discussion. L’observation géographique imposerait pourtant la coïncidence entre « massif Agawa » et Igawawen, ceux-ci étant définis comme les habitants de celui-là. Il faut cependant tenir compte d’autres considérations. Hanoteau et Letourneux ont bien tenté de regrouper
deux confédérations sous cet intitulé plus large d’Igawawen, mais ils se sont bien gardés de définir cette forme de groupement. Ces auteurs de 1873 semblent avoir voulu ainsi mettre l’accent sur le fait que ces gens habitaient au coeur du massif Agawa. Ils ont donc regroupé sous cette appellation deux confédérations : celle des Aït Betroun et celle des Aït Mangellat, chacune occupant les hauteurs d’un même ensemble de reliefs au pied nord du Djurdjura, chaque unité de relief correspondant, comme partout ailleurs en Kabylie, à une tribu. Les Aït Betrun avaient un effectif de 19749 personnes et comprenaient quatre tribus [48], les Aït Mangellat en comptaient 14429 en pareillement quatre tribus [49] De sorte que chacune de ces tribus était forte de 5000 personnes chez les Aït Betrun et de 3600 chez les Aït Mangellat, dans des villages relativement voisins qui comptaient en moyenne 420 habitants. C’est en effet une forte concentration, une véritable nébuleuse urbaine, au point que le seul village d’Aït Lahsen des Aït Yenni, qui regroupait 1680 habitants en 1873, était de surcroît contigu avec deux autres villages (Taourirt Mimoun et Aït el-Arbaâ) en un ensemble cohérent désigné spécialement comme Tlata tuddar , « Trois villages » (3400 habitants en 1873). Ces gros villages, voisins et parfois même jointifs, couronnaient de leurs maisons en pierre à toit de tuiles rouges les crêtes qui descendent du sud au nord depuis le Djurdjura, entre de profonds ravins occupés par le maquis. Même concentration des villages et des laârchs sur le relief montagneux en face des Aït Yenni, de l’autre côté du ravin de la rivière Aïssi, en grosses tribus de 5000 habitants : chez les Aït Iraten [50] (19749 en cinq tribus en 1873, soit près de 4 000 habitants par tribu). Nous sommes bien là chez les industrieux Igawawen, aux terres si accidentées qu’elles ne sont guère favorables qu’à l’arboriculture complétée par l’artisanat et le commerce itinérant, souvent au long cours, l’émigration dans les villes du Maghreb (à présent en France). Parmi eux, les Aït Yenni sont célèbres pour leur orfèvrerie et leur armurerie, comme d’autres l’étaient aussi pour leurs tissages de laine (Aït Yahia) ou de lin (Aït Ghobri), etc.
En 1848, Carette citait un « canton des Zouaoua » ou « Gaouaoua », qu’il estimait établi sur les reliefs dans le bassin du haut Sebaou, autour des premiers cités ci-dessus (Aït Betroun et Aït Mangellat). Pour lui, il aurait compris vingt-deux tribus totalisant 94000 habitants : de gros effectifs tribaux puisque, en moyenne, 4000 personnes par tribu. Il a nommé les Aït Aïssi, voisins des Aït Yenni au nordouest, de l’autre côté de la rivière Aïssi, qui, en 1873, étaient donnés par Hanoteau et Letourneux pour une confédération de tribus (dépassant 2500 habitants chacune) [51]. Sur la foi de ses informateurs, Carette a cité encore d’autres tribus parmi les Igawawen, toutes situées sur le massif Agawa, comme, à l’est des Aït Fraoucen, les Aït Ghobri, Aït Bu Chaïb, Aït Idjer ou, plus au sud du massif, les Illoul Oumalou, Aït Itsoura et, plus à l’ouest, les Aït Aïssi, etc. Autrement dit, le capitaine Carette a considéré les Igawawen comme habitants du massif Agawa [52]. Et l’évaluation correspondante dans Hanoteau et Letourneux en 1873 indique une cinquantaine de tribus, qui auraient totalisé 148250 habitants, soit près de 3000 personnes par tribu : le massif Agawa a vraiment toujours été très densément peuplé !
Or, parmi ces dernières tribus, les divers auteurs ne notent que peu de confédérations. Sans doute peut-on penser que celles-ci étaient plus instables dans le massif Agawa que dans les marches, en fréquent état de guerre, où leur nécessité et leur permanence étaient plus grandes. Tandis que, dans ce refuge montagnard très densément peuplé, les querelles de voisinage et intestines prévalaient, envenimées par les difficiles conditions de vie : exiguïté des surfaces, raideur des pentes, pauvreté des ressources et densité de la population. Et c’est un fait que les conflits y étaient très fréquents, et que les aârchs eux-mêmes changeaient souvent de limites territoriales, selon la volonté de rattachement à l’une ou l’autre tribu proche décidée par la jemaâ de quelque village.
Nombre d’autres tribus, par exemple plus orientales, à proximité de Bejaïa, ou sur le versant sud du Djurdjura, dans la vallée du fleuve Sahel-Soummam, n’étaient pas regroupées en confédérations, et leurs limites n’étaient pas très stables [53]. Dans la montagne, ces tribus pouvaient selon les périodes être en instance
d’alliance éventuelle avec des confédérations proches ou, à l’opposé, en
conflit pour quelque motif circonstanciel. La flexibilité des regroupements autorisait toujours une grande souplesse.
Au demeurant, il faut bien constater l’instabilité des unités d’organisation traditionnelles dans la société kabyle, et les observations précédentes confirment le peu de fiabilité des formes, aârch ou « tribu » et a fortior i « confédération », qui dépassaient le cadre du village, seule unité véritablement stable et organisée politiquement par la jemaâ villageoise.
Les nouveaux aârouch ou les inadéquations de la tradition montagnarde
Au début du XXe siècle, l’administration coloniale avait innové en tentant
d’instituer en Kabylie différents groupements durables correspondant plus ou moins à l’ aârch ; ce fut par exemple un ensemble portant le nom arabe de douar , avec une assemblée et un chef responsable devant les autorités administratives françaises en matière de justice et de conflits. Il y eut aussi des « communes », les unes « mixtes », les autres « de plein exercice », puis des « centres municipaux ».
Si toutes ces différentes instances n’ont guère eu de réalité culturelle en montagne kabyle, en revanche elles ont contribué à brouiller les souvenirs et à entretenir une grande confusion.
Depuis l’Indépendance, les structures administratives algériennes sont donc
fondées sur les APC élues selon des principes démocratiques, et qui correspondent le plus souvent tantôt à des anciens aârchs , tantôt à des regroupements, voire à d’anciennes confédérations. Hocine Aït Ahmed, président du FFS, propose la moderne APC comme base d’organisation. Les APC sont incluses dans de modernes unités administratives, plus larges, stables, les daïras , de la taille de « cantons » (ou sous-préfectures), elles-mêmes regroupées, à une échelle voisine de celle de nos départements français, en wilaya s (ou préfectures). En Algérie, il n’existe pas d’organisation administrative régionale supérieure aux wilayas, et cette revendication d’une régionalisation dans l’État algérien est souvent avancée en Kabylie. Des jeunes –ou moins jeunes– réclament même une certaine autonomie, avec le « Mouvement pour l’autonomie de la Kabylie » (MAK), voire une indépendance de la Kabylie, pourtant dans l’incapacité de se suffire à elle-même. Mais ce mouvement est en 2002 très minoritaire.
Depuis 2001, les jeunes Kabyles en révolte ont voulu ranimer un genre d’instances traditionnelles, regroupant des villages sur la modalité tribale, sous le nom pluriel –arabisé– d’ aârouch , tandis que d’autres instances ont parfois été aussi désignées par le terme français et vague de « comités ». À l’occasion, des animateurs du mouvement ont tenté de fédérer ces aârch s en de plus grands ensembles, voire selon des unités administratives actuelles supérieures en taille pour l’ensemble de la Kabylie. Il y eut ainsi, un moment, des coordinations d’ aârchs par
daïras, puis par wilayas. Parmi d’autres, une « Coordination des aârchs , daïras et communes des wilayas de Kabylie » a été constituée. Ses « délégués » ont été désignés au coup par coup et les décisions y ont été prises par consensus. Diverses résolutions ont été proclamées par quelques-unes de ces instances. Des « platesformes » ont été mises au point au niveau de certaines wilayas. L’une d’entre elles
a été adoptée à Bejaïa (Bougie) par la « Coordination intercommunale de Bejaïa » (CICB), mais une autre est plus connue, celle qui a été signée le 11 juin 2001 dans une petite ville de la vallée de la Soummam : la « plate-forme d’El Kseur » par la « Coordination des aârchs , daïras et communes de Tizi-Ouzou » (CADC-Tizi-Ouzou). Sa base de revendications « non négociables » réclame du gouvernement algérien, entre autres : la « reconnaissance identitaire, civilisationnelle, linguistique et culturelle amazigh », le « départ immédiat » des gendarmes nationaux de Kabylie,des sanctions contre les militaires coupables d’exactions, la libération des jeunes incarcérés, un statut régionalisé en Kabylie et la « mise sous l’autorité effective des instances démocratiques élues de toutes les fonctions exécutives de l’État ainsi que des corps de sécurité ». Certaines de ces demandes sont, on s’en doute, jugées irrecevables par le gouvernement. L’on se trouve désormais dans une impasse.
Or les tentatives d’organisation de ce mouvement portent en réalité les stigmates d’une tradition dépassée et méconnue, la seule durablement organisée, celle des jemaâs , qui n’avaient de véritable existence qu’à l’échelle des villages. En effet, en l’absence de féodalité, les Kabyles sont toujours restés armés, et le plus souvent opposés entre eux dans de permanentes rivalités entre communautés villageoises, en état de guerre quasi constante, rendant impossible leur union durable, excepté devant l’ennemi commun [54]. Leurs structures collectives étaient fondées sur l’idéologie traditionnelle, égalitariste et anti-individualiste de la parenté, et les montagnards kabyles étaient en proie à un permanent souci de se prémunir contre l’accaparement du pouvoir par l’un d’entre eux. Les jeunes, aujourd’hui lancés dans le mouvement de protestation contre l’État algérien, préfèrent ainsi la collégialité et, comme dans les jemaâs , des décisions par consensus à des votes démocratiques, une structuration temporaire, au coup par coup, comme dans les aârchs , et, par suite, sans aucune stabilité ni possibilité d’action durable. L’égalitarisme est si farouchement voulu qu’il reproduit certes des « directions tournantes » des mouvements, mais la rançon en est d’empêcher l’émergence de personnalités responsables capables de devenir des cadres susceptibles d’agir dans la cohérence et la durée. Dans ces conditions, il est bien difficile de rallier de plus grands nombres de Kabyles ou d’Algériens, car les structures sont inadaptées aux échelles régionale ou nationale. Le mouvement est de surcroît victime de nombreuses querelles et de dissensions, certaines au sein de la région avec les partis présents en Kabylie, comme le FFS et le RCD, mais beaucoup d’autres intestines, ce qui ne laisse pas présager un sursaut organisationnel cohérent, non plus que le développement de ce mouvement à de plus grands ensembles territoriaux.
Face à cette situation, le gouvernement algérien a beau jeu de temporiser,
consentant en apparence à satisfaire partiellement, et de temps à autre, l’une des revendications exprimées par les jeunes. C’est ainsi qu’un statut officiel a été accordé à la langue tamazight (berbère) parlée en Kabylie, mais la mise en oeuvre pratique de ce statut n’a pas suivi : les modalités d’enseignement, la qualification des professeurs, voire l’alphabet employé pour cette langue orale n’ont pas encore été définis, et les mouvements kabyles n’ont pas non plus exploité cette première victoire. C’est encore ainsi que le président Bouteflika a fini par gracier et libérer les détenus kabyles, condition posée par les jeunes pour ne pas boycotter les élections
locales prévues pour le 10 octobre 2002, alors que par ailleurs ils condamnent le FFS d’envisager d’y participer. Dans ces conditions, le mouvement est peut-être même en train de perdre une partie de son audience parmi les montagnards de Kabylie, lassés par l’agitation durable dans un « sentiment général de ras-le-bol de la population sur la stratégie jusque-là suivie par les âarchs » (algeriainterface AFP, Alger, 6 août 2002). Il semble bien que, sauf sursaut, « aucune issue ne se profile » et que, « à moins d’un retournement de situation spectaculaire qui verrait le mouvement des aârchs entrer dans le rang, la Kabylie devrait encore boycotter ce scrutin et accentuer la situation de pourrissement » (2 août 2002, www.algeria-interface.com).
La tradition montagnarde, si elle a longtemps fait la force des Kabyles, grâce à une idéologie profondément égalitariste et solidaire entre villageois sur le modèle de la parenté, grâce à une efficace capacité de résistance appuyée sur un nombre important d’hommes, un farouche esprit d’indépendance et une promptitude à la coalition temporaire contre les ennemis extérieurs, fait aujourd’hui la faiblesse de ce mouvement des jeunes. Car cette tradition les laisse prisonniers d’une cohésion restreinte, qui se traduit par une certaine inaptitude à une organisation durable et
cohérente, une incapacité à dépasser les rivalités, les dissensions, dans l’obsession d’empêcher l’émergence de fortes individualités à qui il faudrait confier des responsabilités, et donc un certain pouvoir. Si les jeunes Kabyles apparaissent encore comme le fer de lance de la protestation en Algérie, il est à craindre que le mouvement, enfermé dans une tradition kabyle non modernisée, n’échoue à trouver un écho plus large dans la nation algérienne, par défaut d’organisation responsable, structurée et durable.
Bibliographie
BOULIFA S. A., javascript:barre_raccourci(’’,’’,document.getElementById(’text_area’)) Le Djurdjura à travers l’histoire. Organisation et indépendance des Zouaoua , Brigau, Alger, 1925, 407 p.
CARETTE E. (capitaine), Études sur la Kabylie proprement dite (exploration scientifique de l’Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842), 2 vol., Imprimerie nationale, Paris, 1948.
HANOTEAU A. (général) et LETOURNEUX A., La Kabylie et les coutumes kabyles , Imprimerie nationale, Paris, 3 vol., 1872-1873.
LACOSTE-DUJARDIN Camille, Le Conte kabyle. Étude ethnologique , François Maspero, Paris, 1970, 534 p., 2e éd. La Découverte-Bouchène, Alger-Paris, 1991.
- « Changement et mutation dans quelques rites paysans dans l’Algérie nouvelle », L’Autre et l’ailleurs (hommage à Roger Bastide ), Berger-Levrault, Paris, 1976, p. 398-415.
- Opération « Oiseau bleu ». Des Kabyles, des ethnologues et la guerre d’Algérie , La Découverte, Paris, 1997, 308 p.
- « La montagne pour les Kabyles : représentations et réalités », Montagnes méditerranéennes (La montagne et le savoir) , n° 12, 2000, p. 95-100.
- « Géographie culturelle et géopolitique en Kabylie », Hérodote, n° 103, 2001, p. 57-91, article si-dessus.
MAHÉ Alain, Histoire de la Grande Kabylie XIXe-XXe siècles. Anthropologie historique du lien social dans les communautés villageoises, Bouchène, Paris, 2001, 650 p.
Site http://www.algeria-interface.com, 27 juin 2002, DAHO Djarbal, « La révolte par l’émeute ou le “péril jeune” » ; et dépêches des 21 juillet 2002, 26 juillet 2002, 31 juillet
2002, 1er août 2002, 9 août 2002, entre autres.
TABLEAU DES PRINCIPALES TRIBUS, VILLAGES ET POPULATION
ESTIMÉE EN 1873 (D’APRÈS HANOTEAU ET LETOURNEUX, 1873)
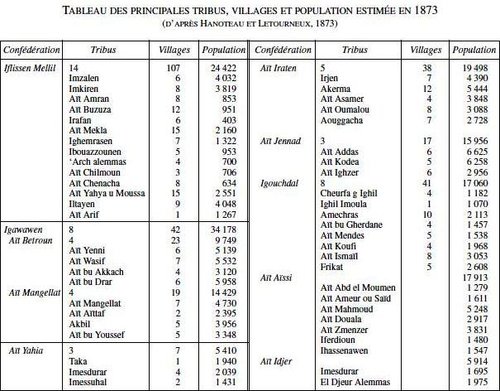
SUITE :
TABLEAU DES PRINCIPALES TRIBUS, VILLAGES ET POPULATION
ESTIMÉE EN 1873 (D’APRÈS HANOTEAU ET LETOURNEUX, 1873)
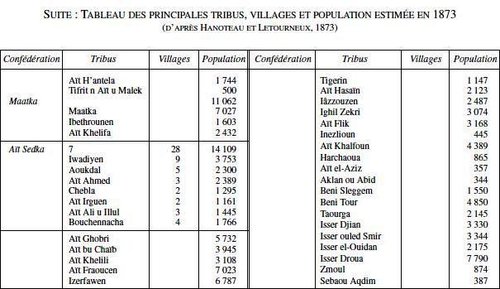
[1] Ethnologue, CNRS.
[2] Le Figaro, Le Monde, Le Monde diplomatique, La Croix, Le Nouvel Observateur, Libération,
juin, juillet et début août 2001.
[3] Le u se prononce « ou », le c « ch », soit « oulach smah ».
[4] Les spécificités de l’islam kabyle seront envisagées plus loin
[5] Le roi Mohammed VI a annoncé, le 30 juillet 2001, la création d’un futur Institut royal pour la culture amazigh qui devrait « élaborer et préparer l’intégration de la langue amazigh dans l’enseignement marocain ».
[6] On le verra plus loin, le berbère parlé par les montagnards sédentaires du nord du Maghreb n’a pas d’écriture propre, les Berbères marocains le transcrivent depuis longtemps en caractères arabes, les Kabyles l’écrivent en caractères latins. En revanche, les nomades sahariens, les Touareg, ont leur alphabet propre, le tifinagh.
[7] On trouvera plus de détails sur la géographie, l’histoire et l’anthropologie de ce groupement tribal dans LACOSTE-DUJARDIN, Opération « Oiseau bleu », La Découverte, Paris, 1997, p. 223.
[8] Dans beaucoup de villages de Kabylie, en 1970, presque la moitié des femmes étaient veuves. Le déficit en hommes atteignait, en 1971, 6% en Kabylie, contre 2% pour toute l’Algérie [LACOSTE-DUJARDIN, 1976a
[9] En Kabylie, on parle encore de « l’autre guerre », celle qui a suivi l’indépendance, en 1963
[10] Alors que d’autres cultures orales, comme en Afrique noire par exemple, réservent une partie de cette mémorisation à des serviteurs du pouvoir, les griots, les Kabyles, fidèles à leur idéologie égalitariste, font confiance à la mémoire de l’ensemble des hommes siégeant à la Jemaâ
[11] Même si, aujourd’hui au Niger, où la tamazight est une des langues officiellement reconnues, des journaux sont écrits en tamazight avec les caractères tifinagh.
[12] Engagés par le dey d’Alger ou le bey de Tunis, deux villes qui possédaient des quartiers kabyles, ils étaient chargés de châtier les révoltes des janissaires.
[13] Le Dr Driss Mammeri (1962) a avancé le terme de « synoecisme », préludant à la « polis ».
[14] En 1930, cinq cent cinquante instituteurs étaient originaires de Kabylie [COLONNA, 1975].
[15] Encore les premières campagnes publicitaires furent-elles caricaturales, au point de faire
croire que l’on ne souhaitait pas qu’elles soient comprises par les femmes, dont très peu conduisent : ainsi, la première affiche représentait le signal routier d’un stop, avec, sur une pente excessive, une voiture d’enfant... inconnue en Algérie, où les bébés sont portés par leurs mères : le dessinateur, sans doute cinéphile, avait dû s’inspirer du fameux escalier du film d’Einsenstein Le Cuirassé Potemkine !
[16] Une famille « bien » est celle dont les membres mangent de la viande deux fois par semaine.
[17] C’est ce que rapporte CARETTE [1848, t. II, p. 328] d’un laboureur et commerçant des Aït Ourlis du versant sud du Djurdjura, qui aurait ainsi stocké 55 000 l d’huile, cinq maisons emplies de figues sèches, trois d’olives et une grosse somme d’argent, en dépit des aumônes qu’il distribuait
[18] Qui, pourtant, n’a pas eu de descendants mâles, et une seule fille, Fatima, qui, avec son époux Ali, est à l’origine du chi’isme (comme en Iran).
[19] Bou Qobrin veut dire « aux deux tombeaux », l’autre étant à Alger.
[20] Les ouvriers du fer, forgerons et armuriers, jouissent en Kabylie d’un statut particulier, ils sont admirés et redoutés pour leur aptitude à maîtriser les éléments : eau, air, feu.
[21] Le Code de la famille algérien, appelé par les femmes le « code de la honte », maintient leur assujettissement aux hommes, en en faisant d’éternelles mineures.
[22] D’après l’article signé Yassin TEMLALI sur http//www.algeria-interface.com
[23] On dirait plus exactement tamheqranit en kabyle, d’une racine arabe HQR : iheqqer , « il méprise », qui a pu prendre aussi cette forme hogra
[24] Les salafistes se veulent réformateurs de l’islam et sont partisans d’un retour à la religion des origines.
[25] Le Monde, 9-10 septembre 2001.
[26] Quelques isolés tentent cependant de parler d’« autonomie ».
[27] Mohammed Touati et Mohammed Mediene sont de Kabylie et Khaled Nezzar est originaire de l’Aurès.
[28] Des manifestations ont eu lieu dans l’Est, à Khenchela, Tebessa Guelma, Constantine, Collo, Sétif, Annaba, Skikda, et dans le Sud à Biskra, Batna, M’sila, Ain Mlila, Sour El-Ghozlan.
[29] « Géographie culturelle et géopolitique en Kabylie », p. 57-91 ?voir article ci-dessus.
[30] Même si certains d’entre eux, comme des groupes armés du GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat, de Hassan Hattab), peuvent trouver refuge dans quelques maquis de Kabylie (Dra el-Mizan, Mizrana, Bouïra).
[31] Voir la carte ci-dessous
[32] Dont on connaît un autre exemple en milieu méditerranéen : celui des roches Cyanées ou Symplégades dans le Pont-Euxin : deux rochers qui, se heurtant, ont entravé le passage de Jason et des Argonautes.
[33] Aujourd’hui, des islamistes s’y cachent parfois, comme récemment dans le gouffre d’Affourou, dans l’Haïzer.
[34] Au col de Tizi Berth, où Sidi Mansour, Sidi Ahmed u Driss, Sidi Ahmed u Malek et Sidi ‘Abderrhamane el Yaluli séjournèrent dans une grotte encore fréquentée par les pèlerins.
[35] Aujourd’hui, des immeubles à plusieurs étages couverts de tuiles mécaniques ont remplacé les maisons anciennes en pierre.
[36] La révolte de 1871, en grande partie menée par les Kabyles, dissuada de s’installer à leur voisinage.
[37] C’est la représentation voulue car, en réalité, le nombre de parts prises par chaque chef de famille, la mise aux enchères de la dépouille et de la tête, la contribution de chacun à la caisse collective sont moins égaux qu’il n’est donné à voir [Lacoste-Dujardin, 2001].
[38] Même si, dans la réalité masquée, la hiérarchie du village est par ce rite réinstituée [Lacoste-Dujardin, 1976].
[39] Le qadi est celui qui est chargé de dire la loi.
[40] Je me suis fondée le plus souvent sur les évaluations les plus récentes, de Hanoteau et Letourneux [1873], tout comme l’a fait aussi Alain Mahé [2001, p. 75-78].
[41] Tribus : Mzala, At Mekla, Mkira, Rouafa, Azazna, Chilmoun, At Rouba, At Amran, At Chenacha, Iltaïen, Yahya ou Moussa, At Bouzouza, Irafan. Voir tableau à la fin de l’article.
[42] Bordj : fort turc souvent installé dans les plaines et ponctuant leurs voies de communication à travers l’Algérie.
[43] Attouch, At Sidi Hamza, At Saïd, Yaskren, At Msellem, Istiten, Cheurfa, Aâfir et At Aïssa Mimoun.
[44] Tribus maghzen et zmoul : sortes de colonies fondées par les Turcs autour de leurs bordjs, qu’ils mobilisaient à l’occasion, car ces volontaires, Arabes, Noirs et Kabyles transfuges, leur devaient le service, armé et monté, moyennant un fusil, un cheval et des terres de labour dans la plaine ; les zmoul étaient soldats dans les bordjs.
[45] Tribus : Aït el-Ader, Aït Ir’zer, Aït Keda.
[46] Tribus : Cheurfa g Ir’il, Ir’il Imoula, Mechras, Aït bu Adu, Aït bu R’erdane, Aït Mendes, Aït Koufi, Aït Smaïl, Frikat.
[47] voir note précédente, Attouch, At Sidi Hamza, At Saïd, Yaskren, At Msellem, Istiten, Cheurfa, Aâfir et At Aïssa Mimoun.
[48] At Yenni, At Wassif, At Bu Akkach et At Bu Drar.
[49] At Mangellat proprement dits, At Attaf, Akbil, At Bu Youssef.
[50] Irjen, Akerma, At Ousammer (« adret »), At Oumalou (« ubac »), Awggacha.
[51] Aït Abd el-Moumen, Aït Ameur ou Faïd, Aït Mahmoud, Aït Douala, Aït Zmenzer, Iferdioun et Ihassenawen.
[52] Même si l’on ne peut vraiment dire si le massif a donné son nom aux hommes ou l’inverse.
[53] Aït Yala, Mechdala, Aït Ouakour, Aït Mellikech, Aït Amar, Aït Our’lis, Fenaïa, Mzala, Mezzaïa, entre autres.
[54] Il y eut bien quelques potentats locaux comme les Belqadi à Kouko et les Ben Zamoun aux Iflissen Mellil, mais ils n’ont jamais possédé de très grandes propriétés et n’ont pas désarmé les paysans.
