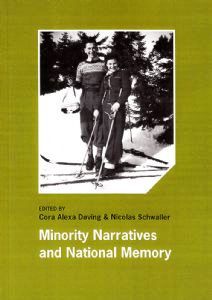Accueil > TRIBUNES, ACTIVITÉS, LECTURES > LECTURES - MARS 2011
LECTURES - MARS 2011
mercredi 23 mars 2011
“MINORITY NARRATIVES AND NATIONAL MEMORY” Cora Alexa Døving, Nicolas Schwaller (édit.), Oslo, Unipub, 2010, 223 p.
"LES SOCIÉTÉS ARABES SONT SORTIES DE LEUR REPLI" - ENTRETIEN AVEC YOUSSEF COURBAGE.
"SAMIR AMIN, L’INTELLECTUEL EN ACTION", article de YASSINE TEMLALI, Bablemed.net, le 31 janvier 2011.
EL QACBA , ZEMÂM de KADDOUR M’HAMSADFJI - Promenade et redécouverte de la Casbah d’Alger, par ABDERRAHMANE ZAKAD
MINORITY NARRATIVES AND NATIONAL MEMORY
Cora Alexa Døving, Nicolas Schwaller (édit.),
Oslo, Unipub, 2010, 223 p.
Ce livre est issu d’un colloque organisé à Oslo en mai 2008 par le Centre pour les Études de l’Holocauste et des Minorités Religieuses dirigé par Odd-Bjørn Fure, et le Centre Alberto Ben-veniste de l’École Pratique des Hautes Études sous l’impulsion d’Esther Benbassa – elle avait organisé en 2007 à Paris, à l’EPHE, une première rencontre sur l’histoire des minorités.
Le colloque d’Oslo avait pour thème « Comment intégrer les récits minoritaires dans une mémoire nationale ».
Seize auteurs se sont partagé les communications, majoritairement des doctorants et cher-cheurs de Norvège, de France et d’Italie.
Après un avant-propos d’Esther Benbassa qui expose méthodiquement la problématique du livre, l’introduction, due à ses deux directeurs, Cora Alexa Døving et Nicolas Schwaller, évoque l’approche pluridisciplinaire du concept de minorité dans les États-nations où les minorités ont été en récurrence inquiétées comme facteurs d’instabilité avec parfois les aboutissements tragiques que l’on sait – la Shoah, et autres drames.
La recherche, et des engagements politiques nouveaux, ont fait évoluer les choses durant les trois dernières décennies. La question des minorités est de plus en plus tenue pour une compo-sante des rapports humains et des histoires nationales dans des pays bien différents – la Nor-vège, la France.
Mais existent encore bien des blocages – il n’a ainsi pas été possible de remédier à l’irrémédiable dans l’ex-Yougoslavie.
Le livre est organisé en trois parties ; la première traite de l’approche théorique. Gaëlle Le Dref, Andrea Brazzoduro et Knut Kjelstadli s’y interrogent respectivement sur les notions de minorité et de majorité, tous deux résultats de constructions politiques proscrivant la mixité, appuyées sur l’évolutionnisme, l’hygiénisme, l’eugénisme, le darwinisme… ; « comment décoloniser la pensée historique » en passant à une « histoire mineure » quand c’est sous l’égide des majorités qu’a été fabriqué ce qui est déclaré d’importance mineure ; et, avec le cas de la Norvège, sur les critères de définition des minorités – proportion de la population, provenance extérieure, date d’apparition dans l’espace national – qui inventent ces minorités.
Dans la deuxième partie sur le conflit de représentation, quatre études sont consacrées aux Juifs, dont trois à la Norvège.
La contribution de Claudia Lenz analyse le traitement longtemps stigmatisant des « servantes des Allemands » ayant eu en Norvège des relations avec les envahisseurs. Stimulante, sa réflexion sur l’effroi non dit des pourfendeurs : le risque de perdre le contrôle sur la capacité de reproduction des femmes.
Elisabeth Eide étudie scrupuleusement la petite minorité juive de Norvège : en réponse à la vieille question « Qu’est-ce qu’un Norvégien » ?, l’apaisement est aujourd’hui de rigueur et les Juifs se proclament « Norvégiens, c’est tout » ! Et pourtant, il y a eu des drames – l’occupation, l’exil en Suède, avec ce paroxysme du meurtre d’un couple de Juifs, les Feldmann, assassinés et dépouillés en 1942 par deux guides norvégiens chargés de leur faire passer la frontière – en 1947, ne fut infligée aux deux passeurs qu’une peine minimale.
Le thème de recherche d’Irene Levin concerne les Juifs norvégiens depuis la IIe guerre : soucieux de ne pas se faire remarquer, de trouver place parmi les « bons Norvégiens » plutôt que parmi les « mauvais », ils ont été indemnisés de la confiscation de leurs biens et leur intégration est désormais accomplie parmi les « BN » – mais même des bons peuvent s’avérer moins bons que prévu.
Plus largement, mu par de belles intentions, Joël Kotek traite de comment transmettre la mé-moire de la Shoah d’une manière universelle.
Deux études, ensuite, sur des Musulmans : celle, originale, de Sindre Bangstad met en lumière le cas des musulmans d’Afrique du Sud pendant la lutte anti-apartheid – le Muslim Judicial Council a déclaré en 1960 l’apartheid contraire à l’Islam au moment où est mort en prison le premier shahîd, l’immam Haron – ces Musulmans ont depuis entrepris de réécrire leur histoire.
Vincent Geisser, compte tenu du passé colonial français, de l’idéologie assimilassionniste et de l’idéal de tolérance, situe la place de l’islam en France entre récits minoritaire et majoritaire. S’il n’y a pas eu de pogroms anti-musulmans en France, l’islamophobie s’y est accusée depuis le 11 septembre, avec les profanations et la campagne contre le voile, instrumentalisée comme chacun sait. On sera assez d’accord avec son idée d’une minorité musulmane comme création républicaine, séculariste et laïciste. Un utile parallèle est fait avec d’autres pays d’Europe – Royaume Uni, Pays-Bas, Espagne – où les politiques sont différentes mais où l’évolution récente a été relativement voisine, mais avec, en 2004, l’assassinat de Theo Van Gogh et les attentats de Madrid.
Enfin, avec Elisabeth Cassina Wolf, voici un tout autre type de « minorité », provenant d’une majorité politique déchue : après la chute de la République de Salò et les purges, les fascistes italiens se regroupent dans le MSI de Giorio Almirante. Paradoxe d’une identité originellement illégitime dans la République : il invente une troisième voie politique et devient un interlocuteur politique.
La troisième et dernière partie concerne le recadrage de l’histoire des minorités dans l’enseignement. Trois auteurs évoquent d’abord le cas français, un l’Allemagne, un autre la Nor-vège, un dernier la Croatie.
Nicolas Schwaller étudie le traitement de Vichy et de l’holocauste dans les manuels d’histoire français. Longtemps refoulé par le mythe résistantialiste, il se fait jour avec les livres révélateurs de Paxton et de Hilberg, il est abordé sans fard avec des campagnes comme celle de Serge Klarsfeld lors du procès Barbie. D’où une prise en mains de ces questions par des historiens français et une évolution salutaire dans les manuels d’histoire.
Sandrine Lemaire et Aurélie Dulin abordent l’enseignement de la colonisation et de l’immigration à l’école. Après le long ressassement consensuel sur la question coloniale, après les silences et les carences, et à cause d’eux, la rupture se produit dans les années 80 dans un pays où l’école est, alors, réputée être pièce maîtresse de « l’intégration ».
Sébastien Ledoux se penche sur la mémoire de l’esclavage dans l’espace national et l’enseignement de l’esclavage en France. La aussi, évolution dans les années 80, la parole est donnée aux écrivains antillais – Chamoiseau, Glissant, Confiant. Importante, aussi, la commémoration en 1998 du 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage. Des manifestations ont cependant lieu en Guadeloupe pour protester contre ce processus de « métropolisation de la mémoire d’outre-mer de l’esclavage » qui aboutit à la loi Taubira en 2001 et à la refonte des manuels en 2009.
Comment « modeler une identité musulmane allemande » est le propos de Margrete Søvik à partir d’une enquête dans le Land de Rhénanie-Palatinat. Dans l’approche libérale, l’intégration est recherchée par communautés, et non l’assimilation, en mettant à l’école sur le même pied que les autres religions l’enseignement de l’Islam. Le dialogue avec les associations musulmanes n’est pas absent, mais, non sans susciter des réponses de ces dernières : c’est bien pour damer le pion à ce qui pourrait être un rôle exclusif de leur part que le Land se préoccupe depuis le début des années 1990 de faire entrer un Islam BCBG à l’école – par exemple l’acception sur laquelle on insiste à propos du jihâd, c’est non al-jihâd al-asghar (le plus petit jihâd : la guere sainte) mais al-jihâd al-akbar (le plus grand jihâd : l’effort intérieur pour la foi).
Dans son texte « nous n’avons rien contre les homosexuels », avec un sens critique aigu, Åse Røthing commente la construction des « non-hétérosexuels » comme des « autres acceptables » en Norvège. Acceptables, mais autres. L’éducation anti-oppressive norvégienne apprend ainsi à faire avec l’autre ; l’ « homotolérance » y équivaut ainsi à une « hétéronormativité ».
Enfin, Øyvind Hvenekilde Seim traite des manuels croates, en rapport avec la présidence, dans les années 1990, de Franjo Tudman. Les manuels ne mentionnent pas les massacres de Serbes de la IIe guerre commis par les Oustachis d’Ante Pavelić. Ils ne nient pas les massacres de Juifs, mais pour les Serbes, ils restent dans le vague : « Des gens et des enfants innocents furent tués »... La Croatie aurait-elle été en Europe l’oubliée des attentions de l’ONU protectrices des minorités ? Les Serbes, acculés à l’exil en 1991, ne forment plus aujourd’hui que 4,5% % de la population de la Croatie alors qu’ils en ont représenté jusqu’à 30%. Est mise en cause la carence de culture démocratique en Croatie et sont faites quelques propositions de bon sens pour reconstruire une histoire laissant leur place aux Serbes, tenant compte des récits serbes.
Ce livre fort, assemblage de textes denses, ne se lit pas d’une traite.
On est fasciné par la culture et les références de plusieurs auteurs, même si l’on a parfois l’impression que tel(le) ou tel(le) veut tout dire de ses notes de lecture, ou que tel(le) autre tourne un peu en rond, qu’ici et là la description peut l’emporter sur l’analyse.
Nonobstant ses apports, Vincent Geisser n’a pas mentionné la dureté de la sanglante conquête française de l’Algérie, et non plus la non-application de la loi de 1905 en Algérie, avec Islam sous contrôle et agents du culte fonctionnarisés ; et quid du passé antérieur religieux de la Grande Bretagne, comparé à la France ? Et on permettra de rester sceptique sur l’intangibilité généralisée de la « schizophrénie républicaine chez les élites françaises » – il y a élites et élites ; de même qu’il est exagéré d’affirmer tout à trac que « les médias français, les leaders politiques, les intellectuels tendent à islamiser tout phénomène social ». Se départir ainsi du sens des nuances sans dialectiser ne comporte-t-il pas le risque de ne pas prendre en compte la complexité des situations et d’attiser le facilement attisable ? Et ce n’est ni être bourrin marxiste ni althussérien fervent de rappeler que les mutations et la crise du capitalisme, telle qu’elles ont été étudiées par l’économiste Ahmed Henni, ne sont non pas pour rien dans une islamophobie, aussi construite politiquement en dérivatif.
Chez Claudia Lenz, l’ « ethnique » tend à prendre le pas sur la dimension sociale et idéo-logique ; surprennent des formules comme « l a nation et les autres communautés ethniques ».
Quant à Joël Kotek, est-il raisonnable de prêcher un enseignement universel digne de la Shoah sans dire, aussi, que seule une solution politique digne de ce nom du conflit Israël-Palestine sera le paramètre indispensable pour porter apaisement ? Étonnante, aussi, le syntagme de « tendance non-juive » opposé à une « tendance juive ». Qu’apporte une telle essentialisation réductrice ?
Sur d’autres points : les esclaves furent-ils une « minorité » ?
Et l’étude des manuels français sur la colonisation gagnerait à être étayée par une étude comparative, par exemple, des manuels algériens ou marocains.
Enfin – remarque et non reproche –, il y a bien d’autres cas de minorités, à commencer par ces minorités linguistiques de l’hexagone français – au recensement de 1921, sur 39 000 habitants, il y avait en France 12 à 13 millions d’occitanophones – soit près du tiers de la population. Et si l’on ajoute les Bretons bretonnants, les Flamands, les Alsaciens et les Basques, n’arriverait-on pas à poser les francophones naturels comme une majorité guère écrasante ? Et dans le roman national français, la Marseillaise a été chantée pour la première fois à Strasbourg, ville germa-nophone, puis reprise par les volontaires de Marseille, ville occitanophone.
Et d’autres chantiers sont à explorer : les francophones de Suisse, ses italophones, les Romanches ; ou les Vaudois (Valedsi) du Haut Piémont, les Catalans, les Basques… et les berbérophones d’Afrique du Nord, du Maroc à l’oasis de Siwa, en Égypte.
Enfin, ce livre est écrit en anglais, langue native évidemment minoritaire dans le monde, mais devenue le bien commun de la majorité.
Sur un autre plan, ce n’est en rien enlever ses qualités de regretter qu’il ne comporte aucune conclusion – c’est bien souvent le lot des actes de colloques qui mettent bout à bout des communications – et que l’analyse l’emporte de beaucoup sur la synthèse.
Il n’y a ni table des matières, ni index, ni bibliographie d’ensemble.
Cela n’enlève rien au fait qu’on ne boude pas son plaisir à lire ce livre, neuf et instructif, qui sort des sentiers battus.
Les auteurs sont jeunes pour la plupart, ils ont pour qualité commune de n’être pas repliés sur leurs pré-carrés nationaux respectifs. Ils illustrent ce que peut être une séduisante mondialisation.
Gilbert Meynier
retour en haut de page

Le huit du mois de mars
On ne pense jamais
Ou presque
À celles qui s’en furent
Pour un jour revenir
Nous parler à flots libres
De l’envers du décor…
Elle est restée solaire
Ma fille
Face aux rictus haineux
De ses bourreaux hideux
Ravisseurs de ses dix sept printemps
De sève généreuse
Et de sillons fertiles
Pour entrouvrir l’aurore
D’une Algérie
De voilures
Débordant l’horizon
Et l’envers du décor
1
Elle est restée lumière
Sur leur obscurité
Intolérante et crasse
Elle s’est toute élevée
Au sommet de sa Grâce
2
Elle est restée
Si fine
Face à leurs mains immondes
Aux prières assassines
De nains
D’un autre monde…
Elle est restée bien grande
Pour parler de cet avenir
Par son sang arrosé
3
Elle est restée si belle
Elle qui aimait la vie
Pour refuser
Tête haute
Le voile de l’infamie
Dont se parent aujourd’hui
Les femmes
De mon peuple asservi
4
Tu es partie sereine
Tu es partie sans haine
Dans la lumière des Cieux
Désertés ce jour là
Par ce dieu
Qui en son nom
A permis l’outrage
de folles déraisons !
5
Elle est partie si belle
Que les anges ont pleuré…
Elle est partie rebelle
Pour refuser
Tête haute
Le voile de l’infamie
Dont se couvrent aujourd’hui
Les femmes insoumises
De mon peuple asservi. ¡…
Elle est partie si belle
Que l’Algérie entière
en a tant et tant pleuré !
En hommage à Katia Bengana
retour en haut de page
ENTRETIEN AVEC YOUSSEF COURBAGE :
« LES SOCIÉTÉS ARABES SONT SORTIES DE LEUR REPLI »

ENTRETIEN

Youssef Courbage, démographe, coauteur avec Emmanuel Todd d’un essai sur l’évolution des sociétés arabes (“Le rendez-vous des civilisations”. Seuil), analyse les ressorts profonds des révoltes actuelles.
TC : Avez-vous été surpris par ces mouvements de révolte dans le monde arabe ?
Youssef Courbage : J’ai été surpris par le fait que cela se passe maintenant et que ce soit la Tunisie qui mette le feu aux poudres. Néanmoins, cela devait arriver. D’après les analyses que j’ai développées avec Emmanuel Todd, le processus qui s’est déroulé en Europe à partir du XVIIe siècle puis qui s’est généralisé au monde entier – la Chine de 1949, la Russie de 1905 et de 1917 – ne pouvait épargner un monde arabe qui connaît, depuis 30- 40 ans, exactement les mêmes transformations démographiques, culturelles et anthropologiques que l’Europe à partir du régime de Cromwell, en Angleterre, puis la révolution française de 1789.
Il n’y a pas de raison que le monde arabe soit une exception. Penser le contraire, c’est être essentialiste, c’est-à-dire estimer qu’il y a une nature arabe ou musulmane rétive aux progrès de l’humanité. Ce n’est pas mon cas.
Quelles sont ces transformations ?
Une progression de l’éducation, pour les garçons puis pour les filles. Vous avez aujourd’hui une majorité de jeunes alphabétisés, sachant lire et écrire. Découle, notamment, de cette éducation, un contrôle de la natalité par l’utilisation des moyens de contraception, et donc une baisse du taux de fécondité, tombé à une moyenne de deux enfants par femme, dans les pays arabes les plus avancés, au Maghreb. On a pu constater aussi une baisse de l’endogamie avec, en Tunisie par exemple, une chute des mariages entre cousins germains.
À partir de quand peut-on dater le début de ces transformations ?
À l’exception des Libanais chrétiens qui ont bénéficié de la présence des missions chrétiennes et de leurs universités dès le XIXe siècle, le monde arabe a globalement commencé à basculer, c’est-à-dire à avoir une élévation du taux d’instruction et une baisse de la fécondité, à partir des années 1960 pour les pays les plus avancés.
Quel a été l’élément déclencheur de ces transformations ?
C’est une volonté politique.
Pour certains pays comme la Tunisie sous le régime de Bourguiba, il y avait une volonté de modernisation, d’accès à l’enseignement aussi bien pour les garçons que pour les filles.
Au Maroc c’était le cas des premiers gouvernements de l’indépendance qui avaient fait de l’éducation leur priorité, avant qu’on y mette un bémol parce qu’elle pouvait remettre en question les hiérarchies politiques. Jusqu’à l’avènement de Mohammed VI, les hautes instances du pouvoir ont parfois bloqué l’avancée de l’éducation. Ce qui explique aujourd’hui le retard important du Maroc en matière de scolarisation, surtout des filles et dans les milieux ruraux.
Ensuite, cela dépend aussi des moyens dont dispose chaque pays.
Les États du golfe persique, dont l’Arabie saoudite, grâce à leurs gros revenus pétroliers, peuvent se permettre un enseignement non seulement généralisé mais de qualité.
En quoi ces transformations peuvent être annonciatrices d’une révolution ?
L’endogamie, c’est-à-dire l’étanchéité du groupe familial, entraîne la fermeture des groupes sociaux sur eux-mêmes et la rigidité des institutions. Quand elle devient moins endogame, une société s’ouvre vers l’extérieur et est donc potentiellement plus propice à se révolter quand elle est gouvernée par un despote.
La scolarisation de masse et la baisse de la natalité peuvent aussi indirectement provoquer une prise de conscience et des révoltes. Ces deux facteurs aboutissent souvent à un bouleversement de la cellule familiale, de manière positive ou négative.
Positive, car le fait de limiter sa descendance permet de mieux soigner ses enfants, de mieux les nourrir, de mieux les scolariser et plus longtemps. Ainsi, dans une famille restreinte, modèle vers lequel la famille arabe et musulmane s’achemine, les interactions père-mère, parents-enfants, deviennent plus démocratiques, plus libres, et ceci ne peut avoir qu’un impact positif au plan global.
Négative, car à partir du moment où vous faites cohabiter un enfant instruit et un père analphabète qui détient le pouvoir du fait que toutes ces sociétés sont plutôt patriarcales, le mélange devient explosif. Et les troubles à l’intérieur de la famille ne peuvent que se traduire par des troubles à l’échelle de la société.
Donc d’un certain point de vue, le fait de passer de l’instruction majoritaire des garçons à l’instruction majoritaire des filles, à l’éveil de la conscience, à la sécularisation des sociétés, à la baisse de la natalité, favorise la transition démocratique.
C’est une lecture des événements que l’on voit peu dans les médias…
Oui, la lecture faite par les médias est essentiellement politique et socio-économique. Et, à mon avis, incomplète.
La presse a aussi beaucoup insisté sur le rôle d’Internet, de Facebook et Twitter, faisant de ces événements une révolution « gadget ». Il ne faut pas exagérer, internet n’a été qu’un instrument de ces révolutions, pas la cause.
On a aussi exagéré le caractère « jeuniste ». Il est vrai que les jeunes universitaires au chômage étaient évidemment plus révoltés que les autres, mais quand vous regardez les photos, du Maroc au Yémen, vous voyez que toutes les tranches d’âge et les deux sexes sont représentés. Donc, en aucun cas, on ne peut en faire une révolution de jeunes.
De même, ce n’est pas une révolution islamique comme le sous-entendent certains. Au contraire, je crois que cette lame de fond est essentiellement d’origine séculière et laïque.
La propagation de la révolte dans le monde arabe peut donner l’impression de sociétés similaires...
Il y a des points communs entre ces sociétés : une majorité de musulmans, une culture arabe identique, une patrilinéarité du Maroc jusqu‘à l’Irak, une transition démographique même dans les pays les plus retardés comme le Yémen.
Mais il ne faut oublier que si les grandes tendances sont les mêmes, chaque pays a ses spécificités.
On parle de printemps du monde arabe, mais dans certains pays, les réalités locales peuvent bloquer la révolution. Si des pays considèrent, par exemple, qu’ils sont en but à un facteur extérieur, comme la menace israélienne pour les Palestiniens.
Autre facteur, l’hétérogénéité des sociétés. À Bahreïn, vous avez le clivage chiites/ sunnites, de même qu’en Syrie, au Liban… En Tunisie, il y a très peu de musulmans autres que sunnites, très peu de berbérophones, peut-être 5%, une particularité qui a pu faciliter la révolution.
On en dirait pas autant de pays comme l’Irak , le Liban, la Syrie ou la Jordanie divisée sur l’origine palestinienne ou transjordanienne. Une société hétérogène peut constituer un facteur de retard pour cette révolution en cours.
Il faut prendre aussi en compte la liberté de la presse, même relative, dans certains pays, la possibilité d’émigrer, la tendance à relativiser, parfois par l’humour, qui sont autant d’exutoires pour le peuple et de soupapes de sécurité pour le régime.
Peut-on parler de l’émergence d’une identité arabe ?
Ce n’est pas aussi simple que cela. La solidarité arabe joue parce que toutes ces populations, quelles que soient leurs religions, se sentent arabes. Mais il y a aussi un patriotisme local.
Aujourd’hui, les Tunisiens tirent une très grande fierté du fait qu’ils ont été les premiers à déclencher le processus, alors que les Égyptiens considèrent, eux, que leur révolution est avant tout égyptienne, et que c’est elle qui va être porteuse de changements dans le monde arabe.
Donc vous avez quelque chose d’assez ambivalent : une identité arabe, un nationalisme arabe qui a émergé à la faveur des révolutions mais aussi un patriotisme strictement tunisien, algérien, marocain…
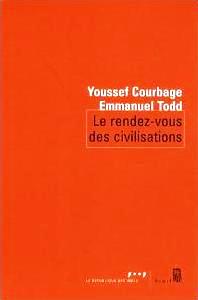
par Benjamin Seze
lundi 28 février 2011
Sources : Comité Valmy
à partir de “Témoignage Chrétien” et “blog Bertrand Du Gai Déclin”
__________
(1) “LE RENDEZ-VOUS DES CIVILISATIONS”
par Emmanuel Todd (historien),
et Youssef Courbage (démographe) ;
Seuil, septembre 2007, 178 pages
retour en haut de page
SAMIR AMIN, L’INTELLECTUEL EN ACTION
Par Yassin Temlali
Babelmed.Net
le 31 janvier 2011
 Samir Amin peut être considéré comme un des intellectuels les plus universels de notre temps. Son œuvre a porté sur des régions aussi diverses que son pays natal, l’Egypte, l’Afrique de l’Ouest et la Chine. Figure du mouvement altermondialiste, il est aussi un penseur du monde arabe et de l’Afrique dont il a régulièrement observé les évolutions économiques et politiques.
Samir Amin peut être considéré comme un des intellectuels les plus universels de notre temps. Son œuvre a porté sur des régions aussi diverses que son pays natal, l’Egypte, l’Afrique de l’Ouest et la Chine. Figure du mouvement altermondialiste, il est aussi un penseur du monde arabe et de l’Afrique dont il a régulièrement observé les évolutions économiques et politiques.
Né en Egypte en 1931, Samir Amin a passé son enfance à Port-Saïd, petite ville au débouché méditerranéen du Canal de Suez. Son père était un indépendantiste égyptien laïc, membre du parti El Wafd (1). Sa mère, issue d’une « famille française jacobine » pour citer ses mots, était une partisane de la « France libre » à un moment où la majorité des Français d’Egypte ne faisaient pas mystère de leurs sympathies pétainistes (2). Comme il le souligne dans ses « Mémoires », la politisation de ses parents, médecins doublés d’actifs militants sociaux, a été décisive dans sa formation personnelle et intellectuelle.
En 1947, il s’est installé en France pour poursuivre ses études secondaires. À l’université, il a suivi des cours de droit, de sciences politiques, de statistiques et d’économie, tout en militant dans des organisations de gauche, notamment le Parti communiste français et des collectifs anticolonialistes. Après la soutenance d’un doctorat en économie en 1957, il est rentré en Egypte qu’il quittera trois ans plus tard pour le Mali. À Bamako, il travaillera comme consultant pour le gouvernement jusqu’en 1963. Il entamera par la suite une carrière de professeur d’université, en France et au Sénégal.
Entre 1970 et 1980, Samir Amin a dirigé l’Institut de développement économique et de planification (IDEP, ONU) basé dans la capitale sénégalaise. Il a joué un rôle central dans la fondation, en 1975, du Forum du tiers-monde (3) dont il assure la présidence.
Un itinéraire intellectuel militant
L’émergence de la Chine comme nouvel acteur d’envergure internationale après la victoire des partisans de Mao Tsé-Toung en 1949 a réorienté les choix politiques du jeune économiste. Il s’est rapproché du courant critique envers l’Union soviétique, plus impliqué que la gauche traditionnelle dans la solidarité avec les mouvements anticoloniaux.
En France, ce courant englobait des groupes dit « maoïstes » qui prendront une part active aux contestations de mai 1968. Pour eux, la Chine, en tournant le dos à son passé féodal mais aussi à l’avenir capitaliste que lui proposait Chiang Kaï-Chek, devenait un exemple à suivre pour nombre de nations qui, en en dépit de leur indépendance formelle, restaient gouvernées par des régimes assujettis aux grandes puissances.
La formation politique de Samir Amin au sein de la gauche radicale déterminera son évolution intellectuelle. Il prolongera son engagement par un travail de recherche de longue haleine, menée avec d’autres économistes, dans un contexte foisonnant de modèles de libération nationale et sociale (les indépendances, les guérillas contre les dictatures d’Amérique latine…).
Théoricien de la « dépendance » et du « système-monde »
Un des fruits de cette recherche a été la « théorie du développement inégal », exposée dans « Le développement inégal » et « L’échange inégal et la loi de la valeur » (parus tous deux en 1973). On pourrait la schématiser comme suit : le « Centre » (les États industrialisés du « Nord ») a grand besoin de continuer d’exploiter la « Périphérie » (les États sous-développés du « Sud ») car sa croissance en dépend ; si la Périphérie est intégrée dans l’économie mondiale, elle l’est en tant qu’ensemble de fournisseurs de matières premières qui ne peuvent édifier de systèmes économiques indépendants ; cette inégalité explique que les salariés du Centre puissent accéder au statut de classes moyennes consommatrices tandis que ceux de la Périphérie sont réduits à un état de permanente survie.
Élargie au champ des études sociales et historiques, la théorie du développement inégal porte le nom de « théorie de la dépendance » (la pauvreté et l’instabilité dans le Sud sont le produit de processus complexes mis en place par le Nord). Enrichie par Samir Amin et d’autres chercheurs à la lumière des chamboulements géopolitiques des années 1970 et 1980, celle-ci a évolué vers la « théorie du système-monde » (4) qui pose l’existence d’un Centre dominant, d’une Périphérie dépendante et d’une « Semi-périphérie » que représenteraient les « États émergents » (Chine, Inde, etc.). Le sous-développement est toujours défini comme une donnée structurelle ; sans révolution majeure, un pays de la Semi-périphérie n’a aucune chance de rejoindre le Centre : « Les rapports de forces internationaux, la domination du capital financier, de l’impérialisme collectif des Etats-Unis, de l’Europe et du Japon ne [lui] permettront pas de jouer à égalité, sur la scène mondiale, avec les vieilles puissances (5) ».
Fort ancrage arabe et africain
L’apport de Samir Amin aux recherches en économie et en histoire économique s’est effectué par deux voies principales.
La première est celle de l’étude des rapports dominants-dominés qui régissent l’économie planétaire.
La seconde est celle de la description des sociétés non encore complètement capitalistes, comme celles d’Afrique de l’Ouest et, à un degré moindre, celles du Proche-Orient et du Maghreb.
Bon connaisseur de l’Afrique depuis qu’il était étudiant à Paris, où il avait eu des solides attaches dans les milieux politiques et syndicaux de l’émigration africaine, il a consacré nombre d’ouvrages aux expériences de développement dans ce continent. Nous n’en citerons que
- « Trois expériences africaines de développement : le Mali, la Guinée et le Ghana » (1965),
- « Histoire économique du Congo : 1880-1968 » (1970, avec C. Coquery-Vidrovitch)
- et « L’Afrique de l’Ouest bloquée » (1971).
Il a fait le bilan de ces expériences dans « Le néocolonialisme en Afrique de l’Ouest » (1973) et, un peu plus récemment, dans « La faillite du développement en Afrique et dans le tiers-monde » (1989).
La pensée universelle de l’auteur de « L’échange inégal » a un autre fort ancrage dans le « monde arabe », qui a fourni leurs thèmes à plusieurs de ses œuvres :
- « L’économie arabe contemporaine » (1980), -* « L’Égypte nassérienne » (1964),
- « Irak et Syrie : 1960 - 1980 » (1982), etc.
Sa réflexion n’a pas négligé non plus le Maghreb, parent pauvre des études qui se fixent un cadre géopolitique arabe
- « L’économie du Maghreb », 1966,
- et « Le Maghreb moderne », 1970).
Rejet des « illusions » nationaliste et passéiste
Samir Amin a étudié le monde arabe dans un cadre global, le cadre mondial, le considérant comme une des périphéries dépendantes des centres capitalistes.
Ses écrits sur les expériences arabistes de l’Egypte (sous le règne de Gamal Abdelnasser) et de l’Irak et de la Syrie (sous le règne du parti Baath) se sont doublés d’une réflexion théorique sur le nationalisme arabe en tant que doctrine politique : « La nation arabe » (1976) et « Critique du discours arabe contemporain » (2009).
Pour lui, si les éléments d’unité de l’ensemble dit « arabe » sont réels, les nationalismes spécifiques (algérien, égyptien…) n’en ont pas moins des racines lointaines (qui, parfois, plongent dans l’histoire préislamique) ainsi que de solides fondements contemporains (puissants mouvements indépendantistes, véritables marchés intérieurs, etc.). « Nier [ce fait] au bénéfice de l’affirmation de l’arabité serait se bercer d’illusions (6). »
Samir Amin ne critique pas la seule « illusion panarabiste (7) ».
Il critique encore plus sévèrement ce qu’il préfère appeler « l’islam politique » pour mieux souligner qu’il s’agit moins d’un mouvement de renouveau théologique que d’organisations visant à s’emparer du pouvoir (8).
Il conçoit l’idéologie islamiste comme un simple germe de dictatures théocratiques futures, lui déniant toute dimension émancipatrice. Pour lui, elle ne peut être comparée à la « Théologie de la libération » qui a mis l’église catholique à l’avant-garde des luttes contre les dictatures d’Amérique latine.
Elle est même pire qu’une doctrine rétrograde ordinaire, en ce sens qu’à ses yeux, elle justifie l’état de soumission aux grandes puissances dans lequel se trouvent la majorité des États musulmans : « Les auteurs de manuels sur l’économie politique islamique […] n’ont réussi qu’à camoufler les préceptes les plus banals du libéralisme américain sous une couche d’aspect religieux (9). »
Une figure de l’alter-mondialisme
Les opinions tranchées de Samir Amin sur la faillite de l’arabisme et le danger mortel de l’islamisme provoquent souvent des polémiques en Égypte et dans le monde arabe.
Ses adversaires lui rappellent que les processus de libération économique du Sud peuvent prendre la forme de processus de libération de type national voire « ethnique » et citent volontiers l’exemple des Zapatistes au Mexique.
Sa position envers l’islamisme est rejetée par une partie de la gauche arabe qui estime que sous le label « islamisme », on ne peut ranger les « idéologies de pouvoir » adoptées par les « régimes islamiques » d’Arabie Saoudite ou du Pakistan (10).
La radicalité de certaines de ces critiques n’empêche pas qu’il soit reconnu, par ses disciples et ses détracteurs réunis, comme un des rares intellectuels qui ont mis leur savoir au service d’une cause humaine, celle des laissés-pour comptes de toutes conditions.
Son parcours est une éloquente démonstration de ce que la fusion de la théorie et de l’action n’est pas une pure chimère et qu’à 80 ans, on peut écrire sur la « question paysanne » tout en organisant des Forums sociaux, vivre entre Dakar et Le Caire et faire partie des penseurs de l’Humanité.
Yassine Temlali
_____________________________
Notes :
(1) Ce parti tient son nom d’une délégation (« wafd », en arabe) envoyée en Europe pour réclamer l’indépendance de l’Egypte et que ses membres transformeront en organisation politique. Saâd Zaghloul est le plus célèbre des fondateurs du Wafd.
(2) Mémoires de Samir Amin, traduction arabe, 1ère partie, Dar Al Saqi, Beyrouth (Liban), 2006.
(3) Le Forum du Tiers-Monde (FTM) se définit comme un rassemblement d’« intellectuels engagés soucieux non seulement de poursuivre et d’approfondir le débat sur les différentes alternatives possibles en matière de développement […] mais encore plus d’avoir […] un impact réel sur les sociétés concernées » (www.forumtiersmonde.net).
(4) Cette théorie a été élaborée par Samir Amin, le sociologue américain Immanuel Wallerstein et l’économiste italien Giovanni Arrighi. Le concept de « système monde » est proche de celui d’« économie-monde » (Fernand Braudel) qui désigne une partie de la planète organisant celle-ci à son seul profit (l’économie-monde de notre époque serait celle de l’ensemble euro-américain, structurellement comparable à celle des empires romain ou carthaginois dans le passé).
(5) Interview parue dans le quotidien français « L’Humanité », 1er février 2008.
(6) Le quotidien égyptien « Al Masri el Youm », 22 octobre 2009.
(7) Dans une interview à « L’Humanité » (1er février 2008), il a énuméré « trois illusions » qui, selon lui, font obstacle à la prise de conscience universelle de la nécessité d’un changement mondial majeur :
- l’illusion social-démocrate dans les pays industrialisés,
- l’illusion nationaliste dans les pays dits émergents »
- et, enfin, l’illusion passéiste, « la pire » à ses yeux, qui frappe « les peuples défaits dans l’histoire » (pays arabes, pays d’Afrique subsaharienne, etc.).
(8) « Nous n’avons pas là affaire à des mouvements en soi religieux […] mais à quelque chose de beaucoup plus banal : des organisations politiques dont l’objectif est la conquête du pouvoir, ni plus ni moins. Si ces organisations se drapent dans la bannière de l’islam, c’est tout simplement par opportunisme. » Article intitulé « L’islam politique », site d’« Alternatives internationales » (www.alterinter.org), 16 janvier 2007.
(9) Ibid.
(10) Cette critique a été adressée à Samir Amin par le chercheur libanais Diab Abou Djahdjah dans un article (en arabe) intitulé « Samir Amin déprimé », paru dans le quotidien libanais « Al Akhbar » (www.al-akhbar.com), le 14 février 2008.
retour en haut de page

EL QACBA , ZEMÂM de KADDOUR M’HAMSADFJI
Promenade et redécouverte de la Casbah d’Alger.
par Abderrahmane Zakad – Urbaniste -Ecrivain.
Lorsque notre ancien et le sage Kaddour M’Hamsadji m’avait fait la confidence qu’il comptait écrire un livre sur la Casbah et ses traditions, j’avais été pris d’une joie immense de savoir qu’enfin quelqu’un — et pas des moindres — allait s’intéresser à cette Casbah tant criée et décriée, pour l’y pénétrer avec la raison et le cœur et non pas avec la passion stérile qui fausse le regard, sclérose la mémoire et embrouille les souvenirs.
Son expérience, sa large érudition et surtout ses recherches donnent à juger à sa juste valeur cette œuvre en deux tomes sur la Casbah. Une œuvre qui marquera la littérature algérienne et qui fera date.
Après tant de livre écrits, essentiellement inspirés par notre patrimoine immatériel, Kaddour M’Hamsadji nous propose cette fois-ci, en plus de la genèse et de l’Histoire de la Casbah, les résultats de ses « fouilles » portant sur cette médina depuis les origines, sur son urbanisme, ses traditions, ses coutumes et ses fêtes, autant de belles choses des esprits d’autrefois.
C’est là une joyeuse et instructive promenade dans les 528 pages que renferment les deux tomes, promenade dans un labyrinthe déchiffré pour la découverte de l’immense trésor que recèle la Casbah, parfois dans des choses hermétiques et qu’il faut envisager aujourd’hui comme parcelle vivante d’un millénaire de traditions.
Dans les livres de Kaddour M’Hamsadji on relève cette volonté de l’auteur de faire connaitre la vérité et la réalité avec précision dans un souffle évocateur. Et pour ceux qui cherchent des points d’appui, on est totalement en confiance car si dans le silence l’auteur a tant de choses à dire, le lecteur, lui, entend s’y retrouver.
Et l’auteur, dans un travail de miroir, avec du recul et de la pudeur et aussi avec précision et la justesse des mots, dit tout dans cette ouvrage où les tableaux sont d’une humilité retenue sur la vie des gens d’“El Qaçba, zemân”.
Les textes accrochent par la qualité d’écriture sur fond urbanistique, sociologique et quelques fois scientifique comme les mécanismes calculés qu’entreprendraient l’ingénieur pour la précision, l’urbaniste pour l’ordre et l’amplitude ou pour l’agronome, le fonctionnement de la « mémoire » génétique du règne animal ou végétal. Ici, il s’agit de la mémoire d’une ville, la Casbah tant aimée tant chantée et aussi tant pleurée lorsque les dégradations commencèrent à la mettre bas, paraphées par des monticules entremêlés de gravas, de pleurs et aussi de souvenirs.
Dans le premier tome
l’auteur avertit qu’il tente de retrouver « Alger, autre fois » avec les yeux d’aujourd’hui, c’est-à-dire à partir d’une mémoire exhumée. Il confesse « qu’il se fie à ses souvenirs d’enfance et à des informations pieusement glanées auprès de quelques anciens algérois (femmes et hommes) à la mémoire encore plus ou moins bellement conservée. C’est aussi au moyen de lectures dans des ouvrages rares, dispersés, souvent superficiels et toujours de hasard qui ont plus d’une fois avivé sa curiosité jusqu’à ce qu’il y trouve quelques bonne idée à développer davantage ».
Après les explications du système de transcription qu’il juge nécessaire d’inclure pour la compréhension, l’auteur remonte jusqu’à la genèse de la Casbah en se posant la question sur l’origine exacte de la cité « El-Djazair » en l’abordant par « l’île aux mouettes », puis dans une promenade historique embellie par le charme de la parole humaine.
Il nous rappelle Eikosim-Icosium. Il nous raconte les péripéties de Zîrî Ibn Menad et de son fils Bologgin qui fonde « trois villes, l’une sur le bord de la mer, appelée Djazair-béni-Mezghanna ; l’autre sur la rive orientale de l’oued Chlef, appelée Miliana ; la troisième porte le nom de Médéa. »
Puis, la lecture nous mène jusqu’à Sultân Djezâir de la période ottomane que l’on peut traduire par « Alger, la Ville-Sultane, l’une des plus villes de la Méditerranée des XVI-XVIII° siècles ».
Mais la Casbah que l’on connait aujourd’hui, nous apprend l’auteur, a été commencé en 1516, par ‘Aroudj et achevée, en 1590 sous le pacha Khedar. Elle a remplacé en renommée, la primitive Casbah berbère, « el-Qaçba el-Qadi ma ».
Et c’est à partir de cette Casbah ottomane jusqu’à celle d’aujourd’hui que l’auteur analyse le site d’« El Ouata au Djebel ». Il s’étend sur son évolution en nous restituant la vie urbaine, en nous décrivant la physionomie ancienne des rues et des places, allant jusqu’aux détails des boutiques, des fontaines, des édifices religieux, des écoles, de sites caractéristiques et bien sûr de la maison algéroise.
Une agréable promenade historique, une intrusion urbanistique dans le bâti, dans les boutiques de l’artisanat et dans la vie sociale avec quelques noms de rues oubliés d’El-Qaçba, zemân, la Casbah d’autrefois.
Le livre renferme une cartographie instructive et des photos judicieusement choisies dont certaines sont inédites d’autres prises par l’auteur à Nice comme celle intitulée « Le boulet turc de 1853 » paraissant en page 65 du tome 1, preuve que l’auteur s’est dépensé pour que son livre soit un témoignage et non pas construit sur le déchiffrement d’un palimpseste pour des incantations mais comme monnaie d’échange à des pensées claires.
Dans la partie ethnologique du deuxième tome
surtout celle concernant le mariage, les fêtes et les pratiques sociales — l’auteur ne nous fait pas la morale mais tente de percer le secret de la formation morale. Il expérimente d’abord sur sa propre conscience cette analyse pénétrante avant de la porter sur les autres en nous faisant promener dans le plus extraordinaire voyage et péripéties qui ont marqué cette médina.
Je me souviens du jour où, rendant visite à l’auteur, je le trouvai perturbé. Il était alors en plein écriture de son livre. En réponse à ma question sur son état moral et de santé, il me répond qu’il n’arrivait pas à régler un problème.
Quel était ce problème ? Il s’agissait « seulement » de ce qu’il ne trouvait pas le texte original de la chanson « Abqâw ‘alâ khir » que chantait Fadila Dziria. Je lui proposai de lui acheter un CD. Il refusa car la chanson contenue dans un CD ou dans les anciens disques pouvait ne pas être l’original. Il voulait un texte certifié original. Pendant plusieurs mois, il s’était démené pour contacter les spécialistes et fouiller dans les archives de l’ENTV. Il rencontra Ahmed Serri et Abdelakader Chaou en ma présence. Personne n’était sûr de l’originalité du texte jusqu’au moment où, après de minutieuses recherches auprès de vieilles dames algéroises et des informations recueillies et complétées chez Mohammed Réda Guechoud et dans un ouvrage de l’ethnographe Joseph Desparmet (1905), il a réussi à reconstituer « abqâw ‘alâ khîr » très valablement.
Kaddour a sauvé ce texte ; il nous le restitue dans son originalité. Je vous en transcris une partie. Voilà tout Kaddour, voilà l’intellectuel honnête, soucieux de vérité, voilà l’artisan du bel ouvrage.
« Abqâw ‘ala khir, Abqaw ‘alâ khir
Hadha el-ferh dîma, Allah yançar mwâlin el-khima
Abqâw ‘ala khir, Abqaw ‘ala khir
Ya el-mouâlin el-hâra, antouma chorfa ou bentkoum nouara. »
(page 192- tome 2)
« Abqâw ‘ala khir » : Qui ne se souvient pas de cette chanson de fin de fête, du départ, de cette chanson de toujours que nous gardons dans notre mémoire ? Oui, un départ heureux de fin de fête, dès la nuit tombée où les femmes lancent leurs youyous en même temps que leurs salutations, allant et venant dans le west eddar, se bousculant qui pour arranger son haik m’rama qui pour chercher son enfant. Ces femmes ennuagées de parfums divers et dont les yeux sont cernés de khol à faire fondre le plus froid des dockers à la chemla d’antan, femmes frêles et suaves mais assurées sur des chaussures noires qu’elles gardaient pour les belles occasions, femme d’Alger, mais aussi de Constantine ou de Tlemcen, en un mot femmes de chez nous.
Non ! Ce n’est pas de la nostalgie. Ce sont là nos traditions, les unes éparses d’autres enfilées comme dans un collier de perles, sûres et durables. Et ce qui fait le collier ce ne sont pas les perles, c’est le fil qui les retient c’est-à-dire la solidarité qui unissait les femmes comme le fil unit les perles. C’était l’époque où les Algériens savaient partager la misère, la seule monnaie qui permettait l’égalité, l’époque où l’on se soutenait dans la peine et où la femme servait de toiture pour la sécurité et pour l’assurance. L’époque où sans la présence de la femme à la « maison » la famille ne mangeait pas et où l’homme était perturbé et les enfants inquiets.
Non ! Ce n’est pas de la nostalgie. C’était l’époque des fêtes organisées dans une cour ou dans des chambres à matelas posés parterre et qui permettaient à la chaleur humaine de se transmettre corps à corps et par capillarité de l’esprit.
Le bonheur d’être simple et de ne pas trop dépenser. Le plaisir des yeux à regarder le sandouk, coffre à fleurs multicolores ou des tentures bigarrées. Le plaisir aussi de goutter au café à l’eau de fleurs d’oranger accompagné de gâteaux de chez nous à base de semoule, de pâte de dates ou d’amandes et de miel. Cela suffisait pour délecter les palais tandis que de nos jours on s’empiffre à avaler des pâtisseries spongieuses comme faites à partir de mousse à matelas sans compter le tohu-bohu dans des salons d’hôtel sans chaleur ou bien dans des garages aménagés hideusement comme des paraphes d’insultes.
Mais quittons la fête et avançons dans cette deuxième partie. C’est la partie consacré à la vie sociale dont cette fête du mariage décrite ci-dessus. L’auteur convie le lecteur à apprécier un art de vivre de la société citadine algéroise, jalouse des ses racines et de ses liens ancestraux, et parle humainement en gardant le regard sur l’avenir.
Dans la Qaçbah zemân, la vie n’était pas un amusement mais un langage sérieux. Il est bon de signaler l’énergie narrative de l’auteur accompagné d’un rythme mélancolique de grande amplitude.
Les textes tout de joie et de bonheur attirent par leur accessibilité littéraire, la subtilité des thèmes mais surtout par son esprit. « Avec un peu de saine naïveté et un brin de bon sens populaire, on peut comprendre que toute mémoire est mémoire ingénieuse ; en quelque sorte, elle est technicienne, elle fabrique la tradition de la tradition : un passé, repassé dans le présent qui reproduit le passé pour le futur qui déjà l’accueille. »
Et c’est ainsi que l’auteur passe de l’Histoire aux traditions en nous expliquant l’art de la tradition multiple, spécifiant ce que transporte la parole , ce que signifie le geste dans leurs signifiants et surtout, ce qui fait la Casbah, c’est-à-dire pas seulement les maisons, les ruelles et les palais mais la population : l’humain.
Et c’est dans la population que se construit la civilisation et que se fabrique le langage.
L’auteur s’attache alors à définir les mots parmi les plus usités dans le parler algérois ancien, en les faisant ressortir dans les faits et les traits généraux de la vie algéroise d’autrefois. « Le mot est alors saisi dans la situation même de la pensée et de la volonté du citadin de la Casbah ; pour beaucoup, il réveil des images peut-être oubliées ; pour beaucoup d’autres, il rend à la parole son charme imprévisible si particulier et sa valeur subjective si singulière. Le mot permet alors au langage d’exprimer tout l’espace intime de la Casbah. »
Le lecteur est invité ensuite à flirter avec le « hadri » et le « barrani » dans des opinions telles que yatakalmou bit-taçghir ou encore yaqadjmou bit-chkikoûn. Ainsi une adolescente est dite une « ‘aouitqa », un adolescent « ‘aouizeb ».
Et c’est ainsi, également, que l’auteur nous restitue en page 87 les mots et les expressions du kalam zemân, du vocabulaire ancien du citadin algérois. Les mots et les expressions sont une guirlande de regroupement instructif dans les instantanés d’antan par des personnages virtuels — les gens de la Casbah — incarnés en des dialogues réalistes issus de la vie d’hier et qui se poursuivent dans celle d’aujourd’hui.
En poursuivant la lecture, on pénétrera dans la vie de Si Hamdane, on sera convié à « la fête aux mille vertus » et, dans le détail, on assistera par l’esprit et au moyen de ce livre, à la fête d’un mariage, aux noces, à la nuit de noces et aux jours suivant la nuit de noces.
Cette œuvre en deux tomes doit être dans toutes bibliothèques ainsi que dans les écoles car c’est un jardin de fleurs des champs, le champ de notre culture.
Et parmi ces fleurs, deux roses belles comme sont beaux les deux tomes de « El Qaçbah, zmân. » Et si les roses exigent d’être entretenues pour l’agrément, ces deux livres devraient agrémenter et votre esprit et votre bibliothèque.
Lecteur, j’ai laissé ce mot pour la fin. En page de couverture du deuxième tome paraît une très belle photo d’une aquarelle datant de 1835 faite par le Cdt Théodore Leblanc à Alger (qui sera blessé mortellement lors du siège de Constantine en 1837). Photo rare, dénichée par l’auteur à la Bibliothèque Nationale de France, cette aquarelle représente une jeune mariée d’Alger trônant dans un fauteuil au cours d’une taçdira.
M. Kaddour M’Hamsadji nous l’offre comme cadeau pour notre fidélité.
Rappelons que Kaddour M’Hamsadji a été l’élève de Mustapha Lachraf au lycée de Boufarik, l’ami de Mammeri et l’un de ses seconds dans la première Union des Écrivains créée le 28 octobre 1963.
Il a écrit de nombreux livres, dont le fameux « Jeu de la boûqâla » et le scénario du film adapté de son livre « Le Silence des cendres », réalisé par le regretté cinéaste Youcef Sahraoui.
Il a également publié un essai intitulé « Concevoir une émission éducative » et d’autres œuvres littéraires dans différents genres : théâtre, roman, poésie, nouvelle, conte pour enfants, biographie, essai.
Vous trouverez toutes ses œuvres sur Google, notamment sur « Kaddour M’Hamsadji - Wikipédia ».

El Qaçba, zemân de Kaddour M’Hamsadji – Éditions OPU.
Tome I : HISTOIRE, De l’île aux mouettes à la Casbah. 253 pages

Tome II : Traditions, le mariage. 275 pages
Abderrahmane Zakad- Écrivain

retour en haut de page