Accueil > NATION-ALGERIE > 1870-1993 : UNE FAMILLE ALGÉRIENNE ISSUE DE L’IMMIGRATION EUROPÉENNE EN (...)
1870-1993 : UNE FAMILLE ALGÉRIENNE ISSUE DE L’IMMIGRATION EUROPÉENNE EN ALGÉRIE
Texte écrit par Fernand Gallinari en 2010
mercredi 3 juillet 2013
Socialgerie reprend ici le texte complet que Fernand Gallinari avait écrit pour sa famille en 2010
Pour ces mois d’été où le site fonctionne au "ralenti" socialgerie se propose de mettre en ligne progressivement des documents témoignages et textes reçus précédemment et renouvelle son appel et sa disponibilité à accueillir tous documents et témoignages de nature à enrichir et renforcer le mouvement social, démocratique et national des nouvelles générations.
Fernand GALLINARI
1870-1993
IMMIGRÉS EN ALGÉRIE
OU
LE LONG SIÈCLE D’UNE FAMILLE
D’ « ALGÉRIENS ISSUS DE L’IMMIGRATION EUROPÉENNE »
Préface …………………………………………… page 1
Texte ……………………………………………… page 4
Postface ……………………………………….... page 97
- Militants "européens" de la Section de Bab el Oued dans les années 1950 ;
- Assassinats de militants européens par l’OAS ou des éléments incontrôlés de l’ALN 1962 ;
- militants tués par le FLN ;
listes établies par Pierre Cots, et remises à F. Gallinari. …page 101
Annexe II : biographie succincte de Pierre Cots.…… page 105.
Annexe III : Note sur le PAGS dans les années de légalité…page 109.
Préface
J’ai entrepris la rédaction de ce texte sur l’insistance de mes enfants.
Ils ont toujours eu l’impression que j’avais vécu une expérience passionnante, eux qui trouvent désespérant le monde dans lequel ils vivent.
Ils voient en particulier avec beaucoup de romantisme mon engagement politique, tandis que leurs tentatives de militantisme les laissent profondément insatisfaits. Il m’a semblé intéressant de leur donner une image aussi honnête que possible de ce qu’a été ma vie et d’expliquer en quoi elle a été relativement originale.
J’ai l’invraisemblable prétention d’avoir vécu une vie de précurseur. D’abord en tant que membre d’une communauté qui aurait pu se fondre avec une autre ou, au moins et dans une première étape, constituer avec celle-ci un ensemble harmonieux. Si la chose a été impossible au niveau des communautés, je l’ai tenté et réussi au niveau familial, pour mes enfants, mon épouse et moi.
Je suis communiste ou du moins apprenti marxiste (parce que le terme « communiste », ces temps ci, s’applique à plusieurs réalités).
En tant que tel, j’ai tendance à me livrer à des prédictions optimistes (à long terme, quand même) sur un avenir rayonnant pour l’humanité. Un avenir fait d’égalité en droits de tous les habitants de la planète, et aussi (on a souvent glosé sur la parenté du marxisme et de la thermodynamique), de mélanges des cultures et même des gènes. Là aussi, j’ai appliqué les principes auxquels je crois.
L’Algérie a connu durant deux millénaires de nombreuses invasions qui ont toutes laissé des traces, quelques fois positives, toujours douloureuses. En France, la révolution bourgeoise de 1789 a été suivie de multiples restaurations et même de deux Empires, meurtrier pour le premier, cruellement bourgeois et un peu ridicule pour le second. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Histoire ne se déroule pas de façon linéaire, et qu’à des vagues de progrès pour les peuples, succèdent des périodes beaucoup moins fastes.
Ceci dit, je crois que ce que l’humanité a tenté, de Spartacus à la révolution russe de 1917, finira par triompher.
Mais il n’est pas impossible, malheureusement, que tout ce à quoi je crois soit passablement passé de mode dans les années qui viennent et que nous traversions pour quelques temps une période entre deux vagues. Mes descendants risquent donc d’y perdre quelques points de repère que le parcours de leurs ancêtres peut leur fournir.
Ce sont ces quelques points que je voulais leur léguer.
Il me paraît important également de faire une mise au point concernant la tentative de faire de ce texte une présentation bilingue. Je suis conscient que la traduction en Arabe, due essentiellement à mon fils Khaled (et un peu à moi-même), est certainement très imparfaite. Qu’elle présente aussi un caractère scolaire, car c’est effectivement à l’école qu’il a appris cet Arabe. Nous aurions préféré écrire dans la langue de l’Algérie, mais nous n’avions de cette langue, qu’une connaissance rudimentaire (ce qui, soit dit en passant, est le cas d’un très grand nombre d’ « Algériens de souche »). Il s’agit donc seulement d’un acte de foi plein d’humilité, dans une Algérie bilingue au sens de Mostefa Lacheraf.
Sète (France), décembre 2010
haut
Joseph Gallinari était un rude gaillard. Son père Raimond, marin livournais chassé d’Italie par la misère, avait débarqué à Philippeville dans les années 1870. Il y avait épousé en 1874 Isabelle Vitiello, née à Alger en 1854. Jusqu’à ces derniers temps, on ne leur connaissait pas d’autre enfant que Joseph, ce qui était passablement étonnant pour une famille pauvre de cette époque, mais on ne savait pas tout de cet homme et Joseph n’a jamais mentionné son père ni sa mère, par exemple, devant ses petits enfants. Avec les possibilités ouvertes par Internet, j’ai pu retrouver six frères et sœurs à Joseph, dont quatre morts en bas âge.
Raimond était arrivé en Algérie en compagnie de son cousin. Celui-ci devait finir à Casablanca où il allait faire fortune dans la construction navale. Aujourd’hui encore, à Casa, avenue Mohammed V, on peut trouver un modeste équivalent du passage du Lido, avec, au-dessus de l’entrée, une inscription annonçant : passage Gallinari
Raimond n’eut pas la même réussite. Joseph et sa famille s’installèrent à Alger, où il commença à travailler sur les remorqueurs du port. Ses camarades de travail le surnommèrent Bibosse à cause, paraît-il de son front bosselé. On était dans les dernières années du 19ème siècle et les familles européennes pauvres habitaient dans des cités neuves à proximité de la Casbah. Les Gallinari habitaient rue Dupetit Thouars, Cité Biche. C’est là que mon père est né, le 2août 1913.
Joseph, mon grand père, commençait à élargir son horizon. Il s’était embarqué sur les bateaux de la ligne Alger- Marseille, et c’est à Marseille qu’il fit la connaissance de Marie Canioni, fille d’une famille corse du quartier du Panier. Il l’épousa et la ramena à Alger où il s’organisa une vie de famille classique à l’époque dans la marine : une fille dans chaque port, et on fait un enfant quand on rentre à la maison.

Mon fils Nassim
devant le passage Gallinari
à Casablanca en 2008
Car Joseph continuait d’évoluer dans son métier. Il naviguait maintenant sur des grands bateaux à voile sur lesquels il allait au Chili, pour le fameux caliche, ou au Japon, d’où il ramena des peintures sur verre fort coquines dont il avait orné sa chambre. C’était donc un véritable cap-hornier et il en garda toute sa vie une grande et légitime fierté, ce qui ne l’empêchait pas d’en rajouter un peu, par exemple quand il disait que, par temps calme, les creux des vagues atteignaient dix mètres de haut au Cap Horn. Par contre, il nous racontait une anecdote que j’ai pu vérifier dans un reportage sur Valparaiso, et qui concernait la propreté méticuleuse des dockers qui se changeaient soigneusement en arrivant au travail, et ressortaient du port propres comme des sous neufs après s’être douchés. J’ai pu vérifier dans un documentaire à la télévision que la coutume persistait plus d’un siècle plus tard. Mon père y voyait un signe de la dignité du prolétariat chilien.
La famille avait déménagé avenue Malakoff, sur le front de mer, à Bab el Oued, et pendant ses séjours à terre, Joseph regardait à la jumelle de son balcon les chalutiers rentrant le soir, en critiquant leurs manœuvres d’approche.
Sur le mur de la salle à manger étaient accrochées deux immenses coquilles que mon ami Jacques, biologiste distingué, a identifié beaucoup plus tard. Ce sont des coquilles de pinna nobilis. Mon grand père racontait qu’il les avait ramenées de l’étang de Thau. Pour moi, avec un nom pareil (que j’aurais probablement orthographié Tô), cet étang devait se trouver quelque part en Asie. Je ne me doutais pas que soixante ans plus tard, j’habiterai sur les berges de cet étang, à Sète, dans le sud de la France.
La vie était très dure pour la famille Gallinari : l’absence quasi permanente du père, le manque d’argent, la misère endémique de l’époque, l’archaïsme des mentalités, tout concourait à faire de la vie une espèce d’enfer dont personne pourtant ne songeait à se plaindre : c’était ça, la vie.
Marie eut une dizaine d’enfants, dont trois survécurent. L’aîné, Raymond, était malgré son jeune âge perclus de rhumatismes. Le médecin avait semble-t-il prescrit des bains à l’eau de mer, et mon père descendait tous les matins avec deux bidons chercher de l’eau de l’autre côté du boulevard. Avec une telle thérapeutique, Raymond ne survécut pas longtemps. Les deux derniers à mourir ont laissé un souvenir douloureux à ma mère . Un garçon, Pierre, mort à douze ans, probablement de la tuberculose, et une « jeune fille perdue », Marie Louise, fille mère, morte à 24 ans le jour de Noël dans un accident de voiture, probablement après une nuit bien arrosée.
Cette dernière, laissait une petite fille que ma mère aurait voulu adopter, mais ma grand mère, ulcérée par le déshonneur, l’avait promptement emmenée à l’orphelinat d’où ma mère ne put jamais la récupérer. Ce fut pour elle une telle douleur qu’elle décida d’avoir un troisième enfant. C’est comme ça que je suis né.
Les deux sœurs survivantes de mon père étaient aussi différentes que possible : Isabelle, l’aînée, rompit avec sa vie de misère pour épouser un ouvrier de l’Arsenal avec lequel elle vécut une vie apparemment très rigoriste, du moins c’est comme cela qu’elle nous apparaissait. La deuxième, Joséphine, remporta grâce à sa vingtaine d’enfants, le prix Cognac pour l’Afrique du Nord. Elle vivait dans les hauts de Bab el Oued, dont elle descendait vaillamment sur ses jambes abominablement variqueuses pour faire le marché, sans négliger les possibilités de chapardage offertes par la cohue qui sévissait entre les étals.

Georges Gallinari, tout en haut, à gauche,
à l’école de la rue Rochambeau
vers 1925 (il a 12 ans)
Le garçon survivant, Georges, mon père, arrivait dans la classe du certificat d’études à l’école voisine de la rue Rochambeau. Son maître, monsieur Charpentier, entrevoyait pour lui des études secondaires, voire supérieures, ce qui était rarissime pour des enfants de son milieu dans les années vingt du vingtième siècle. De toutes façons, les projets du maître tombèrent à l’eau devant la volonté inflexible de Joseph de faire travailler son fils sur le port comme « piqueur de chaudière », pendant qu’il était encore assez petit pour rentrer dans les chaudières par les trous d’hommes pour piquer le tartre. Mon père racontait que sa grande peur était qu’un jour on l’oublie à l’intérieur et que l’on démarre la chaudière à l’improviste. À quatorze ans, Georges était devenu un petit homme.
Quand il commença à grandir, il devint impossible de l’employer dans le piquage. En cherchant du travail dans le quartier, il tomba sur une famille qui fut certainement l’une des chances de sa vie, la famille Cazassus, transporteurs de vins et propriétaires d’un magasin d’électricité. Ces gens, originaires du Sud Ouest de la France, étaient l’honnêteté et la générosité mêmes. Ils le prirent en affection et l’adoptèrent comme un membre de leur famille. Chez eux il devint un ouvrier électricien et, comme c’était l’usage à l’époque, quand il eut vingt ans, il commença à penser à se marier.

Un banquet à Bab el Oued vers 1930
Le « patron », Bertrand Cazasus, (2ème au fond à gauche)
ne viendrait pas sans son « ouvrier » Georges Gallinari (à sa droite)
Ma mère, Fernande Carrio, l’intéressait, mais c’était une fille trop « sérieuse » pour un gars un peu coureur de jupons. L’expression de Bertrand Cazassus, son patron, c’était : « ce n’est pas du millet pour ton serin ». Ma mère est restée toute sa vie très fière de ce qu’elle considérait à juste titre comme un jugement très flatteur pour elle.
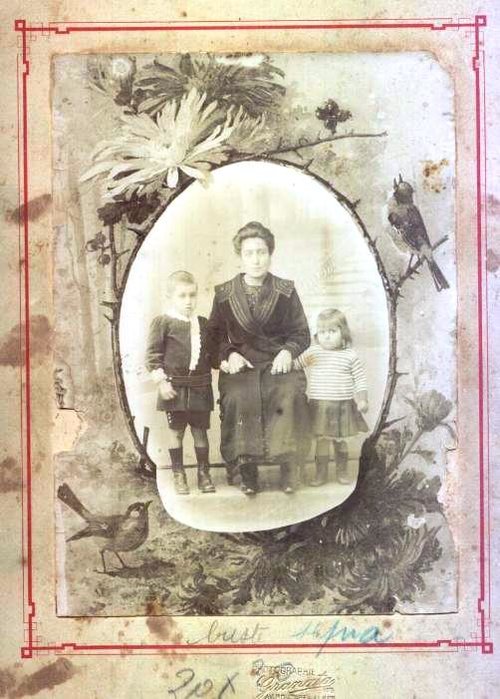
Ma grand mère Jeanne, ma mère Fernande et son frère Gaby
Je suis toujours étonné du paradoxe que vivent les gens et surtout les jeunes de cette époque. Fernande est connue pour être une jeune fille heureuse de vivre, fière d’elle même et des siens. Et pourtant (ou peut-être à cause de cela), quelle enfance à la Zola ! Elle est de santé fragile. Elle attrape la teigne et elle gardera toute sa vie une chevelure très clairsemée qu’elle réunit, pour limiter les dégâts esthétiques, dans un fin filet. À dix ans, elle perd inexplicablement la vue et restera aveugle plusieurs mois, jusqu’à ce que la vue lui revienne tout aussi inexplicablement. Elle n’est jamais allée à l’école. Elle a appris à lire, probablement avec son frère cadet Philippe, qu’elle aidait à apprendre par cœur ses leçons d’histoire. Elle s’est toujours rappelé l’une d’entre elles qu’elle récitait comme une litanie d’une voix monocorde :
L’empereur Julien aime Paris.
Il y passe l’hiver.
À la belle saison il combat les Germains en Gaule.
Manière pour elle de fréquenter l’école par procuration. Elle complétait son apprentissage de la lecture en déchiffrant les affiches dans la rue.
Les Carrio, comme leur nom l’indique, était arrivés d’Espagne. Ils avaient débarqué à la même époque que les Gallinari eux aussi chassés par la misère de leur province valencienne. J’ai connu mon arrière grand mère dans ma prime enfance. C’était une personne d’un abord sévère, mais, paraît-il, pleine d’humour. Elle avait eu au moins deux maris puisque ma grand mère s’appelait Jeanne Sala, et sa sœur Mathilde Poquet.
J’ai bien connu ma tante Mathilde. C’était une femme qui vivait avec une grande blessure : elle avait perdu sa fille de quinze ans d’une maladie de cœur. Elle avait une belle voix espagnole, c’est-à-dire un peu nasillarde. Je dirais de sa voix qu’elle avait quelque chose d’épique. En tous cas, c’est comme ça que je la ressentais.
Elle avait vécu un épisode beaucoup moins dramatique, mais tout à fait rocambolesque : son fils Jean avait engrossé sa petite amie. Cela signifiait qu’il devait « répare » et épouser la demoiselle. Effectivement, les noces furent préparées en grande pompe, mais le futur mari n’arriva jamais chez sa « promise » qui l’attendait en robe de mariée chez ses parents. Il prit la fuite et disparut du quartier pour ne pas encourir les représailles de la famille offensée. Plusieurs années plus tard, il se justifiait en disant qu’il n’était pas sûr d’avoir été le seul à bénéficier des faveurs de sa « fiancée ». Il n’eut pas de chance car l’enfant du pêché lui ressemblait comme deux gouttes d’eau.
Je n’ai pas connu ma grand mère, morte cinq ans avant ma naissance. Elle était concierge à la maison Jaubert, près des usines de tabac Bastos. Elle faisait les escaliers tous les jours et pour faire bouillir la marmite, elle faisait en plus des lessives. Elle est morte « d’un fibrome » avant d’avoir atteint les cinquante ans. Elle avait une voix magnifique et chantait à l’Église Saint Joseph pour les mariages des enfants des amis, une chanson que les féministes d’aujourd’hui n’apprécieraient pas beaucoup.
Va, ma fille sois heureuse,
Sois toujours vertueuse,
Suis l’époux, suis l’époux avec qui je t’unis
…..
Sa fille Fernande, ma mère, ne s’est jamais remise de cette mort prématurée. Jusqu’à sa mort, c’est-à-dire pendant plus de cinquante ans, elle a gardé près d’elle le portrait de sa mère dont le cadre avait perdu sa dorure à l’endroit où elle le tenait. Ce portrait est encore aujourd’hui accroché dans mon bureau. Mon père avait pour sa belle mère beaucoup de respect. Il disait d’elle, sur un ton un peu sentencieux : « c’était une femme juste. » Je pense qu’elle avait dû lui serrer les boulons dans certaines occasions.
Mon grand père maternel, Fernand, était ouvrier maçon et mandoliniste, lui aussi dans les mariages. À l’époque, les maçons n’étaient payés que les jours où ils travaillaient effectivement. En hiver, il leur arrivait de passer des semaines sans être payés pour cause d’intempéries. Ces périodes étaient vécues avec angoisse et tout le monde scrutait le ciel, attendant le retour du beau temps, en se nourrissant de « olla podrida » sans même un morceau de couenne pour améliorer la soupe. Fernand louchait très fort, mais il était d’usage dans la famille de dire qu’il avait « une coquetterie dans l’œil ». Ma mère ne l’aimait pas beaucoup car il avait battu sa femme. Quand le métier devint trop dur pour son âge, il se recycla comme vendeur au Gagne Petit, sous les arcades de la rue Bab Azzoun.
Ma mère avait deux frères. Elle adorait le plus jeune, Philippe, qu’elle avait pratiquement élevé. Celui-ci est à ma connaissance un des ancêtres du rap : il chantait d’une voix syncopée le texte d’un panneau qu’il rencontrait en allant se baigner à Saint Eugène. Ça donnait à peu près :
Passage
Réservé
Aux locataires d ’ madam’ Binet.

Mon grand père Fernand vers 1900
Tu parles d’une « coquetterie dans l’œil ! »
Les deux frères vécurent une vie sans histoire. En 1962, ils partirent en France où ils moururent à un âge respectable.
J’ai vécu avec l’ainé des deux, Gaby, un petit épisode surprenant. « Rapatrié », il avait été accueilli pendant l’été soixante deux dans un lycée des Sables d’Olonne. Il avait ensuite travaillé comme encaisseur dans une banque au Blanc Mesnil, près de Paris. Au mariage de sa fille Irène, il m’avait pris à part et m’avait confié : « je prends bientôt ma retraite, mais je ne reste pas ici : je rentre chez moi... » Avant que j’aie pu exprimer mes interrogations, il poursuivit : « ... Aux Sables d’Olonne ».
Mais revenons aux années trente. Georges et Fernande se marient le premier juillet 1933. Leur premier enfant Marie Jeanne, naît en 1934 et leur premier fils, Georges, en 1935 (on remarquera l’extrême originalité dans le choix des prénoms). Georges (le père, bien sûr) entre dans son rôle de chef de famille. Il exige de Fernande qu’elle quitte son travail de domestique pour « s’occuper de ses enfants ».
Georges prépare le concours de monteur aux PTT, réussit et part à Paris pour sa formation. Il devient fonctionnaire, ce qui correspond à sa mentalité : sécurité et dignité, même au prix d’un salaire inférieur. Parallèlement, avec son ami d’enfance Baptiste Péréto, il commence à réfléchir à un engagement politique. Il est parmi les premiers à acquérir une action dans Alger Républicain, le journal « progressiste » dans lequel Albert Camus fera ses premières armes. En 1936, à la création du Parti Communiste Algérien, il y adhère et commence un parcours de militant « à la base » qu’il ne quittera jamais, au contraire de Baptiste qui intègrera le Comité Central.
Le Front Populaire est l’occasion de luttes sociales aiguës en Algérie. Malheureusement, le niveau culturel de certains travailleurs laisse à désirer. Dans un défilé où les mots d’ordres sont particulièrement radicaux (« des soviets partout ! ») ma tante Madeleine, épouse de mon oncle Gaby, qui ne comprend pas très bien de quoi il s’agit, scande à tout hasard : « des sommiers, partout ! »
Cela n’enlève rien au caractère dramatique de l’époque. Le cas de François Serrano est particulièrement éloquent. Cadre dirigeant du PCA, il est visé par les commandos de droite. Son frère est assassiné « par erreur » et lui mourra en déportation dans un camp du Sud algérien.
C’est à cette époque faite de résistance et de collaboration avec l’ennemi, d’engagement et de lâcheté, que mes parents ont choisi de m’inviter dans le monde. Je nais rue Curie, dans la côte de la Bassetta, le 11 février 1940. Je reviendrai sur cette rue, mais pour l’instant, l’heure est au départ.
Georges est titularisé aux PTT et est nommé à Tizi Ouzou où il s’attire rapidement la considération des petits notables de la ville qui le cooptent. Calcul funeste de leur part car les Gallinari ruent dans les brancards.
C’est la guerre , les restrictions et les cartes de ravitaillement. Un jour de pénurie particulièrement sévère, on annonce aux mères venues s’approvisionner qu’elles n’auraient pas de lait. Une manifestation spontanée se rend à la sous préfecture et le sous préfet accepte de recevoir une petite délégation. Fernande en fait partie. Le sous préfet tente une manœuvre corruptrice en proposant aux membres de la délégation de les « dépanner personnellement ». Sentant le danger, Fernande sort sur le balcon et annonce aux manifestantes qui attendent : « c’est réglé, monsieur le sous préfet nous a proposé du lait. » C’est le début d’une vie militante. Elle adhérera au PCA après la guerre, en 1946.

Georges et Fernande, mes parents
À Tizi Ouzou, Georges travaille d’arrache-pied. Son métier proprement dit, qui consiste à réparer ou installer le téléphone à travers la Kabylie, l’occupe le plus clair de son temps. C’est la guerre et les pénuries y compris de moyens de transport. Il parcourt des kilomètres à pied, pratique l’auto stop et même (j’ai quelque part une photo), le mulet stop. C’est un homme heureux quand il travaille et en plus, il apprend à connaître la Kabylie dont il finira par connaître toute une partie réellement comme sa poche, habitants compris.
L’engagement des deux parents au parti communiste va marquer toute la famille : les enfants sont persuadés que leurs parents ont fait le bon choix, mais ils sont bien conscients que c’est un choix difficile, qui les place dans une situation de quasi marginalité, en tous cas de particularité dans leur environnement. Deux exemples relatifs à Marie Jeanne et Georges.
Pendant une campagne électorale, Marie Jeanne suit un colleur d’affiche du candidat de droite. Au fur et à mesure qu’il colle ses affiches, elle les décolle. Le colleur, probablement appointé, la réprimande sans agressivité excessive et lui fait remarquer qu’il ne fait que son travail. Réponse de Marie Jeanne, qui a quatorze ans à l’époque, mais qui n’a jamais eu la langue dans la poche : « votre travail, c’est de coller, moi, c’est de décoller ».
Georges invente « le meeting chez Grosoli ». Grosoli est le plus célèbre glacier de Bab el Oued. C’est un fervent partisan de Mussolini, mais surtout, il est propriétaire d’un grand salon rue Lazerges et d’un kiosque minuscule sur la place du marché. Les trois enfants qui dorment dans la même chambre jouent une saynète dans laquelle Marie Jeanne, d’une voix de stentor, appelle la population du quartier à un grand meeting qui aura lieu … dans le kiosque de Grosoli.
Si les communistes sont conscients de leur relative marginalité, ils sont entre eux d’un solidarité exemplaire. D’où le reproche de sectarisme qui est partiellement justifié, mais qui s’explique par la nécessité de faire face à une société globalement hostile. Un exemple : notre camarade Vincent Ivorra déjeune tous les jours chez sa belle-mère, dans un appartement au rez-de- chaussée, rue Nelson Chierico. Malheureusement, cette rue est aussi un terrain de football particulièrement apprécié. Un jour, comme cela devait arriver depuis longtemps, un shoot mal contrôlé brise la vitre de la belle-mère. Celle-ci nous rend le ballon après l’avoir posément coupé en deux. Nous restons désœuvrés, assis au bord du trottoir. À ce moment, Vincent sort de l’immeuble. Il me reconnaît parmi les « footballeurs » : « tu aurais dû me dire que c’était toi qui avais cassé le carreau, on n’aurait pas coupé le ballon ».
Parmi les camarades qui se distinguent dans le quartier de Bab el Oued, il y a Jeannot Farrugia, dont il est question dans la monographie sur la section annexée à la fin de ce texte. Jeannot se caractérise par une audace extraordinaire. Résistant valeureux, déporté dans le camp de Dachau, c’est un agitateur redoutable, qui finit régulièrement par son arrestation. Les camarades s’installent alors devant le Commissariat jusqu’à ce que la police le libère.
Ce n’est pourtant pas un matamore. Il a prouvé pendant la seconde guerre mondiale et pendant la guerre de libération qu’il savait se porter volontaire pour les missions les plus dangereuses et les mener à bonne fin.
Au début des années 50, je fréquente assidûment les meetings du PCA à Bab el Oued. Mon copain Francis me racontait il y a quelques années que les enfants du quartier venaient voir le film soviétique qui était projeté, et sortait avant les discours. Encore une fable inventée par les détracteurs du Parti. Car bien sûr, les organisateurs, pas fous, projetaient le film après que l’auditoire ait encaissé les discours. Pour introduire la projection, un camarade montait sur la scène et proclamait : « Et maintenant, place au film ! ». Je dois reconnaître honnêtement que c’était l’intervention la plus applaudie.
Certains orateurs, pourtant, avaient un certain talent. Je me souviens de l’un d’eux, survolant l’histoire des bolcheviks. Il avait une voix forte : « le journal créé par Lénine s’appelait l’Étincelle (l’Iskra). Et sous le titre, il était écrit : de l’étincelle jaillira la flamme ». Suivait un instant de silence, puis il reprenait : « Camarades,... la flamme a jailli ! ». Le succès était triomphal et même ceux qui n’étaient venus que pour le film se retrouvaient à applaudir à tout rompre.
La famille se livre à des manifestations de type religieux, vécues quand même dans la bonne humeur : tous les ans, le premier janvier, nous chantons l’Internationale au réveil. Mon père, doté d’un goût apparemment très sûr, envisage de faire une photo des trois enfants : ma sœur et mon frère tenant au dessus de ma tête elle une faucille, lui un marteau et moi, assis (j’ai dix ans à l’époque), faisant mine de lire le Capital.
Georges, mon père, poursuit son chemin militant, qui est « agrémenté » par des activités qui s’apparentent au bricolage de haut niveau. Lors d’un Congrès du PCA, il organise avec les monteurs communistes des PTT la collecte d’écouteurs récupérés sur des postes qui sont précisément pourvus d’un écouteur supplémentaire. On fait valoir aux abonnés que ces écouteurs sont la source de dérangements fréquents et que pour leur rendre service, on peut le leur supprimer. Avec ce butin, il réalise pour le Congrès du Parti une installation de traduction simultanée français-arabe.
Tous les ans, il tient un stand à la fête de Liberté, le journal du PCA. Pendant la guerre de Corée, il construit une grande carte du pays à côté de laquelle plastronne un général américain (il s’agit de Mac Arthur) en contreplaqué. Si le joueur parvient à toucher le point représentant Séoul, un pied jaillit de derrière la carte pour botter les fesses du général américain. Clément Oculi, qui tient le stand avec mon père et rabat les chalands d’une voix forte, finit régulièrement la fête aphone.
La fête de Liberté ! Elle a lieu sur un terrain jouxtant le stade Cerdan, à Bab el Oued. Les communistes de tous les quartiers d’Alger viennent donner un coup de main. La SAC (Société Algérienne de Construction créée par le PCA), envoie aussi des ouvriers qui participent au montage. Certains camarades montent des attractions. Henri Domenech, dans une robe d’avocat, joue le rôle du Gouverneur Général. Il se fait complaisamment interviewer par le public. Le genre d’interview, c’est :
Question : comment expliquez- vous que les enfants de ce pays soient aussi peu scolarisés ?
Réponse : si vous connaissiez ce pays et sa population, vous sauriez que les Arabes n’aiment pas l’école.
Il joue le colonialiste cynique avec un tel talent que ma mère, qui le connaît pourtant très bien, l’insulte copieusement. Pour ma part, je préfère le stand où le camarade Pantaloni prépare les meilleurs escargots en sauce piquante que j’aie jamais mangés. Rien que de les évoquer me met encore aujourd’hui l’eau à la bouche.
Alexandre Valéro est dans le « service d’ordre ». Bien entendu, la police envoie des « provocateurs » qui gueulent en feignant l’ébriété des mots d’ordre propres à justifier une descente. Alexandre dit « la varloche » s’approche alors et prend en charge l’individu très gentiment, mais en enlevant quand même ses lunettes. Au moment où personne ne regarde, il décoche un « coup de tête empoisonné » et ramasse « le camarade » qui « a vraiment trop bu et ne tient plus debout ». Du grand art.
Larbi Bouhali, le secrétaire général du PCA est recherché par la police ? Cela ne l’empêche pas de venir faire son discours à la fête, devant deux mille personnes, sous la protection de son garde du corps, Baptiste Pastor et de son chauffeur Belqacem qui l’évacuent à fond la caisse le discours terminé, avant que la police n’ait eu le temps de s’organiser pour intervenir.
En dehors de la fête de Liberté, qui était la manifestation publique la plus importante du PCA, les communistes organisaient tous les étés une excursion en train vers le Corso, à 50 kilomètres à l’Est d’Alger. Les excursions étaient à cette époque à peu près le seul moyen pour les gens modestes qui , bien sûr, n’avaient pas de voiture, de sortir de l’atmosphère étouffante d’Alger pour rejoindre les plages moins fréquentées que celles de la banlieue.
Le Corso présentait donc l’avantage d’être accessible en train, ce qui représentait une sérieuse économie pour les organisateurs. On piqueniquait (un peu loin de la plage) dans un petit bois d’eucalyptus, fortement sonorisé pour l’occasion. La Mairie du Corso, aux mains comme presque toutes les autres, des colons du coin, enrageait bien sûr, jusqu’à ce qu’elle trouve le moyen de se débarrasser de ces excursionnistes encombrants : il fut procédé à un « élagage » c’est-à-dire que les eucalyptus furent réduits à des moignons de deux mètres de haut. L’excursion devenait impossible sous peine de griller au soleil. À ma connaissance, elle fut abandonnée. Les militants de Bab El Oued retournèrent sur les plages de Saint Eugène, avant qu’une nouvelle excursion (en car, cette fois) soit organisée vers la cascade de Bérard.
Il faudrait parler longuement de la Section de Bab el Oued, mais pour ça, je compte sur l’aide de mon camarade Pierre Cots, qui en a été le secrétaire, et que, Dieu merci, je revois régulièrement.
D’abord le cadre : une salle en sous sol dans le quartier de la Consolation, à laquelle on accède par un escalier qui donne directement dans la rue. Cela permet aux enfants du quartier de gueuler des insanités sans savoir (ou en sachant très bien) qui sont les occupants de la salle.

Sur le chantier de la fête de Liberté
de gauche à droite : deux ouvriers de la SAC, Rachid Dali Bey, Baptiste Pastor, Momo Baglietto, Henri Domenech, un camarade que je ne reconnais pas, Georges Gallinari, Martin « petit bidon », Climent.
Ensuite l’intérieur : une salle, donc, au fond de laquelle on trouve quelques petites pièces où se déroulent les réunions restreintes comme les Comités de Section.
Ma mère est membre de ce comité et comme elle ne peut pas me laisser seul à la maison, elle m’y emmène et le moins qu’on puisse dire, c’est que je m’y régale. Les deux protagonistes qui s’affrontent en toute amitié, mais avec vigueur sont Bouali Taleb et Palacio. Taleb a le goût de la rhétorique et ses interventions sont trop longues au gré de Palacio, adepte d’un style plus direct. Pendant que Taleb parle, Palacio marmonne assez fort quand même pour que tout le monde entende : « oui...oui...on s’convaint ». Ce qui bien sûr, a le don de mettre Taleb en colère (c’est même fait pour).
Au point où j’en suis de mes digressions, je voudrais raconter une histoire que m’a raconté récemment Pierre Cots, et qui en dit long sur les méthodes d’agit-prop de Palacio. Un jour que le maire de droite Jacques Chevallier faisait un meeting électoral dans l’école de la rue Franklin, Palacio avait été envoyé pour porter la contradiction. Il faut préciser à ce point du récit que Palacio était doté d’un appendice nasal de dimensions respectables. À l’issue de l’intervention contradictoire de Palacio, Chevallier lui répond dédaigneusement : « Ce que vous dites, monsieur, est totalement erroné ». Palacio, qui était culturellement beaucoup plus proche de l’auditoire, réplique avec hauteur : « Apprenez, cher monsieur, qu’un gros nez n’a jamais défiguré un beau visage ». L’assistance éclata d’un immense éclat de rire. C’était déloyal, mais Palacio avait gagné par K.O.
Revenons à la salle principale de la section. Il me semble qu’elle faisait environ quinze mètres sur dix. Il y régnait un parfum de papier et d’encre de ronéo. Elle était tapissée de tableaux imposants peints par Roland Rhaïs (voir annexe I)représentant les héros du PCA, dont Kaddour Belkaïm, mort en prison en 1940, François Serrano dont il a été question précédemment et Rabah Oussidhoum, membre du Comité Central, commandant dans les Brigades Internationales, mort au combat contre les forces franquistes. J’y passais des après-midi entiers en compagnie de la fille de Gilberte Taleb, et pour passer le temps, je m’adonnais sur le tableau noir à des essais lamentables de dessins d’affiche. L’un d’eux représentait un champ dont on apercevait quelques épis au milieu des quels j’avais écrit : c’est dans les champs de la paix que fleurit le communisme. J’avais dix ans et les copains trouvaient ça génial, pour un garçon de mon âge. C’est à cette époque que je suis devenu le stalinien que je suis encore.

Dr. Gilberte et Bouali Taleb - avril 1954
Puisque j’ai mentionné Gilberte, il faudrait en parler plus longuement. À vrai dire, elle justifierait à elle seule un fort volume. Fille d’une famille juive de Bab el Oued, elle rejoint les rangs du PCA avant la deuxième guerre mondiale, à l’époque où la répression est la plus sauvage. Elle se distingue immédiatement par sa pugnacité et son courage. Elle est rapidement arrêtée, torturée et emprisonnée en même temps qu’un certain nombre de camarades dont Kaddour Belkaïm qui meurt en prison. Dès sa sortie de prison, elle reprend ses activités au sein du parti. Au sortir de la guerre, elle y rencontre Bouali Taleb qu’elle épouse.
Lorsque la guerre d’indépendance éclate, Bouali « monte au maquis » où il trouve la mort les armes à la main. Elle-même est arrêtée et se trouve expulsée d’Algérie vers la France. Libérée à l’indépendance, elle épousera William Sportisse, autre figure éminente du PCA.
Elle sera de nouveau arrêtée et terriblement torturée après la prise du pouvoir par Boumédiène, répression contre l’ORP et le PCA [1] - Enfin libérée, elle finit sa vie active comme secrétaire à la Sécurité Sociale à Alger, dans la Direction de la Prévention, dont la directrice est Marie Rose Péréto.
Voilà une transition assurée. Marie Rose Péréto née Solbès est une militante communiste dès son adolescence. Elle se distingue à la fois par son engagement, son apparente décontraction et un sens politique aigu. Ceux qui ont assisté à ses discussions politiques houleuses avec Baptiste son mari regrettent de ne pas les avoir enregistrées. Entre deux noms d’oiseaux , mari et femme se livraient à des analyses de haute volée. Femme moderne avant l’heure, elle est capable de défendre ses idées en toutes circonstances. Elle était la seule personne par exemple avec laquelle ma mère acceptait de faire du « porte à porte » sans crainte des éconduites grossières ou brutales. Elle fait toute sa carrière à la Sécurité Sociale et elle contribue, l’indépendance venue, à la construction de la Sécu algérienne.
La figure de Georges Acampora, autre secrétaire de la section de Bab el Oued, est plus célèbre. Sapeur pompier à Alger après 1945, il participe pendant la guerre d’indépendance à l’attaque du Commissariat de la Redoute. Arrêté, il est condamné à mort. Il aura plus de chance que Fernand Iveton et ne sera pas exécuté. Il continuera son travail de sapeur pompier après l’indépendance et il finira sa carrière au grade le plus élevé, celui de colonel. Il vit encore aujourd’hui à Bab el Oued où il jouit d’un respect affectueux de la part de toutes les couches et de tous les courants politiques du quartier. [2]
Plus je vieillis et plus je crois que tout être humain peut trouver un domaine dans lequel il peut s’épanouir et devenir excellent . Ainsi de Baptiste Péréto. Il avait été mandaté par la CGT pour mobiliser les dockers du Port d’Alger . Il réussit au-delà de toute espérance. Bien que ne parlant pas l’arabe, il parvint à créer avec les travailleurs une entente totale. Il mena avec eux des actions spectaculaires. Par exemple, pendant toute la guerre du Vietnam pas une seule arme destinée à l’armée ne fut débarquée ou embarquée du port d’Alger. Aujourd’hui encore et donc soixante ans après ces actions d’éclat, d’après mes camarades d’Alger, son nom est connu et respecté chez les dockers.
Repartons à Tizi Ouzou pendant la deuxième guerre mondiale, là où je nous ai laissés quelques pages plus haut.
Nous sommes en 1944. Mon père avait enfin reçu une moto qu’il utilisait pour ses déplacements. Il ne s’en félicita pas longtemps car il fut fauché par un camion dans la ville même : fracture ouverte tibia et péroné, genou écrasé, auriculaire arraché. Dix neuf mois alité, il sauvera sa jambe tout seul, car les médecins unanimes voulaient la lui couper. Pour cela, il invente un système original : sa jambe étant complètement infectée, il ouvre le plâtre sur toute sa longueur, saupoudre régulièrement la jambe avec des sulfamides (les antibiotiques n’étaient pas encore sur le marché) et referme le plâtre avec des bouts de ficelle. Au bout de quelques semaines, il a l’immense soulagement de constater que l’infection recule et que les os commencent à se ressouder. Il s’en sortira avec d’énormes cicatrices, un soulier orthopédique, mais, reconnu invalide à 80%, il continuera son travail aux PTT.
Il est vrai que les choses s’arrangent professionnellement : après des années de préparation, il passe le concours de conducteur de travaux (équivalent actuel du grade d’inspecteur). Il est reçu, mais l’Administration ne l’entend pas de cette oreille. Elle s’aperçoit après coup qu’il était trop jeune à la date du concours et annule sa nomination. Après de multiples démarches, il intente un recours auprès du Conseil d’État. Il attend dix ans une réponse et pendant toutes ces années nous calculons l’énorme rappel qu’il toucherait quand il serait rétabli dans ses droits. Las ! Au bout de dix ans, le Conseil d’État lui répond qu’il n’a pas respecté les délais de recours et que celui-ci n’a donc pas pu être examiné. Ils sont rapides, au Conseil d’État ! Il est vrai que, même après dix ans, leurs décisions sont toujours recevables.
J’ai toujours admiré mon père, mais, avec le temps, je crois que c’est là qu’il m’a le plus impressionné : il accueillit la nouvelle avec philosophie et finira sa carrière dans l’administration française en 1962 sans avoir obtenu réparation.
Nommé à Alger en 1945, il occupe en fait des fonctions d’inspecteur en attendant la décision du Conseil d’État, par la Direction locale qui le tient en haute estime. Nous habitons Cité de la Consolation, près de la Section de Bab el Oued dont il a déjà été question. Pour l’instant, nous fréquentons surtout l’amie d’enfance de ma mère que nous appelons tata de Jacky, du nom de son fils aîné, et son mari, notre « tonton Édouard » que nous adorons. Sans vouloir voir les choses de façon simpliste, on est bien obligé d’admettre que Jacky évolue vers les positions politiques (si on peut appeler ça comme ça) qui finiront par triompher dans la communauté « pied noir ». Édouard est docker et on vient d’acquérir sur le port des chariots élévateurs qu’on réserve aux permanents, c’est-à-dire, à quelques exceptions près, aux Européens. Encore faut-il avoir le permis. Tonton Édouard s’y présente et échoue. Réflexion du fils : « comment peux-tu échouer au permis de conduire ? Même les Arabes réussissent ! »
Je voudrais faire ici une mise au point. L’appellation « pied noir » est relativement récente. Elle est née, si je ne me trompe, avec les problèmes de décolonisation au Maghreb. Je la récuse totalement pour moi et pour les miens, c’est-à-dire pour tous ceux qui ont toujours refusé le fait colonial. Je chercherai une autre appellation. Pour l’instant, celle qui me paraît la plus juste est : Algérien immigré.
Encore que, pour être tout à fait honnête, mon identité soit ailleurs : l’Algérie est mon pays, je respecte la France puisque j’y vis, mais ce qui me caractérise, c’est que je suis communiste. À ma façon bien sûr, puisqu’il y a aujourd’hui plusieurs façons d’être communiste, mais communiste avant tout. Je me souviens d’un petit bouquin d’une dizaine de pages de Liu Tchao Tchi. Ça s’appelait : “pour être un bon communiste”. Je l’avais dévore bien sûr : dix pages pour être un bon communiste, ça valait le coup, même pour un gamin de dix ans. J’avais été un peu refroidi dès la première condition : payer sa cotisation. Mais je l’avais quand même lu jusqu’au bout.
En 1946, mon père est nommé à Bougie où la famille passe une année paradisiaque. Riche de l’indemnité perçue pour l’accident, nous sommes abonnés au cinéma (au balcon de côté quand même) Nous habitons un appartement qui donne sur une coursive où habite également la famille d’un pêcheur.
Le père Focone nous assure le poisson tous les jours. La vie se déroule dans une ambiance extrêmement plaisante, sauf pour mon frère Georges qui bénéficie d’un instituteur particulièrement brutal. Mon père, bien sûr, n’interviendra jamais. Ma sœur Marie Jeanne, par contre, règle le problème. Elle est dans la classe de la fille du fameux instituteur à la main lourde. Elle décide de battre sa fille chaque fois que le maître frappera son frère. Georges bénéficie à partir de ce moment d’une immunité parfaite.

Sur le port de Bougie, Georges, Fernande, et moi.
Nous ne restons qu’un an à Bougie et mon père rejoint son poste à Alger.
En plus des poissons du Père Focone, j’ai de Bougie un autre souvenir gustatif. Tous les matins passaient des vendeurs de croissants et brioches qui sont certainement les meilleurs que j’aie mangés.
La question qui se pose, et à laquelle je n’aurai peut-être pas le courage d’essayer de répondre, c’est : où sont passées ces compétences qui existaient au sein de la communauté algérienne ? On ne peut nier que les savoir faire ont fortement régressé pendant des dizaines d’années après l’indépendance, même si, par un processus contradictoire qui fait les délices du petit intellectuel marxiste que je suis, de grands progrès aient été faits dans certains domaines. Mon père pensait , sans trop s’expliquer sur le pronostic, qu’il faudrait deux générations avant que la société algérienne dépasse le traumatisme de l’aliénation coloniale. À l’époque nous le taxions de pessimisme. Aujourd’hui, nous espérons que deux générations suffiront.
Au retour à Alger, mon père qui n’a pas d’appartement fait sa demande à la Mairie « progressiste » qui avait été installée après la guerre. Il reçoit une réponse cinglante, comme s’il avait demandé une faveur indue. Un camarade qui devait se croire gardien du dogme lui répond avec hauteur : « nous sommes ici pour servir, et non pour nous servir ». Résultat, nous nous retrouvons hébergés chez mon grand père Joseph.
En 1946, mon père fait « l’école du parti » dirigée par André Marty, et devient secrétaire départemental du syndicat CGT des PTT. Le dernier jour de l’ « école », André Marty fait un cours sur la clandestinité. Les élèves écrivent soigneusement et en grosses lettres le titre du cours. Grosse colère de Marty : « dans la clandestinité, on n’écrit rien en clair ».
La situation est intenable pour ma mère que mon grand père traite un peu comme sa domestique. L’homme, on l’a dit, est spécial. Il emprunte un jour une échelle aux Cazassus, pour repeindre sa cuisine. L’échelle s’avère trop grande, qu’à cela ne tienne : il la coupe en deux. Le travail fini, il restitue en toute honnêteté les deux morceaux aux Cazassus.
Un soir une altercation éclate et ma mère décide que nous devons partir immédiatement chez mon oncle Gaby, à qui elle a laissé autrefois l’appartement où je suis né en 1940, rue Curie, dans la côte de la Basseta. Nous y restons deux ou trois ans, le temps pour ma mère de soigner ma tante qui manque de mourir d’une méchante typhoïde et pour moi, qui dors dans la chambre de mon grand père (celui de la « coquetterie dans l’œil »), d’assister mille fois au cérémonial immuable de l’habillage du grand père, qui finit par nouer son foulard et remonter sa montre gousset, dont il cache la clé dans un petit papier plié.
Nous nous amusons aussi beaucoup avec nos cousines, avec lesquelles nous inventons des histoires que nous jouons comme des pièces de théâtre. Je me rappelle ma cousine Jeannette dans une pièce censée se passer en Espagne qui entre dans la chambre en disant d’une voix forte : « que volls, mama ? » (que veux-tu, maman, dans l’ancien valencien que les Carrio parlaient). Nous avions beaucoup ri car nous ne nous attendions pas à ce qu’elle pousse l’exotisme jusque là.
La rue Curie se compose de deux culs-de-sac donnant sur une même volée d’escalier. Les voitures ne s’y engagent pratiquement jamais et c’est une situation idéale pour les enfants qui peuvent y jouer sans danger.
Un le brun
Deux la queue
Trois la croix
Quatre la patate
(comptine pour saute-mouton,rue Curie)
Et le moins qu’on puisse dire est qu’ils ne s’en privent pas : gigantesques saute moutons, « fava vinga » (un jeu où le « mouton » est composé d’une dizaine de gosses qui gigotent pour essayer de faire tomber celui qui s’y risque). Pour ma part, je joue surtout au « Tour de France » avec mon copain Pierrot. Il s’agit de propulser par des pichenettes des bouchons de limonade sans quitter la bordure du trottoir. Nous y passons des heures sous l’œil bienveillant de sa mère qui habite avec lui au rez de chaussée. Pierrot perdra très tôt sa mère. Je l’ai revu quarante ans après, il n’en était toujours pas consolé.
Heureusement, il y a des situations moins tristes ; La topographie particulière des lieux permet par exemple l’organisation d’un quatorze juillet pour lequel une énorme profusion de guirlandes multicolores sont tendues entre les immeubles qui se font face.
Tous les ans, le quartier vit pendant trois semaines à l’heure du Tour de France. Parmi les équipes engagées au début des années 50 figure une équipe d’ « Afrique du Nord » (à l’époque AFN : Afrique Française du Nord). Les résultats ne sont pas spécialement brillants, sauf à deux ou trois reprises.
Abdelkader Zaaf est probablement le cycliste le plus doué, quoiqu’un peu fantasque. Le jour de l’étape Marseille-Nice, on apprend au journal radio de 13 heures qu’il est échappé et qu’il a déjà 20 minutes d’avance. C’est la liesse dans le quartier où, dans ces circonstances, le racisme disparaît comme par enchantement. On attribue quand même la performance à la canicule que les coureurs d’Afrique du Nord supportent mieux.
Malheureusement, les spectateurs qui donnent à boire aux coureurs leur passent souvent des canettes de bière et Zaaf se trouve rapidement dans un état second. Presqu’arrivé à Nice, il s’arrête et repart en sens inverse. Il a bientôt la surprise de voir le peloton en face de lui. L’échappée est terminée.
Il y a aussi, et c’est beaucoup plus intimiste, les retours nocturnes de messieurs Journet et Tamburini. Les deux amis sont de paisibles piliers de bars. À la fermeture, vers minuit, ils rentrent rue Curie où ils habitent précisément dans deux immeubles qui se font face. Ils devisent à voix suffisamment haute pour incommoder le voisinage et surtout, ils s’éternisent dans des aller-retours entre les deux immeubles. Arrivés devant la porte de Journet, celui-ci qui, visiblement, a des difficultés à se séparer de son copain, lui propose de le raccompagner chez lui. Et réciproquement. Jusqu’à ce que le voisinage, excédé, proteste bruyamment et mette fin aux allées et venues
Nous déménageons enfin pour un appartement voisin. C’est un appartement d’une pièce cuisine. Mes parents dorment dans la cuisine et les trois enfants dans la salle à manger. Les cabinets sont communs à une dizaine de locataires, dont les appartements donnent tous sur la même cour. Schéma méditerranéen relativement classique, auquel d’ailleurs nous nous accommodons plutôt bien. Tôt le matin, Lolo, le grand laitier maltais (qui mouille son lait sans vergogne), passe. Il a un mot pour tout le monde, avec une prédilection particulière pour une de nos voisines, demoiselle de cinquante ans. Il l’interpelle, dans ce fameux patois que je prends pour du valencien, mais qui est peut-être la lengua franca, qu’on parlait à Alger avant la conquête française : « Marilou, si l’agares es pera tu » (Marilou, si tu l’attrapes, il est pour toi) Inutile de dire que la demoiselle proteste par une bordée d’injures.
Il y eut à Bab el Oued au début des années 50 un débat culturel intense. Alors que le règne de Luis Mariano paraissait assuré pour longtemps à travers les opérettes de Francis Lopez qui mettaient en valeur sa superbe voix de ténor, il était apparu un rival qui se présentait lui-même comme "l’émule de Luis Mariano". La comparaison mobilisait les gens. Ma mère, habituée aux luttes difficiles et incertaines, trouvait à l’émule des qualités telles qu’elle le soutenait dans son combat pour la célébrité. D’autres n’hésitaient pas à ironiser à son propos.
Les choses auraient continué ainsi, n’était l’apparition de l’émule au "Petit music-hall du Dimanche". Dans un passage difficile de "Andalousie", un tube de Luis Mariano, le malheureux chanteur produisit un couac qui laissa l’assistance de glace. Tout le monde se reprit pour applaudir chaleureusement, mais la cause était entendue. Avec l’humour léger qui caractérisait les gens du quartier, on entendit un peu partout que non seulement le chanteur n’était pas l’émule de Luis Mariano, mais qu’il n’était même pas digne d’être sa mule.
C’est à cette époque (août 1951) que nous passons quinze jours merveilleux sous la tente à la “Plage des Fontaines”, près de la Madrague, avec la famille de Joseph Grau, notre ami Pico, le trésorier de la section de Bab El Oued. Avec la fille de Pico qui a mon âge (onze ans), j’apprends à pécher et à nager. Nous passons nos journées à explorer les trous d’eau de mer et la faune qui y habite : « escargots à pattes » (pagures) qui constituent l’essentiel de nos appâts, et « cabotes » (gobies), malheureux petits poissons dont la gloutonnerie est telle qu’ils ne résistent même pas aux stratagèmes pourtant naïfs des pécheurs débutants.
Aujourd’hui (avril 2013), alors que je suis à l’hôpital à Montpellier (à l’hôpital, pas encore à l’agonie), si on m’offrait de revivre quinze jours de ma vie, je crois que ce sont ces quinze jours là que je choisirais.
D’autant plus que la Plage des Fontaines est devenue l’exemple même du paradis perdu : constructions hideuses, pollution qui a fait fuir depuis longtemps pagures et gobies, et pour couronner le tout, population d’intégristes qui se baladent en qamis au bord de l’eau. L’un d’eux dira, apercevant mon épouse : bismillah errahman errahim, jat mra ! (au nom de Dieu tout puissant et miséricordieux, une femme !)
Dans le pays, les luttes sociales s’aiguisent, préludes au soulèvement qui vient. En Août 1953, une grève particulièrement violente éclate aux PTT. Mon père est le seul dirigeant syndical à ne pas être arrêté, parce qu’il se trouve en congé régulier au moment où elle démarre. Il en profitera pour animer le mouvement et versera bien sûr à la caisse de solidarité, les salaires perçus pendant la grève.
Ma sœur Marie Jeanne est secrétaire à Alger Républicain. Elle aussi ressent la tension annonciatrice d’autres formes de lutte. Le journal est régulièrement saisi, et parfois contraint de paraître avec des articles supprimés sans être remplacés ; les espaces blancs sont autant de protestations et d’avertissements. Ils disent à l’administration : vous ne pourrez pas éternellement empêcher l’information de circuler. La devise d’Alger Républicain à cette époque est : “Alger Républicain dit la vérité, rien que la vérité, mais ne peut pas dire toute la vérité.”

Georges Gallinari pendant la grève d’Août 1953
La guerre d’indépendance éclate. On sent immédiatement que rien ne sera plus comme avant, mais on attend que la légitimité du mouvement soit avérée. Plusieurs sigles apparaissent CRUA, MNA, FLN. Des campagnes douteuses sont lancées (on va couper le nez de tout Algérien surpris à fumer en public). Lors du premier coup de main, un instituteur est abattu : il y a de quoi hésiter. Le PCA, pourtant , n’hésite pas. Le 2 novembre 1954, il publie une déclaration d’une lucidité tellement magistrale qu’elle sera régulièrement falsifiée par ses adversaires colonialistes ou ses partenaires nationalistes. Elle situe la responsabilité du conflit au niveau des forces colonialistes, et demande la mise en œuvre d’une solution démocratique qui sauvegarderait les intérêts de tous les Algériens, sans distinction de race ni de religion. Ce n’est pas ici le lieu de la reproduire, mais ceux qui sont intéressés peuvent en trouver le texte sur Internet.
Mon père avait choisi son camp depuis longtemps. Il prend part aux activités clandestines organisées par le PCA. Pour continuer à privilégier le petit bout de la lorgnette, je raconterai ici un rendez vous clandestin que mon père avait avec un autre militant qu’il ne connaissait pas. Il arrive au rendez vous affublé de son chapeau passablement avachi, et d’un imperméable mastic. Le copain arrive dans la zone, aperçoit mon père un peu plus loin et rebrousse chemin. Présentant son rapport à la structure dans laquelle il travaillait, il annonce : « je suis allé au rendez vous, mais il y avait là bas un type qui avait tout l’air d’un flic. J’ai préféré m’éclipser. »
Toujours à propos du chapeau, mon père avait eu un accrochage dans le bus avec un individu qui l’avait accusé de porter un chapeau « koukra ». La koukra (orthographe non garantie) est un petit insecte marin qui vit en colonies sur les rochers. Les pêcheurs en font une pâte pour amorcer (à Alger, on disait « broumitcher ») et conservent cette pâte souvent dans un vieux chapeau humide. L’expression « chapeau koukra » a provoqué un fou rire général quand mon père nous l’a rapportée.
Mon beau-frère José intègre notre famille politique. Il a choisi pour cela l’époque la plus dangereuse. Lorsque le FLN décrète une grève générale, il fait grève avec ses collègues « musulmans » dans l’usine de menuiserie industrielle où il est considéré comme l’un des meilleurs ouvriers. C’est la stupéfaction parmi ses collègues pied-noirs, qui du coup l’attendent au tournant. Façon de parler car quand la grève se termine, mon beau-frère se rend à l’endroit où il attend d’habitude la camionnette de transport du personnel. Celle-ci passe devant lui sans s’arrêter. Il est licencié et se retrouve ouvrier de main d’œuvre exceptionnelle aux PTT. Il y poursuivra sa carrière à force de concours internes et terminera chef de secteur.
Nous sentons bien, à la maison, que mon père est engagé dans des actions dangereuses, mais bien sûr, nous n’avons aucune idée de ce qu’il fait, en particulier de ses soirées.
Il reçoit un jour la visite d’un camarade de Constantine qui prépare sa montée au maquis. Il passe à la recherche d’armes. Mon père a bien eu à une époque un petit 6,35, mais la police lui a demandé de le déposer dans ses locaux dès le début des « événements ». Il ne peut donc rien pour Siméon qui montera au maquis pour y être exécuté par ceux aux côtés desquels il était venu combattre l’armée coloniale.
Comme il fallait s’y attendre, la police (en l’occurrence la DST) débarque chez nous un matin, le 6 novembre 1956. Les flics se livrent à une perquisition en règle et emmènent mon père. Nous avons appris la suite plus tard.
Les policiers sont venus avec deux tractions avant. Ils bandent les yeux de leur prisonnier, et font des tours et des détours pour l’emmener à la Villa Sesini, tristement célèbre pour les tortures et les exécutions sommaires. On le conduit sans ménagements dans un bureau où on lui enlève son bandeau. Mon père n’en mène pas large, mais il risque avec une voix douce : « vous m’avez emmené directement dans le bureau du commissaire principal ? » Réponse furibarde du policier : « tu le connais, toi, le bureau du commissaire principal ? » Réponse, gênée : « bien sûr que je le connais, c’est moi qui ai installé le téléphone ». Un ange passe.
Après un interrogatoire relativement calme, le prisonnier est jeté dans une cellule où l’attente commence. Elle ne dure pas très longtemps : la nuit venue, débarque Ousmeur, un officier de police que mon père avait connu en Kabylie. Ousmeur chuchote : « Georgeot, si tu as quelque chose, donne le moi, parce qu’ils vont te fouiller » « Georgeot », pas très confiant, et qui en plus n’avait rien sur lui de compromettant, remercie quand même l’officier kabyle. Plus tard, interné à Lodi, il apprendra que Ousmeur était effectivement un homme du FLN, et qu’il avait été arrêté.
Il fait également la connaissance d’Anne-Marie Chaulet, membre du réseau chrétien d’aide au FLN. On la jette dans la même cellule où elle se mure dans un silence obstiné, refusant même de s’alimenter. Georges, pragmatique, essaie de lui faire valoir que si elle veut tenir le coup, il vaut mieux qu’elle mange un peu. Mais Anne-Marie, comme elle nous le dira plus tard, le prend pour un « mouton » et refuse même de lui parler.
Apparemment, la police ne trouve pas grand chose à lui reprocher, car Georges est rapidement envoyé dans un camp d’ « hébergement administratif » près de Médéa, à Lodi. En fait, il s’agit d’une ancienne colonie de vacances reconvertie en camp d’internement. À vrai dire, la vie n’y est pas trop dure et les visites sont même autorisées, du moins au début, car les choses se gâtent un peu, sans devenir dramatiques, après quelques mois. Nous sommes accompagnés chaque dimanche, jour de visite par le beau père de mon frère qui, malgré sa réputation sulfureuse, se montre d’une amitié remarquable. C’est d’ailleurs un homme pour lequel nous aurons toujours beaucoup de sympathie et d’estime.
Georges ne s’éternise pas au camp de Lodi. Interné en novembre, il est « muté » quelques mois plus tard en France, à Brioude, en plein milieu de l’Auvergne, dans un environnement où tous ses faits et gestes pourront être remarqués, même s’il ne fait l’objet que de contrôles périodiques. Comme à son habitude, il voit surtout le côté positif des choses. Au départ, Brioude est pour nous un peu la planète Mars : les gens nous observent avec curiosité, la plupart du temps sans même nous dire bonjour. Par contre, nous avons toutes les peines du monde pour payer le camionneur qui a transporté notre déménagement Heureusement, les communistes du coin nous prennent en main : Marcel Amalou nous ramène des disques et des livres, accompagnés de longs commentaires de sa main, Loulou Chacornac nous abreuve de sa délicieuse gouaille et Jean Aubier, le collègue de travail passe des après midi chez nous à jouer aux cartes et à discuter.
Dégringolé sans douleur dans la hiérarchie des PTT, Georges et son partenaire Thouzet sillonnent le canton en camionnette deux chevaux. Ils boivent chez les gens qu’ils dépannent l’abominable piquette du coin (mon père l’accusera de lui avoir donné la goutte). C’est pour l’Algérois qui n’avait pas souvent quitté son pays un plaisir permanent. Quand il part aux confins du département, il revient en chantant presque le nom du village : Chanaleilles. Quarante ans plus tard, parti de Montpellier en randonnée-pèlerinage avec mes enfants, j’entrerai en Haute Loire par Chanaleilles, apercevant tout de suite avec émotion une... cabine téléphonique.
Malgré tout, et surtout à cause du climat, ma mère marine un peu dans la nostalgie. Juliette Amalou et madame Garrel gardent bien le contact avec elle, mais elle chante souvent une chanson adaptée du hit parade de l’époque : « quand le bateau arrivera... en Algérie ».
Quant à moi, je fais feu de tous bois. Je décroche (de justesse) mon bac, et je commence une carrière de godelureau dans les bals de la région. Ce sont souvent des « parquets salons », c’est-à-dire des baraques démontables dans lesquelles sévit un orchestre composé quelques fois d’un seul musicien accordéoniste assurant lui-même la rythmique avec une cymbale à pédale (un « charleston »).
Ces baraques sont des hauts lieux de culture. Le musicien invente des paroles sur les musiques qu’il joue. Sur l’air de Caminito, un tango argentin particulièrement sentimental, il chante avec un merveilleux accent auvergnat :
C’était un charcutier
Qui coupait des andouilles
Le couteau a glissé
Il s’est coupé... les pieds
Mon frère et ma sœur, mariés tous les deux, sont restés à Alger et viennent nous voir aux beaux jours. Je les trimballe dans une Fiat antédiluvienne à travers le département. Mon copain Denis, authentique auvergnat, nous sert quelques fois de guide. Il deviendra quelques années plus tard secrétaire national de la CGT.
Le bac obtenu, on me propose une bourse si je rentre en classes préparatoires aux grandes écoles. Il y a longtemps que je suis en terre inconnue et personne dans ma famille ne peut me conseiller, puisque personne n’y a jamais dépassé le certificat d’études primaires. Ce qui emporte la décision c’est que je vais être interne à Clermont-Ferrand, avec ce que cela suppose d’encadrement et... d’économie. Je suis quand même conscient de ne pas être l’élève typique de ce genre de filière et effectivement, je vais y souffrir. Non pas que les études soient spécialement ardues, ce qui est le cas, mais surtout parce que je suis incapable de m’y intéresser en profondeur. Je me contente de me cultiver, et ce n’est pas ce que l’on demande à ce genre d’élèves qui ont souvent une mention très bien au bac, ce dont je suis très loin, et qui se farcissent les annales des concours des écoles dans lesquelles ils veulent « intégrer ».

À Brioude, on fête (devant une bouteille vide)
Le succès d’une fusée soviétique
de gauche à droite : Denis Troupenat, Fernand et Georges Gallinari
Moi, j’ai seulement le souvenir vivace de Popeye, notre prof de maths, décortiquant avec une maestria merveilleuse un problème de géométrie descriptive, parcourant une à une les étapes de la démonstration, et finissant, en grand acteur, la sueur perlant au front : « ce que nous avons cherché pendant presque une heure, n’est qu’un...demi cercle ». J’avais envie de me lever pour applaudir, mais je crois que cela aurait été mal vu.
En dehors de ces cours que j’arrive, quand je peux, à prendre comme des conférences de culture générale, ces années de classes préparatoires sont pour moi des années d’internat. Il y avait déjà l’exil, mais voilà qu’il faut en plus vivre loin de mes parents. Là encore, je m’adapte. J’ai de bons copains, et je m’initie au jazz. Pour cela, je me laisse enfermer dans le foyer au lieu d’aller en cours et je me repasse en boucle les quelques 78 tours de la « discothèque ». Deux airs me reviennent encore aujourd’hui. L’un de Milton Mezz Mezzrow (when you and I were young, Maggie) , l’autre, l’immortel « Saint Louis Blues » de Louis Armstrong, qui me suivra, je le sais, jusqu’à la mort.
Ce chef d’œuvre absolu est né, entre autres événements, de la rencontre de deux hommes : le génial Armstrong, fils d’esclave, et l’Amérindien Jack Teagarden, immense joueur de trombone, rescapé du génocide de son peuple. Comment ces deux hommes, ces deux « damnés de la Terre » ont pu se rencontrer dans un faubourg de la Nouvelle Orléans ou de Chicago pour intégrer un jour le Panthéon des grands musiciens du 20ème siècle , certains historiens le savent peut-être, et cette histoire serait plus intéressante à raconter que bien des escroqueries historiques qui ont depuis longtemps envahi l’imaginaire collectif. En tous cas, quelle magnifique leçon d’humanité !
À propos d’escroquerie historique, il m’en vient une qui n’a pas vraiment sa place à ce niveau du récit, mais que je crains d’oublier. Il s’agit de Roland de Roncevaux. J’ai été nourri, dans l’école française d’Algérie, d’une légende selon laquelle le « bon Roland », qui assurait l’arrière-garde de l’armée de Charlemagne revenant d’Espagne, avait été assailli et tué avec ses hommes par d’infâmes « Sarrasins » (les Sarrasins avaient déjà bon dos à l’époque), et qu’il était mort en sonnant du cor pour alerter ses compagnons d’armes.
Il m’ a fallu cinquante ans pour apprendre la vérité. Roland était un salaud de la pire espèce qui avait profité de l’expédition franque pour mettre à sac la ville de Pampelune, dans le but de constituer pour lui et ses hommes un trésor de guerre, en assassinant allègrement femmes et enfants. Les Basques s’étaient lancés à sa poursuite et l’avaient rejoint à Roncevaux où ils lui avaient fait payer ses crimes, tandis que le « preux » Roland s’époumonait à sonner du cor pour appeler au secours l’armée qu’il était censé protéger. Voilà, c’est noté. On peut reprendre le fil du récit.
Au Lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, il y a aussi Gerson, le factotum. C’est un homme d’âge indéterminé, probablement la quarantaine, mais il fait plus vieux car il picole. C’est un conteur de grand talent et il n’est pas toujours facile de distinguer le vrai de l’imaginé dans ce qu’il raconte. Quand il se rappelle ses parents nourriciers (c’est un enfant de l’Assistance Publique), ses accents de sincérité ne trompent pas.
Par contre, quand il nous raconte avec un grand luxe de détails que lors de sa visite à Clermont, le général de Gaulle l’avait reconnu dans la foule, on est quand même un peu sceptiques. Ça donne à peu près :
– Bonjour, Gerson, qu’est-ce que vous devenez ?
– Toujours le même, avec vous, mon général
– C’est bien, Gerson, c’est bien, bonne continuation.
J’ai la chance de faire partie de ceux qu’il reçoit dans ses appartements. Ils sont évidemment très exigus et plutôt mal entretenus. Il nous offre un vin infâme qu’il nous sert dans des verres qui n’ont jamais été lavés et qui sont rouges de tanin. Mais il faut passer par là si on veut écouter ses histoires.
Nous sommes encore dans le « vieux lycée ». C’est un bâtiment plein de charme, mais au confort sommaire. En particulier, les classes sont chauffés avec des poêles à sciure. Ces appareils sont remplis par Gerson très tôt le matin, mais ils ont quand même besoin d’un temps considérable avant d’atteindre leur pleine efficacité. Si bien que de huit à neuf heures, on gèle. Mais à un certain moment, on entend une petite explosion dans le poêle (on dit qu’il fait son rôt), et à partir de là, c’est l’enfer. On finit la matinée en bras de chemise, et en sueur.
J’apprends à vivre avec les enfants d’une certaine France, ceux qui veulent rester du bon côté de la barrière ou éventuellement y accéder. Ils sont souvent très sympathiques, mais c’est un milieu auquel je suis étranger. Je discute politique pied à pied, mais en pure perte. Il est vrai que ce sera le cas une bonne partie de ma vie, et que ce n’est pas fini.
Parmi mes condisciples , il y a Jacques Julhard. Nous avons en commun l’aversion envers le système que nous subissons au Lycée, mais lui va beaucoup plus loin. C’est un authentique révolté alors que la situation de mes parents freine mes velléités de rébellion.
Il est exclu à la fin de la première année et je ne le rencontre plus que lors des sorties du jeudi après midi. Nous nous retrouvons au Batoum, un bistrot dont la serveuse est sympathique et le jukebox bien garni (c’est là que je fais connaissance avec Big Bill Broonzy).
Malheureusement, la révolte le mènera un pas trop loin. Un jour, après notre après-midi au Batoum, il emprunte une voiture, perd le contrôle du véhicule et se tue. Quarante ans plus tard, une de mes randonnées auvergnates démarre par Besse en Chandesse, sa ville natale. Je vais au cimetière où je ne tarde pas à trouver sa tombe. Je m’y recueille en pensant à ces quarante ans de vie perdus pour rien, et à la douleur de ses parents dont il était l’unique enfant.
Je me souviens d’un autre camarade de classe , un aristocrate venu de Moulins. Lui aussi était perdu dans cet univers de forçats, mais comme moi il faisait le dos rond et nous passions le plus clair des études du soir à fumer dans les couloirs. Il avait quitté la prépa en deuxième année. Les manifs à propos de la guerre d’Algérie étaient nombreuses et quelques fois houleuses. Un jour, nous nous sommes retrouvés face à face dans deux cortèges adverses. Il m’a regardé avec un sourire et il m’a dit : « on ne va quand même pas se taper sur la gueule, nous deux ». On a changé tous les deux de place dans la manif.
En dernière année, j’ai établi un record qui peut être égalé mais ne peut plus être battu. J’ai été renvoyé de l’internat le jour de la rentrée. Nous étions arrivés la veille au soir et avec quelques copains, nous avons décidé de faire le mur pour aller au cinéma voir « La soif du mal » avec Orson Welles. En revenant, nous avons été accueillis par les aboiements pitoyables du cabot du surveillant général, et les lits qui nous avaient été réservés avaient été attribués à d’autres élèves en notre absence. Nous nous sommes réfugiés à l’infirmerie, mais au petit déjeuner, on nous signifia notre renvoi de l’internat.
Mon père débarque à Clermont et trouve une chambre bon marché chez la comtesse d’Auteroche. Je ne l’ai jamais demandé, mais j’imagine qu’il s’agissait des descendants du gars de la bataille de Fontenoy, celui qui avait dit : « tirez les premiers, messieurs les Anglais ! »
La chambre est merveilleusement vieillotte et pas chauffée, ce qui, à Clermont Ferrand l’hiver, est difficilement supportable. Mon père me confectionne un radiateur avec une boite de conserve, mais en principe, l’usage de radiateur est interdit, pour cause de consommation électrique. Les propriétaires, je crois, ferment les yeux, et moi je chauffe au minimum. Chacun dans notre genre, nous sommes des gens bien élevés. Un jour madame d’Auteroche mère tombe et se casse probablement le col du fémur. Sa fille me demande de l’aider à la transporter dans son lit : elle est légère comme une plume. Elle décèdera rapidement, mais cet épisode a encore renforcé la bienveillance dont je bénéficiais jusqu’ici.
A cette époque, j’intègre l’équipe de football d’un village voisin, Paulhaguet. C’est une équipe fort modeste, de première division départementale, mais elle bénéficie d’une couverture médiatique par la Montagne, le journal de la région. Je ne désespère pas d’aller un jour dans les archives du journal à Clermont rechercher l’article où est écrit : Gallinari ouvre le score d’un superbe centre shoot. D’autant plus que personne ne se souvient aujourd’hui que cette superbe ouverture de score était une reprise manquée.
Une fois de plus, je m’égare dans mon récit. Revenons à Clermont : la fin de l’année universitaire arrive et je me présente à un certain nombre de concours. Personne ne me croit capable d’en décrocher un, même mon professeur de physique, monsieur Chaleteix qui m’aime bien mais qui me considère à juste titre comme un doux fumiste. Il m’a souvent menacé de me mettre à la porte pour provoquer des réactions de ma part. Il les obtenait d’ailleurs car malgré mon inadaptation, j’étais conscient du sacrifice de mes parents qui avaient renoué à Brioude avec la « olla podrida sans couenne » pour assurer mes études. Et effectivement, le miracle a lieu : je suis admis à une école d’ingénieur située à Rouen . C’est un peu loin, mais je n’ai pas le choix, car c’est ma seule réussite.
C’est d’autant plus loin que (nous sommes en 1961), la fin de la guerre d’Algérie se profile et que pour préparer le retour au bercail, mon père a obtenu sa nomination à Marseille, à l’autre bout de la France. Dès 1962, ma famille rentre à Alger et je ferai pendant trois ans la navette entre Rouen et Alger, avec des arrêts à Clermont où je rejoins ma petite amie chaque fois que je le peux.
Alger en 62 ! Nous nous sommes installés à Hydra , où ma sœur habite. Il faut subir le vacarme infernal, la nuit venue, des familles rurales qui ont débarqué à Alger, dans un exode qui fait d’eux des chômeurs sans perspectives réalistes de trouver un emploi. Ils occupent des appartements laissés vacants par les « pieds noirs » qui ont quitté le pays en masse, mais la vie en immeuble leur pose des problèmes insurmontables. Ajouté à tout cela l’euphorie de l’indépendance enfin conquise, qui leur donne quelques fois l’impression que tout est permis.
C’est un peu vrai, d’ailleurs, que tout est permis. Dans un immeuble face au nôtre, l’ascenseur a été démonté et les pièces sorties de la cage. Un énorme travail dont on comprend mal la finalité. Un comité de quartier a été créé pour essayer d’endiguer le saccage, mais des écriteaux fleurissent, dans un français hésitant. Ils proclament : a bas le comité.

Joseph Gallinari vers 1950
Derrière lui, une des maquettes de bateau qu’il fabriquait
Mon père se précipite chez mon grand père Joseph, vaguement inquiet quand même. Il le trouve tout à fait serein, se réjouissant même que le café ait diminué de prix dans les bistrots depuis l’indépendance. Un inconvénient dont il ne parle pas, mais que nous connaissons, la voisine dont il obtenait les faveurs moyennant des petits cadeaux a quitté le pays. Il n’empêche : signalé par une bonne âme au Consulat de France, il est rapatrié sinon de force, du moins de façon expéditive, et installé à Allauch, près de Marseille, dans une institution spécialisée dans l’accueil des vieillards. C’était certainement la meilleure façon de le faire mourir et effectivement, il meurt en quelques semaines.
Autre visite qui s’impose pour mon père, les Cazassus qu’il adore, mais avec qui les discussions politiques ont toujours été animées. Je me souviens de Marie Cazassus traitant mon père de petit con, ce qui nous faisait rire aux larmes. Là, il arrive et commence à leur tracer ce qu’il pensait être le futur proche, avec la conviction qu’ils peuvent parfaitement continuer à vivre et à travailler en Algérie. Marie, comme d’habitude, l’agresse avec la dernière violence verbale, mais là, Bertrand, le grand frère intervient : « écoutez moi bien. Depuis vingt ans, Georgeot nous dit des choses auxquelles nous n’avons jamais voulu croire. Ces choses sont arrivées. Alors , maintenant, on l’écoute et on se tait ».
Nous habitons dans une cité où ma sœur Marie Jeanne et son mari José avaient acheté un appartement. Mon neveu Patrick naît en 62 dans une clinique où il est le seul nouveau né. Mon père avait prévu que nous pourrions être l’objet de l’hostilité de nos nouveaux voisins. Ce n’est pas le cas. C’est même souvent le contraire. Ils doivent se dire que nous devons être un peu fous pour être encore là. Et les simples d’esprit, en Islam comme dans la religion catholique, sont promis au Paradis.
Mon frère Georges travaille aux PTT comme ouvrier occasionnel. Un collègue est fauché par une voiture et se trouve sans assistance, couché au bord de la route. Mon frère, qui a quand même une voiture, l’emmène à toute allure à l’hôpital où il est soigné et dont il sort sur ses deux pieds. Décidément, nos voisins commencent à comprendre à qui ils ont affaire.
Mon beau frère José, qui a grandi près de la Casbah , et moi (qui l’ai appris à l’école) sommes les deux seules personnes de la famille à pouvoir aligner deux mots d’arabe. Mon père, qui a tant d’aptitudes dans tant de domaines, est nul en ce qui concerne l’apprentissage des langues en général et de l’ arabe en particulier. Il fait pourtant plusieurs tentatives, qui se soldent toutes par un échec cuisant. N’empêche, les voisins nous adoptent peu à peu et nous portent des gâteaux pour l’aïd. Seul mon neveu a des problèmes. Il ne peut pas descendre devant la porte de l’immeuble. Il est trop différent des autres enfants et il est victime de quelques brutalités. Ma sœur ne se pose pas de question quand l’heure de l’école est venue pour Patrick. Elle le met à l’école française.
Il faut dire qu’il faut avoir le caractère bien trempé pour supporter la société en formation. L’été 62, un conflit éclate entre le Gouvernement Provisoire et l’armée. La population voit avec stupeur les soldats de l’indépendance se tirer dessus dans les rues d’Alger. On assiste pourtant à des scènes magnifiques. Une dame de la rue de la Lyre envoie sa petite fille avec un plateau et des tasses de café. La petite fille va successivement offrir le café aux deux camps qui se font face. Compte tenu de l’idéologie qui est la nôtre, nous ne sommes pas étonnés que le peuple puisse se montrer plus conscient que ses dirigeants, mais c’est quand même très agréable de vivre une illustration aussi émouvante.
“Alger Républicain”, le journal progressiste des années 36-55, reparaît. Son équipe est dirigée par Henri Alleg, son ancien directeur, Boualem Khalfa, son rédacteur en chef, et Hamid Benzine, un militant héros de la guerre d’indépendance pendant laquelle sa famille a été décimée. Le journal lance une campagne sur la base d’un mot d’ordre immédiatement adopté par la rue : sebaa snin barakat ! sept ans, ça suffit ! Effectivement, les choses se calment et Ben Bella arrive au pouvoir avec la bénédiction de l’armée.
En 1962, avant de travailler aux PTT, mon frère Georges travaille comme magasinier rue Duc des Cars. Ses patrons , qui décident de quitter l’Algérie, vide le magasin pour en bazarder le contenu. Entre autres curiosités, mon frère découvre une édition originale du Littré, qu’il ramène à la maison. Je la planque chez moi, mais repars rapidement en France. Le temps était au rééquipement de la Bibliothèque Universitaire qui avait été incendiée par l’OAS. Une délégation passe chez nous dans le cadre de la collecte d’ouvrages susceptibles d’intéresser la bibliothèque. Mon père, presque en s’excusant de n’avoir que ça à offrir, remet les volumes du dictionnaire. Il est très étonné de recevoir quelques semaines plus tard une lettre de remerciements particulièrement chaleureuse.
Tous les hommes de la famille travaillent aux PTT, sauf moi qui suis toujours à Rouen. Mon beau frère José, qui est un excellent basketteur, est sollicité par la Direction pour rebâtir l’ASPTT qui a disparu. Il adopte une tactique que j’ai toujours trouvé géniale. Il s’installe tout seul sur le stade de l’ASPTT, avec quelques ballons et il aligne les paniers en faisant un peu l’acrobate (ce qu’il faisait très bien). Les enfants du quartier risquent un œil, il leur passe le ballon et tout le monde s’amuse. Les enfants sont conquis et ma sœur , en plus, s’occupe des repas pendant les sorties. Les deux s’investissent à fond, et, deux ans plus tard, l’ASPTT est championne d’Algérie junior. Tout le monde fête l’événement, y compris la Direction qui en profite pour remplacer mon beau frère à la tête de la section de basket.
C’est plus qu’ils n’en peuvent supporter : ma sœur et mon beau-frère décident de quitter le pays. Lui obtient sa réintégration dans l’administration française et elle se fait embaucher dans une grande société de courtage d’assurances.
Même chemin pour mon frère : il travaille dans une entreprise d’équipement des champs pétroliers. Il connaît une ascension très rapide dans la hiérarchie. Embauché chef de camp pour entretenir les baraquements, on lui confie ensuite quelques petits chantiers, et devant ses réussites, il est rapidement chef de base, chargé de plusieurs chantiers. Malheureusement, il a un accident de voiture en se rendant au travail. Il lui devient alors difficile d’assurer les mêmes tâches. Les patrons de la société le traitent sans ménagement, avec l’intention très claire de s’en débarrasser. Il finit par ne plus le supporter et il m’appelle un jour pour que je vienne le chercher. Ses patrons ne l’avaient même pas raccompagné chez lui. Il quitte donc l’Algérie pour s’installer à Nice.
Heureusement, la situation permet des opportunités pour ceux qui tiennent le coup.Dans les années soixante, les Péréto ont obtenu un cabanon à Bou Haroun , à cinquante kilomètres à l’Ouest d’Alger. Peu à peu s’est constituée autour d’eux une communauté de gens soucieux avant tout de bonne chère, d’apéros copieux, et de joyeuse convivialité. Il y a là quelques membres de la famille Chaulet, et aussi la famille de Salah Louanchi, époux d’Anne-Marie Chaulet, dirigeant du FLN et (j’allais dire pourtant) très agréable compagnon. Les enfants Péréto sont au paradis : pécheurs experts, nageurs émérites, ils connaissent dans les moindres détails leur domaine, à terre comme en mer. Ils sont rejoints le dimanche par les enfants des copains. Ils garderont à tout jamais le souvenir de ces années paradisiaques.
Mon père a réussi beaucoup plus tardivement à obtenir de la Mairie une ruine qu’il a retapée, et nous nous joignons à la joyeuse troupe.
Chez les Péréto règnent deux personnages hors du commun : Baptiste, bien sûr et sa belle-mère, madame Solbès. C’est une femme qui se distingue par un humour à froid d’autant plus efficace qu’il est souvent involontaire. À ce propos un épisode qui fait partie du florilège des années Bouharoun : mon père, soucieux de montrer à madame Solbès son aptitude à la plongée, avait effectué devant elle un plongeon au cours duquel son maillot passablement avachi avait laissé découverte son anatomie la plus intime. Sortant la tête de l’eau, mon père, innocemment, demande à madame Solbès : « alors, vous avez vu ? ». Et madame Solbès, glaciale, de répondre : « oui oui, je crois que j’en ai assez vu ».
En ce qui me concerne, j’ai besoin de remonter dans le temps pour me caractériser. A l’âge de trois ans, je suis atteint de rhumatismes articulaires aigus qui débouchent, comme c’est classique, sur des lésions cardiaques. Mes amis qui ne connaissaient pas ce détail pouvaient ne pas comprendre mon côté un peu « grande gueule » qui n’était en fait que compensation. J’ai vécu constamment avec la perspective d’une aggravation de mon état de santé et d’une opération à cœur ouvert (qui était très hasardeuse à l’époque). En fait, j’ai bien subi cette opération, l’an dernier , soit à près de 70 ans. Ça s’est bien passé, merci.
La maladie me condamne à une destinée différente de celle qui a caractérisé mes ascendants. Non seulement je ne serai pas piqueur de chaudière, mais tous les métiers manuels me seront peut-être interdits. Heureusement, mes parents croient déceler en moi un enfant qui pourra « faire des études ». Mais à Bougie, quand j’ai six ans, je ramène à la maison mon premier classement : je suis 24ème sur 44. Je suis très content d’avoir 20 élèves derrière moi, mais mes parents commencent à douter de leur pronostic. Par contre, dès l’année suivante, je m’installe en tête de classe à la rue Rochambeau, que je fréquente vingt-cinq ans après mon père. On respire.
À cette époque, la maladie me rattrape. Je reste des mois dans mon lit. Quand je reviens à l’école, mon institutrice, madame Olivès (la tante de Marie Rose Péréto), porte mon cartable quand nous rejoignons la salle de classe. Les ennuis de santé se poursuivront jusqu’à l’âge de quinze ans et ensuite, plus rien, sauf quand même un souffle au cœur. J’en profite pour jouer au foot. Plus tard, avec mon copain Saadallah, je ferai même de l’aviron sur le plan d’eau du port d’Alger : instants de bonheur.
J’ai parlé déjà du paradoxe concernant ma mère, heureuse malgré ses problèmes de santé. Au fond, je vis les choses de la même façon : je passe pendant toute mon enfance plusieurs mois par an au lit. Les rhumatismes me rendent difficiles les gestes les plus simples (notre voisine, madame Cuenca, écrase discrètement une larme en me voyant me débattre avec un morceau de pain), des accès de fièvre me mettent un peu dans un état second, mais ce dont je me souviens, ce sont les histoires que je me racontais en observant les déplacements, évidemment imaginaires, de drôles de créatures sur la tapisserie, et les citronnades que me préparait ma mère.
L’école de la rue Rochambeau, dont je fréquente la maternelle et l’école primaire est présente dans ma mémoire comme un véritable paradis, avec ses coursives fleuries de capucines. Je fréquente encore aujourd’hui mon copain de l’école maternelle, Réda Boualkkaz. Comme il n’existe pas de parrain dans notre milieu, j’ai donné son prénom à mon dernier fils.
Tous les ans, un saltimbanque vient dans le préau faire des tours de lasso, accompagné de son fils qu’il nous présente comme « le plus jeune cow-boy d’Afrique du Nord ». À la sortie, nous retrouvons le vendeur de billets de loterie qui est également un comédien de rue hors pair : il joue une pièce dont il est le seul acteur, qui se passe pendant la guerre. Il est touchant de naïveté et chante d’une voix chevrotante : « souviens-toi, peuple allemand ». Son unique accessoire est un vieux fusil complètement désarticulé dont il arrive, en fin de représentation à obtenir une détonation qui fait notre frayeur et notre émerveillement.
Et puis il y a le confiseur, monsieur Hafiz. À la sortie de l’école, nous trouvons près de la porte de son magasin, sur une caisse, quelques dragées qui n’ont pas été réussies lors de la fabrication. Nous utilisons des ruses de Sioux pour les chaparder et le confiseur fait mine d’être mécontent et de nous courir derrière. J’ai mis des années à comprendre que c’était pour lui un jeu et que c’était une façon fort élégante de nous offrir des dragées.
J’ai déjà raconté la prépa. L’école d’ingénieurs est du même tonneau. Je m’y ennuie terriblement. Heureusement, il y a le foot et les copains. L’an dernier, j’ai revu deux d’entre eux , dont l’unique fille de la promo. J’ai essayé de m’excuser pour cette époque où j’avais l’impression que l’on n’entendait que moi, mais non, ils trouvaient que j’avais été supportable et que j’étais sévère avec moi-même. Le seul reproche de ma copine, avec qui j’étais en travaux pratiques, c’est que je la laissais faire le boulot toute seule. Les braves gens !

Le foot à Rouen
Je me suis débrouillé pour tenir le ballon
Je me marie le 3 décembre 1964. Il ne me reste que six mois à tirer à l’école. Dès le diplôme obtenu (là aussi de justesse), je pars à Alger seul, mon épouse se reposant chez ses parents. Comme son arrivée n’est toujours pas à l’ordre du jour, j’envoie une lettre incendiaire dans laquelle je lui demande de rester là où elle est. Je me voyais mal entreprendre un parcours qui risquait d’être semé d’embûches, accompagné d’une femme qui m’aurait abreuvé de ses jérémiades. Je pense qu’à la lecture de cette lettre, ses parents ont dû être soulagés. Enfin débarrassés de cet énergumène qui voulait emporter leur fille dans ce pays de sauvages. Quant à mon épouse, quoiqu’elle en dise aujourd’hui, je pense qu’elle aussi a dû être soulagée.
À partir de là, je commence à vivre ce à quoi je me suis en principe préparé depuis longtemps. Vivre dans l’Algérie indépendante , conscient du handicap que constitue pour moi ma qualité d’Algérien issu de l’immigration, comme on dirait aujourd’hui. J’y vais bille en tête, et pour commencer, je me mets à la recherche d’un boulot. Il ne s’agit pas de gagner ma vie, ce qui serait relativement facile, compte tenu de l’absence de cadres dans l’industrie. Mon but, c’est de participer à l’édification du pays, et pour cela, je me porte candidat à la Sonatrach qui vient de naître. C’est la Société Nationale de Transport et de Commercialisation des Hydrocarbures.
Je suis apparemment embauché sans trop de difficultés et on m’attribue un salaire de 2000 dinars, soit le salaire maximum autorisé dans le secteur national. Mes collègues ont en général un salaire inférieur à celui que l’on m’a proposé, mais ils ne s’en formalisent pas. Ils m’accueillent sans l’ombre d’une réserve. Il faut dire qu’ils ont eux mêmes fait leurs études à l’étranger (souvent dans les pays socialistes) et qu’ils sont souvent mariés avec des étrangères.
Le directeur qui m’a embauché est un peu bizarre. Apparemment, il est docteur, mais personne ne sait s’il est médecin ou docteur ès sciences. D’après mon camarade Jacques, qui l’a connu à l’école de Cap Matifou, il n’est ni l’un ni l’autre. Il émaille son discours de mots anglais. Pour lui le pentoxyde de phosphore, ‘P2O5’ c’est « pi two o five ». Tout dans sa dégaine inspire la défiance. Il disparaîtra rapidement et je ne l’ai plus revu nulle part à Alger.
Je m’aperçois que mon embauche n’est pas aussi acquise que cela. Le Ministre de l’Énergie, qui est aussi Directeur Général de la Sonatrach, trouve un peu bizarre ce Fernand Gallinari qui débarque. Il considère à juste titre que la société est du domaine de la souveraineté nationale, et il est réticent à m’accueillir dans les rangs des ingénieurs algériens.
Car bien sûr, j’ai entamé les démarches pour acquérir la nationalité algérienne. Mes amis, et parmi eux ceux qui ont combattu pour l’indépendance, ont des difficultés à faire aboutir leurs dossiers. Certains attendent depuis des années. Je suis convoqué à la Police et je subis un interrogatoire mené, je dois dire, de façon assez sympathique. Je choisis, un peu au hasard, le profil bas.
- Pourquoi voulez-vous acquérir la nationalité algérienne ?
je compte vivre en Algérie et je voudrais avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que mes voisins -
- Avez-vous d’une façon ou d’une autre participé à la lutte pour l’indépendance ?
- Non. Je n’en ai pas eu l’occasion car je faisais mes études en France et je n’avais pratiquement aucun contact avec la communauté algérienne
- Que pensez-vous de l’indépendance ?
- Je pense que si les Algériens ont fait les sacrifices qu’ils ont fait pour l’obtenir, c’est que c’était un objectif vital pour eux.
Rien donc dans mon discours sur ma solidarité, sur les manifs, sur l’arrestation de mon père.
Après cette prestation a minima, j’ai obtenu mon passeport algérien en un temps record, bien avant mes camarades qui avaient combattu, éventuellement par les armes, pour l’indépendance.
Au bout de quelques semaines, le DG de Sonatrach signe mon embauche.
Le rôle que l’on m’attribue est d’éplucher des études de faisabilité commandées à l’étranger et concernant la construction à Arzew, d’une usine d’ammoniac et d’engrais azotés.
À ce moment se situe un incident avec le directeur intérimaire, qui avait remplacé le « docteur ». Il s’agit d’un ingénieur particulièrement brillant avec lequel je me régale à travailler. Le genre de type à qui on remet un travail qu’on considère comme impeccable, qui le démolit consciencieusement, et qui finit en disant : « À partir de là, tu peux commencer à travailler ». On sort de son bureau KO et content. Il me convoque un matin et me demande une des études sur lesquelles je travaillais. Je la cherche dans mon bureau et comme je ne la trouve pas, je retourne l’informer. Il me la montre alors en me disant : « le ministre est passé hier soir et il a trouvé l’étude sur ton bureau. Il a estimé que tu aurais pu la mettre sous clé et il m’a demandé de te le dire. »
Je prends une colère froide et je lui fais remarquer que me faire chercher un document qu’il détient n’est pas exactement une attitude de respect envers un collègue, même subalterne. J’exprime mon mécontentement sur la forme et je fais remarquer, sur le reproche qui m’est fait, qu’aucune armoire ne ferme à clé dans mon bureau et que de toutes façons, le bâtiment est gardé. Je ne sais pas si c’est seulement une impression, mais je crois qu’il est plutôt content de me voir me défendre sans complexes.
Je dois dire que les quelques semaines pendant lesquelles j’ai travaillé au tout début de ma carrière, avec Mohammed Liassine ont été un encouragement extraordinaire qui m’a permis de tenir bon quand, par la suite, les circonstances ont été, disons, moins favorables. C’est aussi cette impulsion qui m’a permis, moi qui fainéantais pendant mes années d’étude, de devenir, en un temps record, un travailleur enthousiaste, car, j’ai pu alors constater que l’objectif fixé n’était pas inaccessible.
Par contre, ma sœur et son mari enduraient des épreuves plus pénibles. Il y eut d’abord l’éviction scandaleuse de mon beau-frère José de la direction de l’équipe de basket des PTT. Quant à ma sœur, elle avait trouvé elle aussi un travail à la Sonatrach, comme secrétaire à la Direction de la Formation. Elle tentait de se fondre dans son nouveau milieu, mais elle craquera lorsque son directeur installera la climatisation dans son bureau à travers la cloison qui le sépare du secrétariat. Ce qui fait que l’été, quand il se rafraîchissait, il envoyait un courant d’air chaud dans le bureau de sa secrétaire. Il était tellement bien élevé qu’il ne s’en est jamais aperçu. Elle démissionne avant de succomber à une apoplexie.
De mon côté, je suis transféré dans l’équipe d’un nouveau directeur qui n’est pas aussi brillant que le précédent, mais avec qui je m’accorde plutôt bien. Nous poursuivons le travail sur le complexe d’Arzew par le lancement des appels d’offres internationaux et le dépouillement des offres avec l’aide des Américains d’Arthur D. Little, une société d’ingénieurs conseils de haut niveau avec lesquels je poursuis ma formation.
La négociation avec les différents soumissionnaires est également une période bénie pour approfondir les problèmes techniques et technologiques, dans la mesure où, connaissant plus ou moins leurs concurrents, ils en dévoilent les points faibles avec un luxe de détails qui nous sont fort utiles.

Signature du contrat de construction de l’usine d’ammoniac d’Arzew
À la table, à gauche, la délégation française,
à droite le PDG de Sonatrach Sid Ahmed Ghozali,
Debout derrière à gauche, Fernand Gallinari.
Finalement, notre choix se porte sur l’engineering français Technip, qui propose une technologie américaine Chemico. Avec mon copain Belkacem, nous partons pour un mois aux États Unis où nous allons de découvertes en découvertes. J’avoue que ce séjour d’un mois a beaucoup fait pour ma réflexion sur les problèmes de gestion des problèmes techniques et humains, que je mettrai en œuvre plus tard.
Gestion technique, d’abord. Nous constatons, presque avec jalousie, que nos interlocuteurs sont aussi jeunes que nous. Mais nous nous apercevons vite qu’ils sont « adossés » à une équipe restreinte d’ingénieurs chevronnés qui passent leur temps à alimenter une banque de données qu’ils élaborent à partir des problèmes rencontrés dans les réalisations précédentes. Si bien que l’on peut se retrouver, par exemple, devant un ingénieur quasi débutant qui déclare sentencieusement : « le problème des unités de nitrate d’ammonium se situe en général au niveau de la cristallisation ». Nous ne sommes même pas sûrs que le bonhomme ait passé plus d’une semaine dans une unité de nitrate d’ammonium, mais ce système est particulièrement performant et économe en ressources humaines.
Quant aux problèmes humains, j’en vis une illustration (il y en aura d’autres au cours du voyage) très éloquente dans les bureaux de New York. Nous devons partir pour Memphis pour visiter une unité d’ammoniac et discuter avec les exploitants. Nous sommes dans le bureau de Paul Mayo, notre interlocuteur chez Chemico qui a demandé que l’on s’occupe de nos réservations. Le téléphone sonne et nous comprenons que le responsable des billets annonce que les réservations sont impossibles. Paul Mayo répond avec une pointe d’ennui dans la voix : « je suis Paul Mayo, donc c’est possible ». Deux heures après, nous avons nos billets.
Ça, si l’on peut dire, c’est pour le fond. La forme, par contre, est tout autre. A la porte de l’usine que nous sommes allés visiter dans l’Arkansas, nous arrivons dans une énorme voiture. Le gardien, qui bien sûr avait été prévenu, nous arrête quand même. Il a besoin d’une voiture pour je ne sais quel problème qui l’oblige à envoyer quelqu’un en ville. Paul Mayo trouve tout naturel de lui confier le véhicule à l’issue d’une conversation parfaitement décontractée d’où les problèmes hiérarchiques sont totalement absents.
Nous sommes à des années lumières des comportements courants en Algérie, où la susceptibilité et le fatalisme plombent la marche en avant qui se poursuit avec difficulté. Je me souviens d’un collègue qui n’avait pas pu se lever le matin alors que nous avions une tâche importante à la première heure. Le boulot tombe à l’eau, et quand il arrive, mal réveillé, il murmure devant mes reproches : « La ghaleb » (Traduction libre : c’est Dieu qui décide »).
Une autre technique consiste également en une contre attaque sur la forme quand on est à bout d’argument. Pour peu que le « supérieur » élève un tout petit peu la voix, le subordonné se lance dans une longue argumentation selon laquelle, d’accord, il a tort, mais ce n’est pas une raison pour l’engueuler comme ça, qu’il est lui aussi un homme, qu’il doit y avoir un minimum de respect dans les relations de travail, et ainsi de suite.
Pendant que je fais mes premiers pas dans la profession d’ingénieur, mon père intègre l’administration algérienne des PTT où il est Inspecteur Principal Adjoint. Ce n’est rien, comme dit l’autre, mais il a ainsi le plaisir de voir réparée l’injustice dont il a été victime. Comme il n’a que 49 ans en 1962, il ne peut pas quitter sans préjudices l’administration française. Il décide donc de ressortir son dossier d’invalidité, et obtient son départ assorti d’une pension. À partir de là, il n’aura plus de soucis matériels, surtout compte tenu de la modestie de ses besoins. Il continuera jusqu’à sa mort en 1979 à travailler dans l’administration algérienne où il jouira de l’estime générale.

Septembre 1965. Inauguration du multiplexe
de Sour le Ghozlan
À droite, Georges Gallinari
Quant à moi, je poursuis mon travail sur le projet d’Arzew, et pour cela, je suis envoyé sur le chantier. J’habite une petite maison à “Fontaine des Gazelles”, un site marin merveilleux fait de rochers et de criques. Je suis accueilli régulièrement dans la famille d’un camarade que j’apprécie particulièrement. Il s’agit de mon copain Julot Molina. Il est à l’époque directeur de la “Centrale Laitière Oranaise” où, entre autres prouesses, il fabriquera le premier camembert algérien. Julot est plutôt petit et presque chétif, mais c’est un homme d’une solidité hors du commun. Pendant la guerre d’indépendance, les forces coloniales recherchent l’imprimerie du parti communiste qui édite régulièrement le journal du parti, “Liberté”. Les soupçons se portent à juste titre sur Julot qui a été directeur de l’imprimerie du parti avant la guerre. Il est arrêté et immédiatement torturé car les militaires veulent aller vite pour éviter le déménagement des machines. À ce moment se situe un épisode invraisemblable : les autres camarades de l’imprimerie s’y rendent, persuadés que Julot ne parlera pas. Ils sortent un nouveau numéro du journal. Effectivement, les tortionnaires abandonnent car ils sont persuadés que s’il avait été dans le coup, jamais le journal ne serait sorti pendant qu’il était dans leurs mains. Julot est sauvé.
J’ai revu il y a quelques temps l’interview par mon fils Khaled, de Tayeb Bouhraoua, militant exemplaire du PCA. Au nom de Julot Molina, il a dit avec gravité : « c’était quelqu’un ». C’est, je crois, exactement ce qu’il fallait dire de ce petit homme chétif et souriant : c’était quelqu’un.
Sur le chantier, je dispose d’une équipe composée de quelques techniciens algériens et d’un groupe de conseillers étrangers, anglais en l’occurrence. En principe, nous contrôlons le travail de l’engineering français qui réalise le complexe, mais le contrat est « clés en main », et nous ne maîtrisons pas grand chose. De plus, ce contrat est le premier de ce type pour la Sonatrach et nous faisons tous beaucoup d’erreurs. La principale lacune se situe au niveau de l’impréparation de l’exploitation du complexe. Le futur directeur n’est toujours pas nommé et les équipes chargées de faire fonctionner les installations n’existent pas, alors qu’elles devraient être en formation dans des usines similaires à l’étranger.
Qui plus est, la Sonatrach a choisi la technologie la plus moderne, mais aussi la plus complexe. L’unité d’ammoniac fait partie des plus grandes unités existant dans le monde.
On nomme enfin un directeur. C’est le directeur régional d’Électricité et Gaz d’Algérie qui vient d’être nommé à Constantine et qui ne veut pas quitter l’Oranie. Drôle de critère pour sélectionner la personne qui doit diriger les opérations de mise en route. De toutes façons il arrive tellement tard qu’il est confronté à une mission impossible. Le démarrage se passe très mal et le complexe mettra des années pour atteindre sa production nominale.
Évidemment, on cherche des responsables de l’échec, et compte tenu de la modestie de ma position hiérarchique, je suis le fusible idéal.
Le directeur qui a remplacé le précédent et qui a l’oreille de la direction générale, dit et fait n’importe quoi. Exemple : le réacteur d’ammoniac est un grand réservoir conçu pour résister à des pressions énormes. Dans un rapport écrit, il annonce que ce réacteur, arrimé à ses fondations par une centaine d’écrous pesant chacun au moins dix kilos et qui pèse 600 tonnes d’une seule pièce, tourne à la vitesse de 10000 tours par minute !
Mais il ne se contente pas d’élucubrer. Il porte de graves accusations contre l’équipe qui a suivi la construction, c’est-à-dire la mienne.
Mon directeur et moi sommes convoqués un matin par le DG. Nous prenons l’avion de la Sonatrach pour Arzew, dans un silence glacial. Visiblement, des têtes vont tomber. Mais le directeur du complexe, se trouvant devant des interlocuteurs qui connaissent bien le problème, se radoucit comme par miracle. Aucune tête ne tombe et le retour s’effectue dans une ambiance décontractée. Le DG est visiblement soulagé.
La chasse aux sorcières n’est pas terminée. On commence par convoquer les Américains d’Arthur D. Little qui ne trouvent rien à redire quant à la gestion du projet. Ils me proposent même, en marge des réunions, de m’embaucher. J’avoue que j’ai hésité devant une perspective professionnelle aussi passionnante. Mais mon indécrottable obstination
... de poursuivre le chemin que je m’étais tracé, ainsi que mon engagement politique dont je parlerai plus loin plus en détail, m’amène à refuser l’offre.
Le harcèlement continue avec les vérifications détaillées des comptes. Sur le chantier, je signais tous les jours des autorisations de dépenses qui atteignaient des sommes considérables. Mais ce que ni Technip, ni Sonatrach ne savaient vraiment, c’est qu’un amitié solide et une confiance totale me liaient au comptable de Technip, Paul Labrouve, un pied noir de Guyotville (aujourd’hui Ain Benian). Il cochait les dépenses qui revenaient à Sonatrach et me mettait en garde contre les demandes non fondées de sa propre structure. Dans le doute, je suivais ses conseils à la lettre. Bien m’en a pris. Après une vérification extrêmement méticuleuse, on ne trouva pas la moindre erreur dans ma gestion. Cette fois, j’étais vraiment sorti d’affaire.
L’échec relatif de l’usine d’ammoniac est l’objet de réflexions diverses. L’infime minorité (dont bien sûr je fais partie), considère que les préparatifs du démarrage et de l’exploitation ont été totalement insuffisants et qu’il convient à l’avenir de responsabiliser Sonatrach très tôt pendant la construction, même si celle-ci doit bien entendu être confiée à des sociétés étrangères. La grande majorité pense au contraire que décidément, nous ne sommes pas prêts à assumer la responsabilité du démarrage et qu’il faut passer de contrats « clés en mains » à des contrats « produits en mains ».
Malheureusement, cette dernière tendance véhicule sournoisement un certain dénigrement quant à la valeur des cadres nationaux, ce qui convient très bien à un certain nombre de dirigeants qui n’ont pas de formation technique et qui sont bien contents de pouvoir « mettre les techniciens devant leurs insuffisances ». Cette démarche conteste en réalité la stratégie de développement mise en œuvre par Boumediène. Elle continuera à sévir et débouchera sur l’abandon de pans entiers de l’économie au profit d’importations massives de biens qui auraient pu être fabriqués en Algérie. Si bien qu’aujourd’hui, soit quarante ans après la construction du complexe d’Arzew, la part de la consommation nationale couverte par les importations permises par les revenus du pétrole n’a pratiquement pas baissé.
À la fin des années 60, le Gouvernement décide que toute promotion de cadre du secteur d’État sera à l’avenir assujettie à l’acquisition d’un niveau en langue nationale au moins égal au certificat d’études. Je prends donc des cours d’arabe pour atteindre cet objectif. J’ai d’abord la surprise de constater que la grammaire arabe, qui me paraissait très compliquée quand on me l’enseignait en français, devient une construction merveilleusement structurée maintenant que je l’apprends « en version originale ». Les cours auxquels j’assiste sont destinés aux cadres qui, comme moi, veulent atteindre un niveau suffisant dans la langue nationale. La moyenne d’âge est de l’ordre de 35 ans. C’est donc un moment délicieux quand, répondant au professeur qui exhibe une image représentant une vache, l’assistance au complet répond d’une voix forte : hadihi baqaratoun (ceci est une vache). La méthode doit quand même avoir du bon puisque, après deux ans de ce régime, j’obtiens le certificat d’études.
Pendant ce temps, j’ai été chargé à titre transitoire, de m’occuper de la construction d’instituts et de laboratoires à Bou Merdès. Je suis secondé magnifiquement par Messaoud Ghalmi, qui deviendra pour moi plus qu’un ami. Nous rompons avec l’habitude qui consistait à installer des préfabriqués en catastrophe avant les rentrées universitaires. Grâce à la Sonatiba (Société Nationale du Bâtiment), nous parvenons à livrer à temps les nouvelles installations de l’INH (Institut National des Hydrocarbures), et d’autres constructions. Plus de trente ans plus tard, un violent séisme secouait la région. Les bâtiments récents et même ceux construits à l’époque française de Rocher Noir, sont sévèrement touchés. Les destructions entraînent d’importantes pertes humaines. Quant à moi, j’ai la satisfaction de constater que tout ce que nous avons entrepris, avec des moyens provenant entièrement du secteur nationalisé, a parfaitement tenu, et qu’on n’y a pas noté un seul blessé (excepté un élève qui s’est fait une bosse, ironisera la directrice de l’INH) Le moins qu’on puisse dire, c’est que les affairistes privés qui ont construit en dépit des règles les plus élémentaires ne peuvent pas en dire autant.
Le Ministre de l’Industrie s’intéresse personnellement à ce que nous faisons à Bou Merdès. Il y débarque régulièrement, et il lui arrive même de provoquer des réunions dans le bureau du directeur de l’Institut National des Hydrocarbures. Tout le monde y est dans ses petits souliers, car le ministre a la réputation d’être très autoritaire. Il lui est même arrivé de gifler ses collaborateurs. Lors de l’une de ses réunions, il nous demande de goudronner les places que nous tentions d’aménager en espaces fleuris. À son avis, ce serait plus « propre ». J’encaisse avec un petit sourire plein de respect et un tout petit peu aussi de désaccord. Le ministre, évidemment, n’en a cure et continue à nous donner son avis, c’est-à-dire des instructions. Il nous demande d’isoler la cité des zones habitées alentour, y compris du village originel de Bou Merdès. En particulier, il nous demande d’installer une clôture dissuasive sur la plage. La peur au ventre, et avec une voix à la limite de l’obséquiosité, je déclare alors que je ne saurais faire un travail qui serait aussi étranger à ma conception de l’urbanisme. Un silence terrorisé se fait. Le ministre me regarde dans les yeux et, finalement, sourit : « tu ne mettrais pas de barbelés sur une plage, hein ? ». Et il passe à un autre sujet. À partir de cet incident, tout le monde à Bou Merdès pensait que, pour que je prenne un tel risque, je devais certainement connaître personnellement le ministre.
J’ai la sensation de devenir un peu encombrant à la Sonatrach. Nous sommes dans un système où il n’est pas concevable d’employer un cadre de mon gabarit à une tâche moins importante que celles qu’il a assumées jusqu’ici. Et ce genre de tâche est déjà assuré par d’autres. Sans compter, comme je l’ai déjà mentionné, mes réticences envers les contrats « produits en mains »
Je décline quelques offres et finalement, devant l’absence de perspectives, je me décide pour une expérience dans le privé. Je travaille un an dans une boite à partir de laquelle nous devons fonder avec quelques associés une société de climatisation. Mais la gestion de la société est tellement différente de ce à quoi je suis habitué que tout cela commence à m’effrayer.
Je décide de revenir d’urgence au bercail. Du bureau de mon ami Messaoud, je téléphone à mon ancien directeur qui est aussi directeur général de la Société Nationale de Sidérurgie. Il me propose immédiatement un poste d’ingénieur de projet dans son unité Engineering. Avant de rejoindre la SNS, je règle un problème de santé (je subis une ablation de la rate, car je souffre périodiquement d’une chute du taux de plaquettes dans le sang qui me met dans un état similaire à l’hémophilie), et un problème personnel : je me remarie.
J’ai rencontré une demoiselle de treize ans ma cadette. Elle est jolie, mais ma mère, issue d’un milieu où manger peut être un problème, disait que la beauté ne se mange pas en salade. Par contre ses frères sont des militants et elle-même, malgré son jeune âge, a participé au volontariat étudiant pour la révolution agraire. De là à penser que je suis tombé sur une Pasionaria en herbe... En fait, la différence d’âge est trop grande et nous n’avons pas les mêmes envies. Nous avons ensemble deux jumeaux, que nous appelons Nassim et Khaled.

La famille réunie en 1974, pour mon mariage avec Nadia
Mon père, ma sœur, ma mère, mon frère et moi derrière
Mais notre couple bat de l’aile, et nous décidons de divorcer. Un peu d’humour, quand même dans ce divorce. Mon épouse, avec qui j’ai gardé d’excellentes relations, jure qu’au moment de prononcer la formule légale : « tu es répudiée » (mtalqa), j’ai prononcé : « tu es angoissée » (mqalqa). Le juge, qui était de toutes façons incommodé par ce couple illégal (je ne suis pas musulman), s’en contente. Nous nous séparons et Nadia accepte de me laisser la garde des jumeaux, ce dont je lui serai reconnaissant toute ma vie.

Khaled et Nassim à la Clinique Durando.
Ils ont une demi-heure.
Je rejoins mon poste à la SNS. L’unité est dotée d’une assistance belge relativement massive et les ingénieurs belges sont directement à des postes opérationnels, ce qui est rare pour des Étrangers en Algérie à cette époque. Je n’ai jamais discuté avec ma hiérarchie des raisons qui avaient poussé à adopter ce type d’organisation. Je connais assez bien le directeur général pour ne pas le soupçonner un seul instant (comme d’autres le font) d’être « colonisé dans sa tête ». Je pense plutôt que, persuadé que ce qui manque à nos ingénieurs, c’est d’être « adossés » comme je l’ai dit à propos des jeunes ingénieurs américains, à une mémoire technique et organisationnelle, il a tenté de la leur fournir sous cette forme. Il n’empêche, les relations avec les Belges, dont certains ne semblent pas débarrassés de tout sentiment colonial, ne sont pas faciles.
Je suis chargé de coordonner la réalisation d’un grand chantier naval qui doit être construit à Mers el Kébir. Cette coordination est un peu complexe. Dans mon équipe, il y a donc des Belges, et la technologie est fournie par une équipe de Polonais en provenance des chantiers de Gdansk et de Gdynia. Cette dernière assistance provenant d’un pays socialiste me convient évidemment tout à fait, mais ça fait beaucoup de monde à faire travailler ensemble. D’autant plus que le Maître de l’Ouvrage, c’est-à-dire le propriétaire du chantier quand il sera fini, c’est la Marine Nationale, c’est-à-dire l’Armée. Je travaille pendant un an et demi au milieu de ce réseau d’où les tensions (surtout entre Belges et Polonais) ne sont pas absentes.
Les militaires ont une conception de l’organisation du travail qui ne correspond pas du tout à la nôtre. Nous sommes assaillis de demandes plus ou moins contradictoires qui perturbent le déroulement des opérations. J’imagine alors d’éditer un document régissant nos rapports. Je rédige un véritable « contrat clés en main » selon lequel nous sommes chargés de la réalisation et les militaires de la préparation de l’exploitation. Comme je m’y attendais, le texte déplaît fortement à nos partenaires. Ils nous retirent l’affaire. Ouf !
Je suis versé alors sur deux énormes projets : le premier est une usine d’aluminium, le second une installation de fabrication d’aciers fins et spéciaux. Les études d’impact de l’usine d’alu nous amènent à proposer de l’implanter dans la région de Msila. Au cours de nos investigations, nous sommes pris dans une véritable tempête alors que nous survolons la zone. Pendant un bon quart d’heure, ballottés dans tous les sens, nous croyons notre dernière heure venue.
Quant à l’aciérie, son implantation a déjà été décidée. Dans le cadre d’une opération de désenclavement, c’est la région de Jijel qui a été choisie.
Quand nous débarquons, nous comprenons tout de suite que nous sommes dans un environnement à préserver à tout prix. La région est fertile, bien arrosée (il y pleut plus qu’en Belgique !), et l’implantation de l’usine et du port qu’elle nécessite risque de porter un préjudice irréparable à une zone unique en Algérie. Nous décidons, avec bien sûr l’aval de la direction générale, de porter une attention toute particulière sur l’ étude d’impact. Avec l’aide d’une équipe belge dirigée par une spécialiste de ce type de problème, nous ratissons la zone, proposons de rattacher l’habitat des futurs employés aux agglomérations existantes, d’en profiter pour doter ces villages d’équipements socioculturels et d’écoles... Toutes choses qui ne sont pas en principe de notre ressort, mais qui nous paraissent d’une importance vitale pour la région.
Tout ne va pas pour le mieux avec nos partenaires belges. Notre interlocuteur pour ce projet nous prend un peu pour des idiots. Il arrive à Alger avec un document énorme qui n’est constitué que de vieilles procédures qui traînent probablement dans les armoires de sa société à Bruxelles. Nous l’éconduisons fermement et demandons son remplacement. Arrive alors un homme d’un tout autre gabarit : c’est Philippe Lechat, un ingénieur de haut niveau qui remet notre collaboration sur de bons rails. Il mourra quelques années plus tard d’un infarctus sur l’aérodrome de Pékin.
Mais les méthodes de travail dans l’unité me fatiguent. Le directeur, tout à fait sympathique en tant que personne, a des conceptions très centralisatrices. Il reçoit tout le courrier au niveau de son secrétariat, garde les originaux, les photocopie et distribue les photocopies. Sans caricaturer, cela veut dire que quand la photocopieuse est en panne, nous n’avons pas de courrier ou que nous sommes obligés d’en prendre connaissance au secrétariat de direction. Un jour que je suis particulièrement remonté, je vais voir le DG. Il me reçoit très amicalement, mais quand je lui présente mes doléances, il se met à m’engueuler copieusement, me disant qu’il ne peut rien pour remédier à cette situation et qu’il faudra bien que je m’en accommode. Quand il a fini sa diatribe, il me précise en souriant qu’il se l’est permise parce qu’il me considère comme une personne capable de le comprendre. En fait, ce que je comprends, c’est qu’il pense que je veux « être calife à la place du calife ». Il se trompe : ce qui me conviendrait, arrivé à ce point de ma carrière, ce serait un poste hors hiérarchie où je pourrais travailler sur des dossiers sans être gêné par des problèmes de gestion des hommes pour lesquels, je l’avoue, je n’ai pas de compétence particulière. Pour qu’il ne subsiste aucun doute sur mes motivations, je rédige une lettre de démission à la sortie de son bureau, et je vais chercher du travail ailleurs.
L’époque est faste pour les ingénieurs. Je trouve tout de suite du boulot, d’autant plus qu’il s’agit de rejoindre l’équipe que Abdelkader, un ancien collègue à la Sonatrach, est en train de constituer pour gérer la Société Nationale de Construction Métallique (SN Métal) dont il vient d’être nommé directeur général. Dans cette société se pose le problème d’injecter des cadres disposant d’une formation universitaire à certains postes.
L’entreprise est le résultat de la réunion d’usines nationalisées et les anciens contremaîtres algériens de ces usines ont pris en main les principales missions. Nous nous trouvons devant un problème relativement classique du choix entre l’innovation et l’expérience.
Les anciens cadres disposent de compétences extraordinairement précieuses dans le domaine technique, mais ils sont en général très conservateurs, ne serait-ce que parce qu’ils voient arriver des personnels susceptibles de leur disputer leurs postes.
Pour ma part, mon parcours me destine à l’unité engineering. Le problème, c’est que là comme ailleurs, il y a déjà un directeur. On m’installe dans un petit bureau à côté du bureau du directeur et je me mets à sa disposition. Je suis plutôt bien dans cette position, mais lui doit la trouver intenable car un matin, il passe dans mon bureau et très amicalement, il me remet les clés du sien et disparaît. Je me retrouve directeur sans l’être puisque n’ayant pas été nommé. Je m’installe pourtant dans le bureau directorial et le personnel m’adopte officieusement. Les représentants syndicaux me demandent une réunion. Je l’accepte en précisant que je ne suis investi d’aucune mission officielle. Le fils de Georges ne pouvait pas ne pas s’accorder avec des syndicalistes et effectivement le courant passe immédiatement. Un jour mes illusions sur les syndicats maison fondront comme neige au soleil, mais pour l’instant, tout va bien. Mon collègue Abdelkader, qui attendait de voir comment les choses se passeraient, me nomme officiellement directeur de l’engineering. Nous sommes en 1976.
Je voudrais ici faire le point sur ma conception de la « carrière ». Depuis mes années de débutant face aux engineerings étrangers, j’ai la sensation que c’est dans ce domaine que je veux apporter ma pierre, car c’est là que commence la construction de l’indépendance industrielle. J’applique sans même m’en apercevoir vraiment la stratégie de mon parti, le PAGS, qui annonçait dans sa plate forme de 1968 : « le choix n’est pas pour l’Algérie entre le socialisme et le capitalisme, mais entre une stagnation dans la dépendance et l’accès à un développement économique indépendant ». (Je cite de mémoire et le texte est probablement un peu différent). Après les « clés en mains » de Sonatrach, au cours desquels j’étais surtout spectateur, j’ai commencé à la SNS un travail de gestionnaire de projet dans lequel j’étais un peu plus acteur. Ma volonté, c’est de bâtir une structure comparable aux structures étrangères que je connais bien. En attendant d’aller encore plus profondément au cœur des projets en abordant les problèmes de technologie pure, de process comme disent les Américains et leurs amis.
Pour s’occuper de coordonner la réflexion sur les problèmes d’organisation, on a besoin de quelqu’un qui ne fasse que ça et qui soit donc débarrassé des tâches opérationnelles. J’embauche pour cela Julio, un ingénieur chilien chassé de son pays par le coup d’État de Pinochet, et nous commençons à rêver.
Pendant ce temps, l’unité continue à s’occuper des projets qu’elle gérait avant mon arrivée. Notre grande affaire, c’est la réalisation de la préparation du minerai du complexe sidérurgique d’El Hadjar. Notre intervention dans cette affaire, qui nous a été confiée sans appel d’offres par la Société Nationale de Sidérurgie, est strictement identique à ce que l’on a l’habitude de confier aux sociétés étrangères, et nous en sommes très fiers.
Vers la fin du projet, les difficultés s’accumulent et le Ministère devient frileux car l’affaire est tellement importante qu’elle revêt un caractère politique. Je suis convoqué sur le site où le secrétaire général du ministère me donne, devant l’état major du complexe, l’ordre formel de confier le démarrage de l’installation à une assistance technique étrangère. Pour moi, c’est une très mauvaise nouvelle, car la phase de démarrage est traditionnellement celle où l’on apprend le plus. Je fais bien sûr mine d’obtempérer, mais je continue à investir notre équipe sur le site de tous les pouvoirs en matière de démarrage.
Je vis à cette époque deux évènements qui mettent du baume au cœur du vieux stalinien que je suis.
Le premier concerne les dernières opérations de montage. Nous avons besoin d’une grue de grande capacité et la SN Métal n’en dispose pas. Les seuls qui puissent nous en prêter une sont les Soviétiques qui construisent le haut fourneau que notre unité doit alimenter en minerai. Je vais voir le directeur soviétique (qui, soit dit en passant, est un général de l’Armée Rouge) :
- Monsieur le directeur, je vous annonce que vous ne pourrez pas démarrer le haut fourneau le premier novembre, comme vous vous y êtes engagé personnellement.
_ -Sachez que les ordres que j’ai reçus sont stricts et que, quoiqu’il arrive, je tiendrai mes délais.
- Pour cela, il faudra que vous receviez du minerai et il se pourrait que nous ne soyons pas prêts.
- Il n’est pas question que j’échoue dans ma mission. Dites moi ce qu’il faut faire pour que vous soyez dans les délais.
Le lendemain matin, la grue soviétique est sur notre chantier.
Puisqu’on parle de Soviétiques, il faut raconter une action qui aurait pu faire l’objet d’un film de Dovjenko (vous vous souvenez peut-être de l’histoire du tracteur qui chauffe et que les ouvriers agricoles redémarrent après avoir à tour de rôle pissé dans le radiateur. Sinon, c’est que vous n’êtes pas comme moi un nostalgique de l’Union Soviétique).
Notre scène se situe le jour où le premier wagon arrive sur notre chantier pour décharger la première cargaison de minerai. Le train s’engage au-dessus de la fosse. Il y a entre les rails un crochet qui ouvre le fond du wagon pour que le minerai tombe dans la fosse. Malheureusement, le crochet est mal réglé et le fond du wagon ne s’ouvre pas. A ce moment se situe le coup de théâtre. Azzi, l’un de nos ingénieurs, se saisit calmement d’une masse et passe sous le wagon. Il assène un coup bien placé et le fond du wagon s’ouvre. Voilà un gars qui a positivement risqué sa vie pour la réussite de notre projet et il fallait le priver de cette expérience ?
L’unité fonctionne et c’est l’euphorie de la victoire. Le chef de notre chantier débarque à Alger pour rendre compte. Je tiens absolument à le présenter au secrétaire général du ministère. Je le trouve justement dans une usine voisine. Je lui présente notre ingénieur en lui annonçant que nous avons réussi. Il nous regarde froidement et nous dit seulement : « ce n’est pas trop tôt ». Nous repartons tout déconfits.
Malheureusement, la déconfiture ne fait que commencer. Notre Unité, comme on l’a dit se veut un vecteur d’intégration nationale, et cela gêne beaucoup de monde. La plupart des dirigeants de l’industrie préfèrent travailler avec l’Étranger. Soit qu’ils en retirent des avantages personnels divers, soit qu’ils considèrent que nos prestations ne sont pas d’une qualité suffisante. En général, ils ne se demandent pas si leurs prestations, elles, sont d’une qualité suffisante.
Nous sommes obligés de faire la part du feu. Une société nationale accepte de travailler avec nous, à condition que nous utilisions une technologie espagnole qu’ils ont choisie. Nous acceptons et mon collègue chef du département technique réunit la liasse de plans que nous avons réalisés pour soumissionner et se rend à Barcelone. À l’adresse qu’on nous a donnée, il ne trouve qu’un appartement de trois pièces occupé par un bonhomme plutôt sympathique, mais qui n’a vraiment rien d’un technologue.
Heureusement, nous avons aussi des alliés. C’est ainsi que je suis reçu par le DG de la Sonatrach pour lui signaler le refus de certaines directions de sa société de travailler avec nous. Il appelle devant moi les services que j’incrimine et branche l’écoute amplifiée pour que je puisse prendre en direct connaissance de leurs arguments. C’est une marque de confiance à mon égard à laquelle je suis très sensible.
J’ai aussi un contre-exemple presque comique. Le DG de la Société Nationale d’Exploitation des Mines nous convoque. Il nous présente un énorme projet pour les mines de phosphates de Djebel Onk. Il s’agit essentiellement d’immenses convoyeurs perchés sur des pylônes de 200 mètres de haut. Quand il a terminé sa présentation hugolienne, il déclare avec hauteur : « je confierai à la SN Métal tout ce que vous considérez pouvoir faire dans ce projet ». Or nous sortons de la réalisation de la préparation du minerai et nous y avons maîtrisé la technique de construction des convoyeurs. Quant aux pylônes, ils ne présentent à mon avis aucune difficulté particulière, malgré leurs dimensions. Je fais exactement la réponse qu’il ne fallait pas faire : je déclare que nous pouvons tout faire, sauf le montage. Je comprends immédiatement que cette réponse déclasse le projet de la Sonarem. Si nous savons tout faire, cela signifie qu’il s’agit d’une opération banale, et ça, le DG ne le supporte pas. Il adopte un ton glacial et nous met presque à la porte. Nous n’avons pas beaucoup d’amis, mais si je me mets à gaffer comme ça, ça risque d’être pire sous peu.
À l’intérieur de l’unité, la nouvelle organisation prend forme. Notre obsession : le débat sans hiérarchie. Comment en effet arbitrer entre un gestionnaire de projet qui s’occupe des coûts et des délais et un ingénieur qui propose une solution qui, éventuellement n’entre pas dans le cadre des limites imposées au gestionnaire lors de la signature du contrat.
Dans les réunions de travail, certains moments sont bénis et les « anciens » plus ou moins autodidactes commencent à s’apercevoir qu’ils ont un rôle éminent à jouer. Un jour, par exemple, que nous préparons une offre pour des grues portuaires, nous arrivons à ce que nous pensons être la fin du travail quand le directeur de l’unité de charpentes qui doit fabriquer la grue demande, faussement ingénu : « quelqu’un peut me dire comment je fais pour peindre l’intérieur des caissons ? » On remet le boulot sur le tapis.
Toujours dans le cadre de l’organisation rêvée, nous embauchons une demoiselle pour un travail qui pourrait faire l’objet d’une thèse dans son domaine, la psychologie. Il s’agit précisément de réfléchir sur les difficultés du travail en commun sans relations hiérarchiques et aussi des mécanismes de résistance à l’innovation. Quelques temps après son embauche, la demoiselle arrive dans mon bureau : « j’ai une amie qui a fait exactement les mêmes études que moi et qui est chef de service dans l’unité. Comment se fait-il que je ne sois pas chef de service moi aussi ? » Nous n’avons vraiment pas embauché la bonne personne.
De toutes façons, nous nous heurtons de plus en plus au reste de la société. Peut-être sommes-nous aussi responsables, mais est-on condamnés à travailler éternellement de la même façon pour ne pas avoir d’ennuis ?
Effectivement, les ennuis sérieux commencent. Le syndicat de l’unité (l’Assemblée des Travailleurs de l’Unité, ou ATU), est très remonté contre moi. Il pond rapport sur rapport parlant de mauvaise gestion (ce qui est un délit relevant du pénal en Algérie). La moindre de mes initiatives est l’objet de contestation.
J’embauche un informaticien pour informatiser l’unité. L’ATU pond un rapport contestant l’embauche d’un informaticien « alors que nous n’avons pas suffisamment d’ordinateurs. »
J’embauche une dame pour s’occuper des problèmes de communication de l’unité. Nous avons bien besoin de promotion auprès de nos collègues des autres sociétés nationales, compte tenu de la sous charge endémique de notre bureau d’études. L’ATU crie à son incompétence et demande l’annulation de son embauche. Cette dame, Algérienne d’origine, a quitté l’Algérie quelques temps après. Elle est aujourd’hui élue au Sénat de la république française. Beau parcours pour une incompétente ! (j’ai ajouté ce passage car je viens de l’apercevoir à la télévision intervenant à la tribune du Sénat français au sujet de l’Union pour la Méditerranée).
Il est toujours gênant de donner des explications qui ne peuvent pas être démenties, faute de contradicteurs, mais, bien sûr, je vais le faire, en laissant ceux qui me liront libres de chercher d’autres sources ou de ne pas croire en ma bonne foi.
D’abord, je voudrais replacer l’affaire dans le microcosme de l’unité. La quasi totalité des membres de l’ATU sont originaires de la même région. Il s’agit de la petite Kabylie. On se dispensera, j’espère, de me taxer de racisme anti-berbère, moi dont le deuxième « pseudo » au sein du PAGS était El qbayli (le Kabyle), mais on admettra peut-être que ce terroir commun puisse induire un sentiment de solidarité, tout à fait naturel au départ, mais susceptible d’être instrumentalisé.
Ensuite, le Président de l’ATU, qui est un bon contrôleur de chantier avait demandé la direction du chantier d’El Hadjar. J’avais préféré nommer un ingénieur. (J’ai déjà parlé des problèmes entre autodidactes et diplômés dans la SN Métal).
Le nouveau DG, qui appartient au groupe des « anciens » de la société ne me porte pas dans son cœur. (Je n’exclus pas quelques maladresses de ma part, dans nos relations : il était probablement visible que je ne le considérais pas comme particulièrement compétent dans ses interventions dans les affaires de l’Engineering).
Un ami qui a lu mon texte en préparation a tiqué sur ma remarque concernant l’origine des membres de l’ATU. Il m’a cité deux phrases apparemment opposées : l’une, de Lénine : la vérité est toujours révolutionnaire. L’autre, tirée de la sagesse populaire : toute vérité n’est pas bonne à dire. Personne ne sera surpris que je choisisse Lénine, et que j’introduise ici quelques remarques qui peuvent déplaire. Un exemple : lorsque Kasdi Merbah est sorti de son poste à la Sécurité Militaire pour prendre le ministère de l’Industrie Lourde, j’ai été parmi ceux qui lui ont trouvé de véritables qualités d’homme d’État. En discutant avec des collègues, il m’est arrivé d’envisager pour lui la Présidence de la République. J’ai été surpris de m’entendre dire à plusieurs reprises : « ce n’est pas possible, c’est un Kabyle. » Je suis absolument persuadé que ces clivages disparaîtront de la mentalité des Algériens pour laisser la place à une conception de la nation à la fois unie et diverse. Mais à l’époque dont je parle, ces clivages existaient encore. Tout en admettant l’existence d’un véritable sentiment national bien avant la guerre d’indépendance, je suis en élève discipliné de Karl Marx, aussi de l’avis de Maurice Thorez : comme tous les autres pays, l’Algérie est aussi une nation en formation, y compris aujourd’hui.
Le seul bémol, et il est de taille, c’est qu’il n’a pas été possible d’intégrer à cette nation les Européens, comme l’a souhaité pendant (trop ?) longtemps le PCA. L’attachement forcené de cette communauté à « l’Algérie française », c’est-à-dire aux privilèges du colonisateur, n’a pas permis la constitution d’une nation « arc en ciel » que tente aujourd’hui l’Afrique du Sud de Nelson Mandela.
Ceci dit, quand on voit que cinquante ans après l’indépendance, l’essentiel de la communauté « pied-noir » campe toujours sur ses positions, il est évident que l’objectif du PCA relevait de la mission impossible. On peut seulement regretter que cette conception ait débouché sur le sectarisme et l’hostilité d’une partie importante du FLN et que des communistes aient été assassinés dans les maquis qu’ils avaient rejoints. Fort heureusement, l’indépendance obtenue, le racisme, en particulier anti-Européen a immédiatement et fortement régressé.
Je suis d’autant plus à l’aise pour en parler que, mis à part l’épisode comique des graffitis sur ma porte, en 28 ans de travail en Algérie, je n’ai jamais été l’objet de racisme, alors que j’ai fait beaucoup de choses pour embêter beaucoup de monde. Même mon ATU, qui n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour me « charger », n’a jamais utilisé d’arguments de ce type à mon égard. J’en suis très fier, pour moi, et pour mes compatriotes algériens dont j’ai croisé la route.
J’ai même vécu une « adoption » qui allait au-delà de mes attentes. À Jijel, pendant une réunion avec le Président d’une coopérative d’anciens combattants de la guerre de libération, le maire, un peu gêné, essaie sans me vexer de dire à notre interlocuteur que je suis Algérien. Réponse du Président : « sabhan allah, ed dem baïn ! » (bien sûr, on voit bien qu’il est de notre sang !).
Ceci dit, et sans vouloir me livrer à une analyse politique subtile dont je ne suis pas capable, il est évident que mes petits problèmes entrent dans un cadre beaucoup plus large. Boumediène est mort, et avec lui les ambitions industrielles du pays. Le Président Chadli qui lui a succédé a choisi comme mot d’ordre central « Pour une vie meilleure ». Les bananes font leur réapparition dans les Souk el Fellah (chaîne de supermarchés récemment inaugurés), et même les moteurs de hors bord (j’en achète un, d’ailleurs). C’est ce que le PAGS appelle « le glissement à droite » et bien sûr, tout le monde sait que je ne m’inscris pas dans cette logique.
Une commission d’enquête est nommée pour vérifier les accusations de l’ATU. Elle est composée d’ « anciens ». Elle remet un rapport qui n’est pas spécialement élogieux pour ma gestion ( la Commission n’avait pas mandat pour juger de ma gestion, ce dont ses membres étaient rigoureusement incapables, mais d’y repérer des anomalies relevant de la « mauvaise gestion ») mais qui me lave de toutes les accusations qui avaient été formulées contre moi.
Le Ministre de l’Industrie Lourde s’en mêle. Je le connais bien et il a toute ma confiance, malgré les problèmes que j’ai eu précédemment avec lui. Il m’annonce, péremptoire : « tu iras en tôle ou on dissoudra ton ATU ». Effectivement, il nous reçoit , chacun fait valoir ses arguments, mais j’avoue que je manque de pugnacité. Deux raisons à cela : la lente agonie de mon père, et mon appartenance à un parti communiste clandestin qui ne me permet pas l’utilisation d’arguments exagérément « politiques ». Une conclusion bizarre, formulée avec un humour douteux par un conseiller du ministre : le chœur funèbre est impressionnant, mais la morte n’est qu’une souris (traduction libre d’un proverbe arabe bien connu). Ce qui signifie que mes éventuelles erreurs ne méritaient pas des attaques aussi virulentes de la part de l’ATU. Celle-ci se fait copieusement engueuler, mais elle n’est pas dissoute. Quant à moi, il n’est évidemment plus question de « tôle ». Voilà des « syndicalistes » qui s’en sortent bien, eux qui affichaient des rapports accusant une femme de ménage d’être atteinte d’une maladie vénérienne !
Le DG intervient : il me propose de m’occuper de l’unité génie civil. Elle est composée de plusieurs centaines d’ouvriers, mais ne dispose d’aucun ingénieur. Je décline l’offre et je me prépare à quitter l’entreprise. Il est clair en effet que les partisans de l’industrialisation sont battus, que l’on va « bouffer le pétrole » tant qu’il y en aura. D’ailleurs, une baisse des prix met rapidement le pays au bord de la banqueroute. Comme beaucoup d’autres, je n’ai plus ma place dans ce système. Mieux vaut ne pas penser à tous ces jeunes cadres, promis à un rôle glorieux dans l’édification d’une industrie nationale et qui seront payés à ne rien faire jusqu’à ce qu’on se mette à vendre les « bijoux de famille » à des prédateurs étrangers ou nationaux compradores, comme diraient mes amis du PADS.
Mon père est décédé dans des circonstances dont, aujourd’hui encore, je ne peux me rappeler sans avoir la gorge serrée. Je me suis battu avec lui contre son cancer, et quand la situation est devenue critique, je l’ai emmené à Bordeaux dans un laboratoire qui pratiquait une thérapie de la dernière chance. Malheureusement , cette thérapie n’a pas fonctionné dans son cas et je me suis retrouvé un jour dans la clinique, devant mon père qui sombrait dans le coma. On imagine mon état d’esprit quand le téléphone sonne. Une voix que je qualifierais de martiale me parvient, qui me prend visiblement pour l’administration de la clinique : « Ici la Direction de la Sécurité Sociale d’Alger. Vous avez dans votre établissement un ressortissant algérien que nous souhaiterions rapatrier d’urgence en Algérie. Nous envoyons un avion pour cela ». Effectivement, quelques heures plus tard, nous volons vers Alger et mon père décédera chez lui trois jours plus tard. La voix du téléphone était celle de monsieur Aïder, un dirigeant de la Sécu d’Alger. Je pense qu’il a été informé par Marie Rose Péréto. Quelques jours plus tard, quand je lui ai téléphoné pour le remercier, il m’a répondu que ses collègues et lui-même avaient estimé que « Georges Gallinari avait suffisamment fait pour son pays pour qu’on fasse en sorte qu’il y repose. » Monsieur Aïder est décédé il y a quelques années. Bien que je sois absolument athée, j’ai envie d’utiliser à son égard la phrase traditionnelle prononcée en Algérie pour un défunt : Que Dieu l’accueille en son vaste Paradis.
Il est temps pour moi de régler un autre problème, celui de mon divorce. Comme je l’ai déjà dit, mon épouse a l’élégance de me laisser les enfants qu’elle est libre de voir ou d’emmener chez elle. Nous faisons ça entre gens bien élevés et encore aujourd’hui, je considère mon ex-belle famille comme ma famille tout court.
Je fais rapidement la connaissance de Sakina, celle qui sera ma troisième et dernière épouse. Je comprends tout de suite qu’elle sera non seulement ma femme, mais un jour (aussi éloigné que possible) ma veuve.
Nous n’avons, en effet que des « atomes crochus ». Mais là où elle marque un point décisif, c’est que, bien qu’Algérienne jusqu’au bout des ongle et parfaite arabophone, elle est aussi capable de reprendre au refrain le tango des fauvettes, une chanson des années 1920 chère à ma mère. Décidément, elle a toute les qualités.
C’est un peu par le même mécanisme que Sakina deviendra une véritable mère pour Nassim et Khaled, bien que ceux-ci n’aient jamais perdu le contact avec Nadia. Elle fond devant deux garnements de quatre ans qui chantent le Chant Général en espagnol, sans rien y comprendre bien sûr. Il faut dire qu’ils l’ont tellement entendu à la maison. Pour eux Anahuac, le nom aztèque du Mexique, se chante ana houa (c’est moi, en arabe).
Je suis très bien accueilli dans ma belle famille. Mon beau père est décédé depuis plusieurs années ; c’était un musulman pieux, mais quand même un peu hétérodoxe, d’après ce qu’on m’en a raconté. À un point tel que je regrette vraiment de ne pas l’avoir connu.
Ma belle mère est une femme délicieuse. Elle ne parle pas un mot de français, elle est elle aussi une musulmane très pieuse, mais ce qui la caractérise pour moi, c’est qu’elle est extrêmement spirituelle, ce qui rend la conversation avec elle très agréable. Elle a seulement quelques difficultés à prononcer mon nom. Pour elle, je resterai jusqu’à la fin « forno ».
Mon camarade Pierre Cots, que j’avais retrouvé par hasard à la SN Métal quitte l’Algérie. Il me laisse sa petite villa à El Biar, et je m’y installe en famille, après avoir obtenu l’ « arrêté » auprès des services des biens vacants grâce à mon ami Rachid.
La crise du logement sévit à tous les niveaux du pays et je suis menacé d’expulsion. Je me bats comme je peux et je parviens à rentrer en contact avec le secrétaire général du ministère de l’Intérieur. Il me fait une déclaration surprenante, mais qui me convient tout à fait : « monsieur Gallinari, vous êtes Algérien ? Alors vous réglez le problème à l’algérienne ; vous restez à l’intérieur de votre maison, avec un fusil et vous descendez la première personne qui essaie de violer votre domicile ». Je suis tellement tranquillisé par ce conseil que je ne réponds même plus aux convocations de la préfecture.
Il me reste à me faire admettre dans le quartier. Les choses se passeront en plusieurs étapes. Visiblement, après le départ des Cots, certains sont déçus de voir encore arriver des « étrangers ». Ils le manifestent en écrivant sur mon portail une expression consacrée en la matière : « roumi fayah » (étranger puant). Je réponds (j’en ai un peu honte aujourd’hui) en écrivant une petite phrase traitant (en arabe, bien entendu) mes détracteurs de racistes et en mettant en doute leur virilité. Plus d’insultes écrites sur mon portail. J’ai gagné la guerre des graffiti.
La deuxième étape est beaucoup plus sympathique. Un vieux monsieur se présente à ma porte : c’est le jardinier du quartier. Il me fait remarquer que mon bougainvillier a sérieusement besoin d’être taillé et me propose ses services. Je lui demande son prix. Il répond avec hauteur : « tes enfants vont à l’école avec mon petit fils, c’est à moi de tailler ton bougainvillier, et ne me demande pas mon prix ». Je me suis senti très fier de moi, de mes enfants, et de mes voisins. Aujourd’hui encore, malgré nos longues absences, nous sommes toujours accueillis fraternellement dans le quartier.

La prière à l’école
cinquième à partir de la gauche, Nassim
Pour ce qui est de l’école de mes enfants, nous vivrons deux réalités fort différentes. Pour les aînés, c’est une école que certains trouveront un peu archaïque, entre autres par son aspect moralisant et même religieux (on y apprend à faire la prière), mais mes enfants s’y épanouissent. Il faut dire qu’ils sont plutôt bien bâtis et qu’ils sont de bons judokas. Mon fils Khaled est même carrément amoureux de son institutrice. En tous cas, sans être des élèves exceptionnels, les deux acquièrent une formation qui leur permettra plus tard des études supérieures en France.

C’est la première rentrée pour Réda.
Nassim et Khaled l’encouragent
Le plus jeune, Réda, né deux ans après mon mariage avec Sakina, arrive à l’école en 1988, et là, ce n’est plus du tout la même chose. Avec l’intégrisme arrive la bêtise et même la cruauté : il est battu par son maître et je vais pour le venger. Je suis reçu dans le bureau du directeur qui est un homme remarquable et qui me dit : « je vous mets au défi de le frapper ». Il appelle le maître en question et je vois arriver un homme en pleurs qui me jure qu’il traite mon fils comme le sien, ce que malheureusement je crois vrai.
Les institutrices sont moins violentes. L’une d’entre elles menace quand même les enfants d’une façon peu miséricordieuse : « que Dieu vous donne le sida ».
Je ne résiste pas à l’envie de briser une fois de plus la chronologie du récit. Nous sommes à Montpellier vers 1995. Mon fils Nassim est sollicité par son club de judo pour une démonstration au bénéfice des prisonniers de la Centrale de Villeneuve les Maguelonne. Il accepte bien sûr et au moment d’entrer sur le tapis, l’animateur le présente : « Nassim Gallinari, champion d’Algérie cadet ». Formidable ovation de la part des prisonniers qui sont presque tous des Maghrébins !
Ces échanges « internationaux » ne se passent pas toujours très bien. J’ai le souvenir d’un entraînement dans la salle (sacrée pour mes fils) de la JSEB. Un Français travaillant en Algérie y avait inscrit son fils Fabrice. Vers la fin de la séance, les entraîneurs divisaient les enfants en deux groupes. Fabrice était évidemment dans l’un des groupes. Arrivé à son tour, il était comme tous les autres combattants encouragés par les membres de son groupe. Mais le père, ne comprenant pas ce que les enfants disaient, était persuadé que tout le monde était contre son fils. J’ai eu beau essayer de lui expliquer la situation, on ne l’a plus revu. Je ne voudrais pas théoriser outre mesure, mais j’ai envie de dire que le racisme est avant tout ignorance.
Emporté par mes souvenirs de judo, je voudrais parler du Président de la section, monsieur Ould Hadda. Personnage à la fois autoritaire et très aimé des enfants, il avait une façon pittoresque de dire les choses. Dans un déplacement à Oran, l’équipe cherche un hôtel pour passer la nuit. Il entre à la tête du groupe dans un établissement qui lui paraît convenable, mais où on lui présente un prix astronomique, du moins pour lui. Avec son fort accent kabyle, il apostrophe le réceptionniste à propos du prix du petit déjeuner : « maadjoun ntaakoum ntaa dheb oullah !, (il y a de l’or dans votre confiture, ma parole !). On comprend que les enfants l’aient adoré.
Revenons en 1980. Il s’agit de trouver un emploi, maintenant que je suis grillé à l’industrie. Mon choix se porte sur un travail de type universitaire, et je me fais embaucher comme maître assistant stagiaire à l’École Polytechnique d’Alger. Les débuts ne sont pas faciles, car j’ai beaucoup oublié de ce que je n’ai pas vraiment appris. Je rencontre un professeur polonais qui est un sage. Son credo, c’est : le meilleur moyen de vraiment apprendre, c’est d’enseigner. Je deviens son assistant et j’assiste à ses cours pour me mettre dans le bain. Au bout de quelques mois, je me sens suffisamment à l’aise pour proposer en travaux dirigés aux étudiants des problèmes que je ne sais pas résoudre. C’est l’occasion d’une réflexion en commun. Immanquablement, le problème est résolu et les étudiants pensent que mon ignorance est feinte et qu’il s’agit d’un procédé finement pédagogique.
Parallèlement, je démarre un magister (équivalent à ce qu’on appelait précédemment un troisième cycle ). Un ami qui travaille au Centre de Technologie Nucléaire me propose de travailler à la réalisation d’une installation de précipitation de l’uranium. C’est exactement le genre de sujet qui me convient : toujours la quête de la technologie. De plus, le CSTN dispose de moyens qui me permettent de boucler mon magister en deux ans et demi, ce qui est le délai normal, mais que les thésards de l’université ne peuvent en général pas tenir, faute de matériel. J’ai même l’honneur de voir l’une de mes fioles intéresser le Président Chadli en visite dans nos laboratoires. Il l’agite prudemment. Il faut dire que sur l’étiquette est écrit : uranium précipité à l’état de diuranate :... d’ici que ce soit explosif...
En 1982, je deviens maître assistant titulaire à 42 ans. Je ne suis pas en avance dans ma carrière universitaire. Mon retard s’aggrave devant l’impossibilité de démarrer une thèse d’État, faute de moyens matériels essentiellement. Pendant ce temps, j’enseigne à l’université de Bab ez Zouar, et je me perfectionne en arabe, bien décidé à assurer un jour des cours en langue nationale. Je passe le brevet d’arabe littéral et je commence à m’entraîner. Lors de ma première prestation, je m’excuse en utilisant un proverbe algérien, et dans un arabe impeccable (je me suis soigneusement préparé) de traiter l’assistance comme ces orphelins dont la tête servait à la formation des apprentis coiffeurs.
C’est pendant cette période que j’entre en conflit (amical) avec les camarades du PAGS avec lesquels je suis en contact. Je réalise en effet que la maîtrise insuffisante de la langue oblige à un appauvrissement du message, et interdit pratiquement la digression apparente que je considère comme essentielle.
Si l’enseignant n’ a pas la possibilité, en fonction des réactions de son auditoire, de lancer des ponts entre des domaines de la connaissance apparemment étrangers les uns aux autres, mais en réalité reliés entre eux, on peut parfaitement le remplacer par une cassette enregistrée. De plus, l’arabisation pénalise paradoxalement les étudiants arabophones, car ils n’ont pas accès à la documentation et à la littérature scientifique ou non dans les langues étrangères (français et anglais essentiellement). Heureusement, les efforts que j’ai déployés pour apprendre l’arabe me mettent à l’abri de suspicions diverses. Arabiser, bien sûr, mais aussi renforcer parallèlement l’enseignement des langues étrangères. J’ai la satisfaction de voir mon point de vue adopté, après de vifs débats, comme on dit en langage diplomatique.
À l’appui de ma position, j’ai l’exemple de mon étudiant Bourouis. C’est un étudiant d’origine modeste et presque exclusivement arabophone qui arrive pour une formation d’ingénieur. L’une de ses condisciples vient me voir pour me dire que je ne dois pas me fier aux difficultés de langage de Bourouis, et qu’il est un très bon étudiant. Je fais mon travail comme d’habitude, sans tenir compte des difficultés éventuelles qu’un étudiant arabophone pourrait éprouver à me suivre. À la fin de l’année, il se retrouve en tête de promotion et après ses études d’ingénieur, il obtient une bourse pour un doctorat en France, à Toulouse. Deux ans après, alors que je travaille à Toulouse pour la bibliographie de ma thèse, je demande à la bibliothécaire des nouvelles de Bourouis. Elle m’indique que « monsieur Bourouis » fait partie des meilleurs doctorants de l’Université et l’appelle pour que nous puissions nous rencontrer. Je vois arriver un jeune homme à la fois timide et épanoui, qui m’appelle « cheikh » et qui me donne l’accolade. J’en suis ému encore aujourd’hui.
Comme toujours pourtant, les choses ne sont pas aussi simples qu’on peut l’espérer. Ainsi, à une certaine époque, l’enseignement en Algérie était dispensé soit pratiquement totalement en arabe, soit dans des sections « bilingues ». Un jour de rentrée scolaire, je reçois la liste des fournitures pour mes enfants. La liste est rédigée en arabe et je me présente à la papeterie du quartier. Je remets la liste au vendeur, mais il m’arrête tout de suite : « je ne comprends rien à votre papier, moi j’ai fait bilingue ».
Il me faudra cinq ans pour trouver un cadre de travail qui me permette d’entamer un doctorat d’État. Un professeur français algérois d’origine et dont je connais très bien la famille me propose un sujet de thèse portant sur le traitement de l’eau. Je bénéficie de sa part d’une aide scientifique et matérielle. Mon camarade Georges Acampora me présente à un fabricant d’extincteurs qui fabriquera les équipements que je conçois. Je soutiens ma thèse d’État en 1992, l’année même où ma mère décède. L’insécurité règne et plusieurs de mes camarades sont assassinés . En 1993, mes fils aînés passent le bac, le dernier doit rentrer au collège. Le moment est propice à un départ vers l’étranger. La famille s’embarque vers la France. C’est un peu la fin de la saga des Gallinari en Algérie. Pas tout à fait quand même puisque je conserve ma maison à Alger, que j’y retourne de temps en temps, et que je l’ai déjà léguée à l’un de mes fils.
Pour tranquilliser ceux qui se demandent ce que je suis devenu en fin de compte, je dirai brièvement que j’ai été miraculeusement embauché à l’Université de Montpellier, que j’y ai travaillé plus de dix ans et que je suis maintenant à la retraite à Sète, dans une maison que mes parents m’ont léguée avec la bénédiction de mon frère et de ma sœur.
Mais mon récit n’est pas fini. Il y manque une dimension essentielle, l’engagement politique sans lequel on ne comprendrait probablement pas mon obstination à faire avancer mes idées dans le domaine professionnel, et sans lequel je ne concevais pas ma présence en Algérie. Soyons clairs. Quand je finis mes études, je suis ingénieur, marié en France avec une femme que j’aime et qui est en train de finir des études de pharmacie. Beaucoup se contenteraient d’une telle situation. Si ce n’est pas mon cas, c’est que j’ai hérité de mes parents un engagement politique qui me caractérise depuis mon plus jeune âge. Il n’est pas question pour moi de ne pas au moins essayer de matérialiser cet engagement, dans un pays qui est le nôtre par choix, car nous avions la possibilité d’aller nous faire voir ailleurs.
En 1965, lorsque je suis embauché à la Sonatrach, la situation des communistes dans le pays est extrêmement délicate. L’opposition au coup d’État de Boumediène les a contraints à la clandestinité, dans des conditions dramatiques d ’impréparation. Un grand nombre d’entre eux sont arrêtés et torturés, les autres sont souvent dans la nature. Mon camarade Salah me racontera qu’il a même dormi en plein Alger à la belle étoile.
Je sympathise au travail avec Bachir, un ancien dirigeant du mouvement étudiant. Il me sonde discrètement. Je dévoile un tantinet mes batteries, compte tenu de ce que je sais du personnage. Quelques jours plus tard, je reçois la visite d’un camarade que je ne connais pas, mais que mes parents connaissent bien. Il s’agit d’un dirigeant du PCA qu’ils reconnaissent immédiatement malgré sa barbe imposante. Nous déjeunons chez mes parents et nous nous retirons pour discuter des modalités de mon intégration. J’annonce un brin romantique que mon engagement n’aura de limites que celles de ma compétence.
Mon adhésion au mouvement est décidée. Il s’agit d’une structure provisoire qu’on a appelée ORP, l’Organisation de la Résistance Populaire. Elle regroupe des communistes et aussi des anciens du FLN qui ne sont pas d’accord avec le coup d’État. Ce caractère hétéroclite coûtera cher au mouvement, car parmi les anciens FLN se trouvent des infiltrés qui font leur travail de policier, ce qui permet les coups de filet que j’ai mentionnés plus haut.
Je suis affecté à des tâches « techniques » qui sont le plus souvent des tâches d’intendance. Prises en charge diverses de camarades clandestins, locations d’appartements sur ma bonne mine, transports, et quelques tâches un peu plus « nobles »… Mes contacts estiment à juste titre qu’avec ma dégaine d’Algérien « issu de l’immigration », je ne suis pas exactement un homme susceptible de participer au travail de masse. J’en suis frustré et pendant les 28 ans de clandestinité, je ruerai périodiquement dans les brancards à propos de cette limitation à mon action. Un jour, devant mes récriminations, ils décident de me faire prendre en charge par une structure opérationnelle. C’est un opération compliquée, car il faut détruire tous les liens que j’entretenais précédemment. On y parvient enfin, mais au bout de quelques semaines, mes nouveaux camarades, qui n’avaient pourtant pas été briefés me servent le même refrain sur l’impossibilité à m’intégrer dans le travail de masse. Je reprends donc mon travail avec mes contacts précédents.
Il faut dire que ceux-ci sont ce qu’il y a de mieux en termes de camarades. Auprès d’eux, j’approfondis mon attachement au parti et au pays. Ils me donnent une image d’un engagement total et sobre, servi par ce qui me paraît une lucidité remarquable et une connaissance impeccable des conditions socioculturelles et politiques qui caractérisent la situation du pays.
Mais avant tout, ce qu’ils m’apportent, ce sont leurs extraordinaires qualités humaines qu’ils mettent évidemment au service de leurs idées, mais qui sont aussi présentes dans tous les instants de la vie en commun. Franchement, si je n’ai jamais regretté mon engagement, c’est avant tout parce qu’il m’a permis de passer ma vie avec de tels hommes. J’allais dire moins pour des raisons politiques que pour des raisons morales, mais j’entends mon cher camarade Ramdane, qui a été assassiné par les intégristes. Il me fait remarquer que pour nous, politique et morale sont indissolublement liées.
Ce ne sont pas pour autant des surhommes. Achour est un fin gourmet. Il ferait des kilomètres à pied (la nuit car il ne sort pratiquement jamais le jour) pour un bon repas, Ramdane l’ingénieur se régale dans les réparations du matériel (on dit de lui qu’il a une conception un peu « mécanique » du marxisme-léninisme). Salah a les pires difficultés à organiser ses rendez-vous et provoque des télescopages qui mettent Achour fort en colère. Et Achour, quand il est en colère, chuchote presque : « non, vraiment, je ne comprends pas... ». En face de lui, les têtes rentrent un peu dans les épaules. Il n’y en a qu’un dont je n’ai jamais trouvé le point faible, c’est Djamel. À mon avis, c’est le dur à cuire du groupe.
Nassim, par contre, est le plus préoccupé. Il est marié avec une Russe et il a un fils qu’il ne connaît pas. Pour l’aider à passer ce cap difficile, je l’emmène quelques fois le dimanche à la campagne, et là, comme tous les montagnards kabyles, il fait montre d’une culture botanique impressionnante, bien qu’un peu utilitaire. Il herborise : « ça, c’est une herbe qu’on appelle “vivrass” ; en Kabylie, on la mange ». La deuxième partie de sa phrase n’a rien pour moi d’inattendu.
Ces hommes hors du commun ont aussi des moments de vague à l’âme. L’un d’entre eux avait rencontré une ancienne connaissance qui l’avait reconnu. Après une brève conversation, elle avait gentiment ironisé : « Alors, toujours Don Quichotte ? ».
Le camarade en avait été tellement touché que j’avais décidé de lui ramener le bouquin. Pour moi, la réflexion était un immense hommage : si chacun d’entre nous a, un jour ou l’autre, transigé avec ses convictions, accepté d’avaler des couleuvres, voire admis l’inadmissible, ce n’est pas le cas de Don Quichotte. Le vieillard est certainement ridicule avec son accoutrement et son désordre mental contracté à la lecture des romans de chevalerie, mais quand il croit voir des géants en face de lui, il n’hésite pas un seul instant : il pointe sa lance et passe à l’offensive. Pour moi, Don Quichotte est au fond l’homme que nous voudrions tous être, l’homme qui ne s’est jamais « dégonflé ».
Au passage, je recommande la lecture de la préface de Henry de Montherlant à l’édition de poche du chef d’œuvre de Cervantès : Celui-ci, censé être un éminent spécialiste de l’Espagne, dit lui-même avoir lu le livre un crayon en main pour compter ses invraisemblances. Pour moi, l’auteur de la préface n’a rien compris à Don Quichotte. Il n’a sans doute pas compris, en tout cas, pourquoi le Chevalier à la triste figure connaît un culte planétaire que ses œuvres ne connaîtront jamais.
J’apprendrai la légalité venue que tous les dirigeants du PAGS n’ étaient pas des phénix, mais ceux avec qui j’ai travaillé correspondaient exactement à l’idée que je me faisais (et que je me fais toujours) de dirigeants communistes.
J’ai deux anecdotes qui concernent, bien sûr, Salah.
La première se passe à une époque où il avait besoin de se soigner. On décide que ce sera chez moi. On met au point avec Achour et lui un scénario : pour la personne qui doit prodiguer les soins, nous ne nous connaissons pas. Ils arrivent un soir et on soupe avant de passer aux choses sérieuses. Dans la décontraction du repas, Salah, qui est censé ne m’avoir jamais vu, dit à Achour :« tu ne trouves pas qu’il a grossi depuis l’année dernière ? ». Il se mord la langue, mais c’est trop tard, notre scénario est tombé à l’eau.
Une autre fois, j’ai rendez-vous avec lui dans la rue. Je l’attends en voiture. Je le vois arriver. Il passe sans me voir devant moi, et poursuit sa route une vingtaine de mètres. Il arrive devant une voiture stationnée dans laquelle il y a plusieurs personnes. Il se penche à la portière, dévisage posément les personnes, puis revient vers moi. Il monte dans la voiture et dit : « j’ai pensé que ces gens là pouvaient être des flics, mais non tout va bien, on peut démarrer ». Pas très organisé, Salah, mais quel courage !
Salah est aussi féru de poésie et de musique. Dans les moments de détente, il essaie de m’initier, en m’expliquant la musique andalouse et les textes des chansons de Fergani. Mais son poète préféré, c’est El Moutennebi :
Les chevaux, la nuit et le désert savent tous qui je suis
Aussi bien que l ’épée, la lance, l’encrier et la plume.
En version originale, je vous garantis que ça a de la gueule ! On comprendrait presque que le poète ait accepté de mourir pour ces deux vers.
Le point d’orgue de cette vie de militant, je le vivrai après le retour à la légalité. J’annexerai à ce texte une petite « contribution » que j’ai rédigée il y a quelques années, et qui en dit long sur la débandade au sein du parti dans cette période. J’aurai au moins terminé, comme je l’ai vécu, cet engagement aussi dans l’humour. Lors du Congrès du PAGS, au moment de la constitution de la liste des candidats au Comité Central , nous montons un canular avec mon ami Mustapha.
Nous parcourons les travées, moi l’air sombre, lui faisant mine de me consoler. Quand un camarade que je connais particulièrement me demande la raison de ma contrariété, je me montre réticent à répondre, puis j’avoue : « Je me suis porté candidat au Comité Central mais ma candidature a été refusée parce que je ne suis pas circoncis ». Évidemment mon interlocuteur s’indigne de cette manifestation de racisme inconcevable dans un parti comme le nôtre. À ce moment Mustapha intervient : « nous n’en resterons pas là, nous avons l’intention de porter l’objet du litige au niveau du Bureau du Congrès »
Il ajoute, la moustache frémissante à force de rire contenu : « et le Congrès tranchera ! »

Voici les premiers destinataires de ce texte,
en attendant leurs cousins éventuels
La coupe de cheveux de Pablo est due
à un essai de sa grande sœur Lisa
haut
Postface
Défends le but de ses corolles,
partage les nuits ennemies
veillant au cycle de l’aurore,
respire la cime étoilée, en protégeant l’arbre, cet arbre
qui pousse au milieu de la terre.
Pablo Neruda
Je l’ai déjà dit : j’ai écrit ce texte pour ma descendance. Qu’est-ce qu’il peut bien leur apporter ?
Eh bien comme les nobles lèguent leur particule, je voulais que mes petits enfants sachent d’où ils viennent. De Jeanne ma grand mère, morte devant les baquets de lessive des bourgeois, de Fernand le grand père, mis à pied au Gagne Petit pour une savonnette, quand ses patrons collectionnaient les millions, de Joseph mon grand père, qui racontait que sur les grands voiliers, quand un homme tombait à la mer par gros temps, on se contentait de jeter par dessus bord une couronne de sauvetage, sans se dérouter, de Georges mon père, spolié de ses droits par une institution censée être au-dessus de tout soupçon, muté, interné pour ses convictions, et à qui le gouvernement socialiste a proposé, à titre posthume, un peu moins de 1000 euros que nous avons bien sûr refusés, pour tous ces dénis de droit ; de Fernande ma mère, cigarière que l’on cachait quand passait l’inspection du travail parce quelle n’avait pas l’âge de travailler et qui avait en permanence un bleu sur la hanche parce qu’elle y calait la corbeille qu’elle portait toute la journée. De mon frère, de ma sœur et de mon beau frère dont j’ai raconté les humiliations.
Je ressens une grande fierté d’appartenir à une telle lignée, qui est devenue une lignée de communistes à partir de Georges mon père, jusqu’à mes enfants.
Le mouvement communiste a été l’objet de répression de toutes sortes, d’agressions répétées contre sa citadelle jusqu’à ce que celle-ci, l’Union Soviétique, soit détruite. Mais grâce à l’existence de ce bastion, les travailleurs ont pu conquérir des droits qui leur ont permis de mieux vivre, des peuples ont pu conquérir leur indépendance. C’est dans ce cadre aussi qu’il faut placer la possibilité que j’ai eu de devenir ingénieur quand toute perspective d’étude avait été écartée pour mon père. Sans faire de parallèle mécanique, on peut constater que depuis la fin de l’URSS, les capitalistes et leurs financiers ont repris leur liberté de manœuvre : le chômage a explosé ainsi que les profits des multinationales. Le monde que nous vous léguons sera difficile pour vous. Il l’est déjà, en particulier pour les plus jeunes. Nous n’avons pas pu le changer, alors, à vous de jouer !
Dans la France d’aujourd’hui, comme dans tout le monde occidental et pour quelques temps encore, à l’aide d’un pilonnage médiatique unique dans l’Histoire de l’humanité, on fait aux communistes un procès pour manquement aux droits de l’homme. Nous sommes prêts, comme dit le philosophe Alain Badiou, à faire la comparaison entre le capitalisme et le communisme en matière de droits de l’homme. Au Goulag qu’on nous envoie régulièrement au visage, et dont on a truqué les chiffres sans vergogne, nous pouvons opposer les millions d’Africains morts en esclavage, en particulier aux USA, citadelle du « monde libre » bâtie sur le génocide des Amérindiens, les centaines de milliers de civils tués pendant la guerre d’Algérie et les autres méfaits des colonisateurs. Mon ami Julio me disait que des peuples fueguinos (alacalufes, onas et kawaskar) qui habitaient la Patagonie chilienne à l’arrivée des Espagnols, il ne reste pas un seul individu. Quant au champion français des droits de l’homme, le Président François Mitterrand, maintenant qu’il a fini d’être utile à ses commanditaires, on a sorti des documents prouvant qu’il avait approuvé par écrit les exécutions de patriotes algériens, dont notre camarade Fernand Iveton. Alors, informez vous, ne vous laissez pas bourrer le crâne par des médias qui ne sont souvent que des laquais.
Soyez fiers de vos ancêtres prolétaires,
soyez fiers de vos ancêtres communistes !
En attendant de quitter la vie (ce qui, je le crains, finira par arriver et peut-être plus tôt que prévu), j’ai eu le temps, en bon enseignant, de trouver et de formuler une image que j’ai intitulée :Je suis un fantassin politiquetombé sur les barbelés du Dien Bien Phu mondial. |
Une dernière photo tirée d’un ouvrage édité vers 1950
par le Gouvernement Général de l’Algérie.

Voilà comment
Européens et Musulmans
unissaient leurs efforts
dans l’Algérie coloniale !
haut
Annexe I
Les militants « européens »
de la Section de Bab el Oued
dans les années 1950
Je reproduis ci-dessous un document que m’a remis Pierre Cots et qui me tient particulièrement à cœur. Il concerne les militants « européens » (si tant est que les camarades juifs peuvent être qualifiés d’Européens) de la Section de Bab el Oued dans les années 1950, qui sont pour la plupart de véritables héros, mais dont personne ne parle dans l’Algérie d’aujourd’hui et qui risquent fort de sombrer dans l’oubli.
Ils ont pourtant accompli un parcours extraordinairement complexe pour se dégager de la gangue colonialiste et rejoindre le combat pour l’indépendance, dans lequel plusieurs d’entre eux ont perdu la vie.
Tous, sauf un, sont nés à Alger. Ils ont presque tous disparu. Reste à espérer que des historiens se souviendront d’eux un jour.
Ils me rappellent, eux aussi, Neruda :
Elles furent fleurs invisibles, quelquefois
fleurs enterrées,
d’autres fois elles allumèrent
leurs pétales, comme des planètes.
- Roland Rhais, origine : juif algérien, rédacteur à Alger Républicain, interné au camp de Lodi.
- Azoulay René dit Samson, origine : juif algérien, rédacteur à Alger Républicain, interné au camp de Lodi.
- Amar Paul, origine : juif algérien, rédacteur à Alger Républicain, interné au camp de Lodi.
- Overchio, dit Menefaï, origine italienne, employé au Chemin de fer, interné au camp de Lodi de 1956 à 1960.
- Palacio, origine espagnole, ouvrier maçon, arrêté en 1956 et interné au camp de Lodi jusqu’en 1960.
- Marin Victor, origine espagnole, ouvrier, interné au camp de Lodi de 1956 à 1960.
- Pont Louis, employé d’administration privée, origine espagnole, interné au camp de Lodi de 1956 à 1960. Gravement blessé pendant la 2ème guerre mondiale.
- Valero Alexandre, dit la Varloche, origine espagnole, menuisier, interné au camp de Lodi de 1956 à 1960.
- Acampora Juliette, origine espagnole, a échappé à l’arrestation.
- Acampora Georges, ouvrier tourneur ou ajusteur dans une fabrique de cigarettes (Job) puis pompier. Origine italienne. Militant aux CDL et à l’ALN/FLN arrêté, torturé et incarcéré à Barberousse, condamné à mort.
- Farrugia Jean, né à Alger, d’origine maltaise, plombier, militant dans les rangs des CDL, puis l’ALN/FLN interné au camp de Lodi, extrait de ce camp.
Après de graves tortures, incarcéré à Barberousse et condamné aux travaux forcés à perpétuité.
Il a sauvé sa tête grâce à son passé de résistant durant la deuxième guerre mondiale. Arrêté par les Allemands, il avait été l’un des organisateurs de la mutinerie de la centrale d’Eysse (France) et déporté au camp de Dachau en Allemagne.
Sitôt revenu en Algérie il avait repris ses activités au sein du PCA.
- Hernandez, origine espagnole, ouvrier menuisier, militant dans le réseau ‘La voix du soldat’, arrêté en mars 1957 par le 1er REP, torturé et séquestré à la villa Sesini, incarcéré à Barberousse puis à El Harrach, libéré en 1960.
- Yvorra Vincent, origine espagnole, ouvrier en usine, coffreur puis artisan boulanger, militant dans le réseau ‘La voix du soldat’ et dans les CDL et intégré à l’ALN/FLN. Arrêté en 1958, torturé et séquestré durant trois mois au casino de la Pointe Pescade, transféré à Lodi. Libéré en 1960.
- Cécile Di Fusco, origine italienne, ouvrière dans une fabrique de cigarettes (Bastos) avait échappé à l’arrestation comme les militants suivants :
Domenech Philomène, origine catalane dont l’époux était emprisonné une seconde fois (sa première arrestation datait de la deuxième guerre mondiale. Sans emploi, elle a également échappé à l’arrestation comme le couple Kalfon, origine Juifs algériens, les frères Giner, origine espagnole, les frères Castello, origine espagnole tout comme Juan, radioélectricien et Gallinari Fernande, origine espagnole, dont le mari, Georges, cadre aux PTT, origine italienne, avait été expulsé vers la France après un séjour au camp de Lodi, Karsenti et Falsan, origine Juifs algériens, les deux artisans cordonniers, Climent Paul, origine espagnole, maçon, Canto Paul, son fils Jean, sa fille Paulette et son beau-fils André Espi origine espagnole, (Paul, le père) garçon de café puis réparateur de batteries, Celeste Giacomo, origine italienne, maçon qui avait fui le régime fasciste de Mussolini, Esposito, origine espagnole, employé, Grau Joseph, dit Pico, origine espagnole tout comme son épouse, maçon ayant participé, comme Jean Farrugia et d’autres militants au transfert des armes prises à l’ennemi par Henri Maillot, Valero José, ouvrier, origine espagnole, frère d’Alexandre.
Levy-Valensi, ouvrier plombier, également d’origine juive ; Mireille Valero, dactylo, Ragantini, artisan ébéniste d’origine italienne. Les deux frères Mateu, artisan bottier, la fille de d’un d’eux Marie Matteu, décédée au début des années 80 à Alger.
Pastor (j’ai oublié son prénom était le frère de celui qui a été assassiné )
________
Assassinats de militants européens par l’OAS
ou des éléments incontrôlés de l’ALN 1962 :
- Marin Jean, origine espagnole, estropié, vivant de petits boulots en raison de son handicap, mais militant actif. Frère de Victor
- Pastor Baptiste, origine espagnole, ouvrier menuisier, emprisonné à Barberousse, libéré au bout d’un certain nombre de mois dont je n’ai pas le souvenir.
- Ferrandis Jean, origine espagnole, cheminot, arrêté par le 1er REP en mars 1957 pour son activité au sein du réseau ‘La voix du soldat’, torturé et séquestré à la Villa Sesini et emprisonné à Barberousse puis à El Harrach jusqu’en novembre 1960.
- Robert Segui, origine espagnole, comptable, militant des jeunesses communistes et du PCA.
- Un camarade d’origine chinoise dont le nom m’échappe, artisan maroquinier.
- Perez, origine espagnole, marchand ambulant de calantita aux Trois-Horloges.
_____________
Tués par le FLN
- Ohana, origine : Juif algérien, photographe, tué au cours d’un attentat à l’aveugle fin 1955.
- Joachim Ripoll, origine espagnole, artisan menuisier, tué aux Bains Romains en août 1962.
haut
Annexe II
Pierre COTS
Biographie succincte
Le document suivant m’a aussi été remis par Pierre Cots.
C’est une biographie succincte qui m’a paru absolument exemplaire
Nom : COTS Pierre
Né à Alger le 14 juin 1932. Nationalité d’origine : espagnole
Nationalités actuelles, algérienne et française
Etudes poursuivies : deux années d’école primaire à Bab-El-Oued, Alger
Professions exercées : apprenti, manœuvre, ouvrier en usine, dépanneur en radioélectricité. Technicien polyvalent, Actuellement retraité.
Militant dès ma prime adolescence aux jeunesses communistes algérienne, puis à l’UJDA (Union de la jeunesse démocratique algérienne) à sa création. J’ai été parallèlement militant dans le syndicat de la métallurgie CGT avant la constitution de l’UGSA dont les principaux responsables furent Lakhdar Kaïdi et André Ruiz.
Engagement dans la lutte de libération nationale dès novembre 1954 à travers des actions politiques de soutien au mouvement national de libération. Et, notamment, dans la recherche d’armes pour les CDL (Combattants de la libération), organisation militaire du PCA. Simultanément militant dans le réseau de ‘La voix du soldat’, intégration au FLN/ALN en juillet 1956 à la suite des accords entre cette organisation et le PCA.
Arrêté en mars 1957 par le 1er REP, torturé et séquestré à la villa Sesini. Incarcéré à la prison civile d’Alger, Barberousse, (Serkadji) peu après la mi-avril de cette même année. Transféré à la centrale pénitentiaire de Maison-Carrée (El Harrach) en fin novembre. Condamné par le tribunal militaire après 21 mois d’incarcération et transféré au camp de Beni-Messous puis à celui de Lodi. Libéré de ce camp et expulsé du territoire algérien en mai 1960.
Contexte familial et culturel :
Presque tous les membres de ma famille étaient sensibles et révoltés par la question de l’exploitation et de l’oppression du peuple algérien et certains d’entre eux étaient acquis à l’idée de l’indépendance depuis longtemps.
Chez mon père, cette aspiration lui trottait par la tête depuis les années vingt, lorsque les communistes d’Algérie en avait soulevé la question. Il faut également dans ce cadre évoquer l’influence plus ou moins grande d’un milieu anarchiste très réduit animé notamment par Victor Spilmann. Par conséquent, je peux dire que depuis ma plus tendre enfance j’étais acquis à cette idée.
Un de mes oncles, Rafaël Bellido, d’origine espagnole, né à Bab-El-Oued, ancien prisonnier de guerre en Allemagne, évadé et ayant rejoint le maquis en France, était homme de salle à l’hôpital psychiatrique de Blida (H.P.B). Militant dans les CDL, puis l’ALN/FLN, arrêté 25 mars 1957 par les paras à Blida, il a été salement torturé mais a gardé le silence et, hélas ! de graves séquelles qui l’ont handicapé pour le reste de ses jours. Il a été libéré du camp de Beni-Messous après plusieurs mois d’internement, peut-être douze.
Son épouse, Manolita, une sœur de ma mère, a également toujours milité après son engagement dans les Brigades internationales lors de la guerre d’Espagne. Durant le régime de Vichy, elle m’emmenait avec elle coller l’organe du PCA, ‘La lutte sociale’, sous les arcades de la rue Bab-El-Oued, elle était également femme de salle à l’ H.P.B après la seconde guerre mondiale.
Deux de mes oncles se sont engagés aussi dans les Brigades internationales durant la guerre d’Espagne, l’un d’eux n’en est pas revenu et l’autre a perdu un œil.
Mon père, originaire de la Huerta, un lieu désertique de l’arrière-pays d’Alicante a émigré en Algérie avec ses parents à l’âge de trois ans. Enfant, il a commencé à travailler dans les vignes d’un colon de la proche banlieue d’Alger, puis à l’âge de dix-huit ans est devenu charretier et, plus tard, chauffeur de camion. Ma mère, venue de la même province espagnole encore petite fille, était femme de ménage chez des petits bourgeois de la même origine. Analphabète, mon père qui avait une petite instruction primaire, a pu lui apprendre à lire.
Il y avait à la section de Bab-El-Oued du PCA peu d’Algériens « musulmans ». Cette section s’étendait du Triolet jusqu’au Lycée Bugeaud (Emir AbdelKader, aujourd’hui). La grande majorité des habitants de ce faubourg étaient des travailleurs européens, maçons, plâtriers, plombiers, menuisiers, électriciens, pêcheurs, etc. et artisans ou petits commerçants. Les Algériens demeuraient plus haut, au Climat de France, au Frais-Vallon, à Montpensier, etc. mais je côtoyais tout de même les quelques camarades « Musulmans » (ils étaient huit) de cette section du PCA. Et quelques Algériens du bidonville du Climat de France et d’autres de mon quartier, sept ou huit. Un seul d’entre eux s’est engagé dans la guerre de libération nationale, les autres étaient soit neutres soit francophiles.
J’ajoute que ma sœur (jumelle) Denise Cots, aujourd’hui épouse Georges Perlès, a eu un parcours presque similaire au mien. Apprentie à 12 ans dans la confection, puis vendeuse à la pâtisserie La ‘Parisienne’, rue Michelet (Didouche Mourad) jusqu’en 1962, elle a été arrêtée en mars 1957, torturée et séquestrée par le 1er REP à la villa Sesini puis libérée mais contrainte de pointer trois fois par semaine au commissariat du 5ème arrondissement. Évidemment, ces restrictions ne l’ont pas empêchée de continuer à militer jusqu’à l’indépendance du pays.
haut
Annexe III
Note sur le PAGS dans les années de légalité
(par rapport au texte primitif, j’ai ajouté quelques indications qui le rendent, j’espère, compréhensible, pour ceux qui ne connaissent pas l’arabe)
Malheureusement, si je devais caractériser cette période, je parlerais de déliquescence.
Comment qualifier autrement l’évolution de la situation intérieure du parti qui, pendant plus de 20 ans a joué un rôle de stimulant ou d’organisation dans les syndicats, les organisations de jeunes, les étudiants, les femmes, qui a, malgré la modestie de ses effectifs, influencé la politique du pouvoir en place et acquis un véritable prestige dans la population.
Qu’on en juge, à partir de quelques exemples sur lesquels je reviendrai peut-être :
L’idéologue en chef, auteur du projet de résolution politique idéologique objet de discussions byzantines dans toutes les cellules du Parti, s’avère avoir plus qu’un fil à la patte avec les « services ».
Son acolyte se fait la malle avec la caisse.
Le premier secrétaire dont on a accepté qu’il quitte son poste est cependant mis en demeure de rester à Alger, où, sans protection particulière ou presque, il n’a pas grande chance de survie dans cette époque d’assassinats en série.
Les cadres de l’époque clandestine se disputent les tâches et donc les postes comme s’il s’agissait d’une opportunité de carrière. Qui ne se souvient de la « performance » de l’un d’entre eux à la Maison du Peuple où il pensait que son bon niveau en arabe suppléerait l’absence de contenu de son intervention, ou de tel autre qui découvre une crise quand il s’aperçoit qu’on ne lui fait pas la place qu’il croit mériter au niveau de la direction.
En tant que militant de base, je ne suis pas en mesure de relier pertinemment cette situation au contexte politique, mais il est clair que le désarroi qui s’empare du MCOI (mouvement communiste et ouvrier international, abréviation brevetée PAGS) avec l’effondrement de l’URSS n’y est pas étranger, d’autant plus que des divergences quant au rôle de Gorbatchev par exemple sont en général bien identifiées y compris par la base.
Ainsi on peut assister à une présentation enthousiaste d’un membre éminent de la direction pour lequel la glasnost et la perestroïka assureront un rayonnement planétaire aux idées du socialisme scientifique, tandis que dans la cellule d’El Biar, un militant chevronné, tel Caton l’Ancien condamnant Carthage, commence systématiquement ses interventions par : « Gorbatchev, inaal oueldih … » (Gorbatchev, maudits soient ses géniteurs,...)
Le Congrès sera un des points culminants de la crise. L’adjectif « mkhaïta » (préfabriqué) reviendra comme un leitmotiv dans la salle et sera confirmé quand le candidat qui obtiendra le moins de voix sera désigné à la tête du Parti. Je me souviens avoir croisé une camarade unanimement appréciée et connue pour la naïveté qu’elle feint souvent, qui m’avait demandé : « tu n’as pas l’impression qu’on est en train de se faire avoir ? »
Cette période est effectivement considérée comme funeste par les militants, mais avec le temps qui passe, elle est perçue différemment, en particulier en fonction de leur position hiérarchique.
Les membres de la Direction, ou ceux qui ont gravité autour, sont souvent critiques, voire ironiques. Ils diffusent des informations (qu’ils détiennent en principe depuis longtemps) sur les pratiques plus que contestables des dirigeants, et comprennent enfin que l’échec était inscrit dans les gènes du parti.
Chez les militants de base, le son de cloche est en général beaucoup plus nuancé et en particulier la plupart des camarades insistent sur le bonheur qu’ils ont eu à militer dans ce parti que ce soit dans la clandestinité (où la camaraderie était si belle et où ils ont tant appris) ou dans la légalité où les réunions de cellule étaient si chaleureuses. On avait attendu si longtemps de pouvoir distribuer dans la rue les documents du parti…
Restent enfin ceux qui ont repris le flambeau et qui cherchent le chemin qui devrait les faire repartir vers la quête du Graal socialiste. Ceux là aussi se déchirent entre « sectaires » et « révisionnistes », quand les qualificatifs ne sont pas plus grossiers, ce qui est malheureusement courant.
Note de l’auteur : aujourd’hui (décembre 2010), comme me le fait remarquer un camarade, il ne reste plus que les « sectaires » qui restent engagés dans la quête du Graal socialiste. Les « révisionnistes » sont partis vers de nouvelles aventures.
haut
[1] c’est en 1966 que Bachir Hadj Ali écrira "L’arbitraire" alors qu’il était lui-même arrêté et torturé http://www.socialgerie.net/spip.php?article135, après la diffusion de son témoignage les "tortures" avaient été "suspendues"
[2] Georges Accampora nous a quittés en février 2012
sur socialgerie lire :
- “ACCAMPORA : PRÉSERVEZ EN VOUS LA BRAISE (DE NOTRE COMBAT), NOUS EN AVONS BESOIN DANS NOTRE PAYS !” samedi 18 février 2012 ;
- DÉCÈS DU MILITANT ET MOUDJAHID, GEORGES ACAMPORA - dimanche 12 février 2012 ;
[3] Texte ajouté en juillet 2014, sur la demande de Fernand Gallinari
