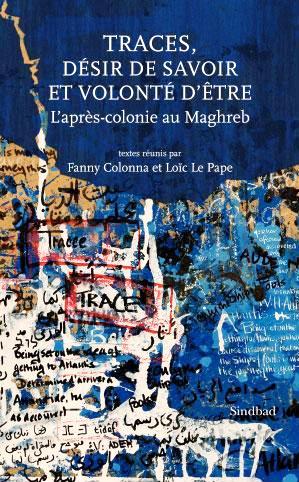Accueil > CULTUREL > L’APRES-COLONIE AU MAGHREB
TRACES, DÉSIR DE SAVOIR ET VOLONTÉ D’ÊTRE
L’APRES-COLONIE AU MAGHREB
Textes réunis par Fanny COLONNA et Loïc LE PAPE
vendredi 15 octobre 2010
"Traces, Désir de savoir et Volonté d’être" : On ne saurait mieux titrer l’ouvrage collectif coordonné et présenté par Fanny Colonna et Loïc Le Pape, avec la participation de dix huit auteurs du pourtour méditerranéen (ACTES SUD, Sinbad).
Difficile aussi de rendre compte d’une production aussi foisonnante, vivante et multidisciplinaire. Sinon pour signaler que ce genre de préoccupations et travaux vient à son heure. (Socialgerie avait signalé il y a quelques mois l’approche géopolitique et historique par Yves LACOSTE de ce qu’il a appelé "La question post-coloniale" à l’aune des nouveaux rapports internationaux).
Le temps écoulé depuis les indépendances a fait mûrir le besoin de réflexions et de regards rétrospectifs chez les chercheurs et dans les opinions concernées.
Une façon de tenter des bilans qui aident à affronter les temps nouveaux, pas aussi radieux qu’on les imaginait mais néanmoins porteurs d’espoirs renouvelés gardant les traces du passé.
Les extraits de la préface et de l’introduction présentés ici rendent très insuffisamment compte de la substance de l’ouvrage. Ils inciteront néanmoins, c’est notre souhait, à entrer de plain pîed dans la diversité des récits, analyses et témoignages.
Préface Loïc Le Pape
(extrait, pp 12 et 13)
… un objet illégitime
... Penser l’après-colonie situe un projet de restitution d’un univers disparu mais qui laisse des traces. Des indices que nous voulions exhumer, fouiller, approfondir et analyser comme autant de moments partagés, de choses qui ont eu lieu. Quelques pistes de travail, que nous avions mis en avant peuvent éclairer une démarche qui s’est affirmée au fil du travail commun.
Tout d’abord, il s’est agi de penser contre une vision totalisante de la colonisation, contre l’idée d’un collectif qui sépare abruptement colons et colonisés. Nous souhaitions privilégier la singularité des parcours, des histoires et des expériences, sans pour autant faire l’impasse sur les « collectifs abstraits » : violence, domination etc. Situer des parcours originaux, privilégier les acteurs, implique de toutes façons de faire référence aux contextes. Ce changement de focale n’est pas évident à mettre en place, compte-tenu de la littérature scientifique et des débats en cours. Il nous a donc fallu lutter contre notre tropisme à penser d’emblée des histoires générales, des mythologies presque…
Seconde option retenue, tenter d’oublier si possible le travail des archives dites de surveillance (administration coloniale, polices etc.) pour favoriser des corpus inédits, des archives privées, des sources religieuses voire des enquêtes orales à la manière de l’histoire sociale et de la micro-histoire. Cela implique un travail de terrain, de reconnaissance comme le recueil de témoignages oraux, de recherches archivistiques originales et l’accès à des corpus peu travaillés.
La troisième option de ce programme était de tisser des objets de recherche entre passé et présent, mais surtout, de voir au moins, sans en exagérer l’importance, le poids du passé dans le présent. Cette façon de mêler passé et présent, cet usage extensif des mémoires, des héritages ou des commémorations, nous a permis des constats et des conclusions pensons nous, originaux. Cette façon de faire ouvre en effet le champ de ce qui reste caché, des oublis ou des mécanismes de défense, bref, tout ce que les hommes et femmes rencontrées n’ont pas dit, tout ce qui est indicible car peut être trop douloureux.
Dans la continuité d’une démarche initiée de longue date, Fanny Colonna a proposé une attention approfondie de la notion même d’écriture scientifique.
Le Programme a tenté d’être un entraînement progressif à l’écriture, une élaboration collective de résultats en temps réel, une fabrication « artisanale » d’objets scientifiques.
L’ouvrage a été conçu collectivement, dans le temps final de la recherche. Il est ainsi le fruit du travail de chacun pour rejoindre une réflexion collective, pour prendre en compte les suggestions et idées des autres, pour se mettre en résonance ou prendre acte d’un porte-à-faux.
En ce sens, les pages présentées ici sont une expérience, une sorte de « happening », pour nous en tout cas.

Un tel ouvrage laisse nécessairement des traces. Celles des enquêtes et du travail personnel, de l’entreprise collective qui a suivie, mais aussi des traces plus personnelles, celles de chaque auteur et de son rapport à l’objet, aux autres, autant d’indices qui se fondent dans les dits et non-dits de ces chapitres.
____________________________________________________________
À propos de traces…
Extraits de l’Introduction de Fanny Colonna
Peut être faut-il partir d’une remarque récente de Jacques Pouchepadas, sur le faible écho rencontré par le débat postcolonial, au Maghreb et à propos du Maghreb (Pouchepadas, 2008, note 2), remarque corroborée par le casting du récent colloque parisien (octobre 2009) intitulé Cultures d’empires qui, sur une quarantaine de contributions, n’en propose que quatre en rapport avec cette région du monde, tandis qu’ au dire des organisateurs mêmes, les 150 réponses à l’appel à communication n’en comptaient guère plus.
Non que le présent livre se targuerait d’apporter sûrement une réponse à cette éventuelle « anomalie », mais simplement pour prendre acte de cette quasi-absence et surtout du peu de perplexité qu’elle a suscité ici et là. S’il existe, d’entrée de jeu, un argument à l’appui d’une hétérogénéité ou d’une « contingence » du phénomène colonial à l’échelle mondiale et partant, de ses effets (Bayart, 2009, p. 21-33), ce constat initial installe définitivement cette diversité, en effet.
Cependant, à la lecture des propositions puis des textes que nous avons reçus, que de surprises !
Une grande diversité d’abord, voire moult contradictions ! En tout cas, ni là, ni ailleurs dans quelques travaux récents concernant le Maghreb, on ne lira de paradigme tranchant sur le postcolonial ou le post-colonial.
Ainsi ce livre n’a-t-il ni l’ambition, ni même le désir, de se ranger dans la « bibliothèque postcoloniale ou post-coloniale ».
En privilégiant ex ante une approche microsociale, en recommandant de donner le pas aux archives, si possible non étatiques, ce qui bien sûr n’a pas toujours été possible, en tout cas aux terrains, aux acteurs et aux pratiques, et non aux idées, aux représentations ou aux débats, il n’est pas surprenant que nous ayons récolté tout à fait autre chose que le discours habituel sur l’après colonie.
“... Traces, désir de savoir et volonté d’être”, annoncent titre et sous titre, minimalistes mais fédérateurs.
Toujours vivantes en tout cas, au sens de prêtes à produire des effets, à bourgeonner, à « repartir » selon le langage des jardiniers. Sur ce point au moins, nous ne nous étions pas trompés. Il y a encore à dire, et pour longtemps encore. Cela signifierait-il qu’il n’y a pas eu de vide, de hiatus entre avant et après… Après quoi, en fait ? La dérive des continents ? La « fracture coloniale » ? Le départ des envahisseurs ? Le « chacun chez soi », enfin.
Mais justement, la lecture de l’ensemble montre au moins que rien de tout cela n’a vraiment, totalement, eu lieu, alors même, il serait fou de le nier, que plus rien n’est désormais comme « avant », les demandeurs de visas et d’asile en savent, eux, quelque chose !
En fait, on assisterait plutôt à la prolifération de signes parlants, voire revendicatifs, qui renverraient bien à l’expérience d’une « mixité », à la fois imaginaire et concrète, et pas seulement d’affrontements. Quelque chose comme le fantôme insistant d’un patrimoine matériel et immatériel « commun » mais dans un paysage encore brumeux.
Un manque se profilerait – comme une faille accidentelle qu’on croyait (voudrait ?) refermée – qui affecterait aussi bien les anciens colonisateurs que les sociétés qui ont été colonisées, auquel parfois les mots manqueraient peut être pour se dire tout à fait.
De quoi ne parle-t-on pas ici, ou très peu ?
Au départ, il y a eu le pari, voire l’imprudence, de convier pour plus de moitié, de jeunes contributeurs nés après ou très peu avant la décolonisation, des deux côtés de la ligne de partage, avec des auteurs confirmés, nécessairement plus directement impliqués dans l’histoire récente, parlant eux-aussi des deux côtés de la mer.
Or, en simplifiant à peine, on peut dire que les uns et les autres et nous tous avec eux, avons en commun d’avoir été formés dans un paysage intellectuel qui manque aujourd’hui encore cruellement, toutes époques confondues, d’une véritable ethnographie de l’expérience vécue de la domination coloniale (Bayart, 2009, op. cit.) au sens de « situation coloniale » (Balandier) comme « phénomène social total ». Même si les uns l’ont vécue directement, d’autres approchée à travers les guerres.
Ainsi, s’il est probable que se fait désormais jour une « demande sociale d’histoire » (Abécassis & Meynier, 2008, p. 193) et pas seulement de mémoire, il est clair que l’histoire sociale est loin d’être reine (pour retourner une formule d’Henri Moniot, 1976) sur la question coloniale et post coloniale.
... Contrairement en effet à ce que proposait notre appel à contributions, les textes ici présents, pris individuellement, parlent généralement assez peu d’une histoire partagée au sein de sociétés dites « coloniales », certes complexes et mal connues.
Histoires partagées, c’eut été des histoires pas seulement de domination, d’inégalités et de violences, rapports qui ont, à l’évidence réellement existé, mais également de rencontres, de productions communes, de « lieux communs » à tous les sens du terme (voir le français d’Afrique du Nord tel qu’il est couramment parlé aujourd’hui outre-Méditerranée et qui véhicule tant de scories), parce que histoire d’une terre commune, d’une temporalité vécue côte-à-côte, même transitivement et sur le mode inégalitaire. Un bout de chemin commun.
Or, ce qu’on entend ici à quelques exceptions près, ce sont plutôt des histoires cloisonnées . Il est rarement question, autrement que comme lignes de fuite, ou sur le mode allusif, d’une ethnographie de la pluralité et de la cohabitation, des « espaces de contacts » entre populations différentes alors même que plusieurs des objets retenus s’y prêteraient.
... Comment s’en étonner, alors que depuis plus d’un demi siècle, on a privilégié des deux côtés de la mer, les constructions politiques et les représentations idéologiques qui allaient avec, le retour à l’autonomie, à la dignité recouvrée, mais aussi à la séparation, au durcissement des frontières, au « chacun chez soi ». Dans un geste de table-rase, voulant faire comme si rien ne s’était passé pendant deux siècles. Il y a peu encore, le constat qui s’imposait était plutôt celui de la distance et de la séparation dans les faits.
Que sont devenus, en effet, les pêcheurs siciliens de Mahdia en Tunisie (Hamza, 1993), un si beau texte entendu dans les années 1970 à Tunis, ou les jardiniers mahonnais de Fort de l’Eau en Algérie ?
Et pourtant, les questions à l’œuvre dans ce foisonnement relativement nouveau de curiosités pour un passé soumis de part et d’autre au récit nationaliste, si elles ne parlent pas, ou guère, de partage, produisent sous l’effet de la mondialisation, quelque chose de tout à fait autre que la polémique. On n’y lit pas le rejet violent ou au contraire la nostalgie mais des interrogations et des revendications multiples dans le social, dans la production artistique, dans les médias, dans le quotidien en somme, aussi bien de la part et à l’adresse des sociétés maghrébines qu’à celle des ex-colonisatrices, et de leurs minorités diasporiques ou immigrées.
De quoi ça parle ?
Agencé en quatre séquences aux titres décisoirement abrupts, le livre présente, comme s’il racontait une seule et même histoire, avec un début et un dénouement, un appariement somme toute inattendu de textes sans air de famille entre eux, ni toujours de communauté de thèmes, rapprochement destiné à susciter une lecture étonnée.
Au commencement, peut-on lire, étaient des guerres productrices de migrations qui n’ont jamais dit leur vrai nom,
dont on soupçonne à peine à quel point elles impliquèrent aussi les peuples voisins.
En boule de billard, ces violences ont déplacé des hommes et des femmes, propulsés par des pouvoirs pressés de déverser hors de leurs frontières leurs flots de pauvres, ou fuyant les territoires agressés.
Flux humains qui ont planté, aimé et finalement, le plus souvent, déserté les rives où ils avaient été jetés.
Puis on éventra la terre tandis qu’on pensait à prendre soin des corps et des âmes.
Rapprocher la mine, la médecine humaniste et la « mission », c’est faire surgir de facto la question incontournable de l’ambiguïté et des effets paradoxaux, commune à l’exploitation capitaliste, comme on dit, et à l’universalisme, éventuellement chrétien : par l’une et l’autre, les sociétés maghrébines vont découvrir d’un coté, la grève et le statut de prolétaire puis de travailleur expatrié, de l’autre, un rapport « moralisé » et maîtrisé à la maladie, et donc à l’individu, qui vont marquer durablement voire irrémédiablement leur ethos économique, voire leur ethos tout court.
Révoltés, revendicatifs ou résignés, les humains de tous bords pris dans ces tempêtes ont inventé chacun, individuellement ou parfois en groupes, leurs luttes.
Cinq registres de la revendication identitaire sont présents ici : le Bandit montagnard berbère ; l’Européen, autrement dit « Pied noir », qui ne se sent ni français, ni algérien (ni juif) ; l’Autre, qui veut devenir français pour simplement vivre ; l’Algérien, prêt à prouver qu’il est français depuis longtemps sinon depuis toujours ; le Jeune d’origine maghrébine enfin, français de droit par le jus soli mais cherchant au-delà à sauvegarder son ipséité.
Ce qui frappe le plus ici, c’est le côté pragmatique, comme « primordial », de la revendication, presque totalement exempte d’idéologie.
Quand tout fut presque cassé, alors on songea à construire de belles nécropoles, des opéras et même des ponts humains.
Le voyage, les remues associatives, l’esthétisme, « les soins à donner aux morts », pour reprendre une belle expression augustinienne, seraient-ils les ingrédients indispensables de la « réparation » au sens quasi matériel du terme, ou plutôt de la continuation, quand la continuité n’est plus là ?
... Certes on a, au fil des pages, la surprise de constater des symétries inattendues (qui n’ont absolument pas été induites), des paires plus ou moins évidentes : le voisin en guerre qui se bat contre l’oppresseur, la mine, la nationalité, les signes architecturaux qui marquent l’espace, l’entretien du souvenir, le refus du couple nostalgie/chauvinisme, signes que certaines urgences, certaines préoccupations étaient dans l’air.
Inversement, de nettes différences de sensibilité, dans le choix et surtout le traitement des objets, opposent les textes se référant à la Tunisie et par exemple ceux à propos de l’Algérie, soulignant « la nature contingente de la colonisation » déjà évoquée, qui ne fut pas la même partout.
... En réalité, malgré sa tournure ironiquement téléologique, ce « roman » nous introduit très directement aux contradictions de la colonisation comme à celles de la décolonisation, nous disant au passage des choses que nous ne savions pas.
Ainsi s’il parle d’héroïsme, c’est seulement de celui des insurgés voisins, jamais de celui des siens propres !
Il dit l’ingratitude aussi, de l’amitié trahie entre les peuples et en particulier, en creux, de cette Union du Maghreb, ou de ce Maghreb uni, qui n’a pas vu le jour.
Il rappelle, comme au passage, les inégalités « secondes » c’est à dire non avouées, aussi bien entre « dominants » qu’entre « dominés » (Italiens, Berbères, autres méditerranéens pauvres). Il parle d’artistes intéressés par l’hybridation des formes.
Enfin, les ex-colonisateurs, n’y sont montrés ni comme laissés pour compte ni même comme faire-valoir, pas plus que ces populations tierces, aux déplacements de quelques années ou de toute une vie, aux motivations singulières, que sont les émigrés/immigrés, les diasporés, les missionnaires d’obédiences diverses et leurs descendants, à jamais marqués, qui ensemble figurent presque pour un tiers des contributions.
Ce qu’ils laissent comprendre de « l’expérience de subjectivation » (Foucault, invoqué par Bayart, 2004, chap. 4) qu’a représenté pour eux de naître ou simplement de vivre assez longtemps sur des terres « autres » fait écho par exemple à ce si beau livre de Jean-Marie Le Clézio, L’Africain, (2004) où l’auteur, fils d’un médecin blanc en Afrique subsaharienne dont il s’efforce de comprendre a posteriori la vie, avoue que longtemps, il avait cru que sa mère était africaine !
Ces textes font saisir que le désir des individus dominants n’était pas principalement / toujours un désir de domination mais le désir tout court pour un monde autre.
...
En guise de conclusion…
Revenir, pour finir, à la question non subsidiaire soulevée au début, celle de l’absence plus ou moins patente du Maghreb dans le débat sur le postcolonial, n’est pas vouloir chevaucher deux montures à la fois. Cette « enquête » nous apprend-elle quelque chose à ce sujet ? Quelques éléments de réponse, sans doute partiels et provisoires, sont suggérés ci-dessous.
D’une part, le débat a déjà eu lieu, comme le souligne Jean- François Bayart (Bayart, 2009, p. 8 et sq.), rappelant les prises de position de Sartre, Leiris, Fanon, dans les années 1950 et 1960, celles précisément de la décolonisation politique du Maghreb, auxquels on peut ajouter Laroui, Le Mal de voir et quelques autres, dans les années 1970. Mais il apparaît sans doute trop tôt, reste cantonné au niveau des paradigmes, voire des idéologies, et demeure plus ou moins inachevé : il ne produit pas véritablement de subaltern studies, par exemple, au sens de la nécessaire remise en question de la version nationaliste canonique des luttes de libération. Au contraire, il n’est pas sans générer alors contresens et dégâts politiques majeurs (pensons aux effets ravageurs du paradigme du déracinement sur la politique agraire de la jeune république socialiste algérienne (Colonna, 1980) ou à l’interdiction officielle de l’anthropologie comme discipline universitaire en Algérie pendant 40 ans !)
Or il est plus que probable que c’est la précocité de ce radicalisme, le plus souvent ignorant des réalités concrètes, qui a mithridatisé sinon la génération immédiatement post-indépendance de jeunes chercheurs maghrébins, du moins à coup sûr la suivante, celle à laquelle nous avons à faire aujourd’hui.
D’où le style non agonistique, peu batailleur, peu débatteur, des contributions mais en même temps, plutôt autocentré et comme défensif.
On s’y défend moins d’une domination extérieure que d’une doxa intérieure devenue insupportable qui interdisait aussi de prendre en compte le proche, le local, le particulier. Le soi, en somme.
Demeure au-delà une spécificité maghrébine résistante, liée peut être à une assez longue durée de la colonisation. Et le rapprochement de Jacques Pouchepadas avec l’Afrique du Sud fait ici, jusqu’à un certain point, sens.
Sachant en outre qu’une ancienne et profonde proximité culturelle des élites endogènes avec les codes des dominants s’était déjà produite à des moments historiques répétés (pensons à Fronton de Cirta, précepteur de l’empereur Marc Aurèle, ou à Augustin d’Hippone, éminent Père de l’Eglise, qui se revendiquent libyens l’un et l’autre, tout en accédant au summum de la centralité, pour dire très vite, de leurs siècles respectifs, les IIe et Ve ; mais on pourrait faire le même raisonnement cette fois en invoquant la vigueur de la culture arabe et ses fleurons, Ibn Khaldun, etc.).
Même s’il n’y a pas de rapport de causalité, à Dieu ne plaise, il y a ici répétition qui ne peut être hasard.
Aussi, ce n’est probablement pas Empire(s) qu’il faut penser à propos du Maghreb, mais nappes ou vagues successives et alternées de brassages humains, d’hégémonies politiques et d’expansions culturelles, pourrait-on dire, à défaut de mieux : langues, musiques, onomastique, morphotypes humains, toponymie, paysages, religions, tout cela se ressemble tellement d’une rive à l’autre !
Proximité géographique avec l’Europe méditerranéenne sans doute, pas seulement avec la France, l’Italie, l’Espagne ; mais peut être surtout avec les îles, la Corse, Malte, la Sicile, véritables laboratoires de spécificités et pourtant sources inépuisables de flux démographiques.
C’est une histoire très embrouillée, qui dure depuis trop longtemps pour que la colonisation ait pu être autre chose qu’un épisode tragique, gravissime certes et qui aurait pu être mortel pour l’intégrité des sociétés concernées.
Mais qui, aux dernières nouvelles, ne l’a pas été, en dépit de tout, et de l’adversité.
Un point de vue beaucoup moins paradoxal qu’il n’y paraît quand on considère le problème depuis le Maroc ou la Tunisie. Du coup, la notion de métissage est impensée, sinon impensable (pour une opinion contraire, mais paradoxalement révélatrice en tant qu’exemple, Yellès, 2005) et très fortement rejetée dans les usages sociaux in-situ, car tout, déjà, a été terriblement mé-tissé depuis des millénaires.
Du coup encore, ce paradoxe de l’effacement mais aussi du désir du proche, trop semblable, vaguement dangereux pour l’intégrité de soi.
La justification et l’intérêt de cette étape intellectuelle était d’en prendre la mesure aujourd’hui.
Bibliographie
Abécassis F. & Meynier G., 2008, “Pour une histoire franco algérienne. En finir avec les pressions officielles et les lobbies de mémoire”, La Découverte, Paris.
Bayart J.-F., 2009, « Les études postcoloniales, une invention politique de la tradition » Sociétés politiques comparées, n°14 en ligne, URL : http://www.fasopo.org, page consultée le 8 novembre 2009.
Bayart J.-F., 2004, « Le Gouvernement du monde. Une critique politique de la globalisation », Fayard, Paris.
Bertrand R., 2008, « Politiques du moment colonial. Historicités indigènes et rapports vernaculaires au politique en "situation coloniale" »
Questions de recherche, CERI, n°26 en ligne, URL : http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm, page consultée le 9 novembre 2009.
Colonna F., 1980, « Paysans et encadreurs, à propos des transferts de savoir et modèles entre villes et campagnes en Algérie », “Système urbain et développement au Maghreb”, Cérès Productions, Tunis, p. 318-341.
Ginzburg C., 1989, « Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et Histoire », Flammarion, Paris.
Hamza R., 1993, « Les pêcheurs saisonniers italiens à Mahdia (1871-1945) », in Colonna F. (dir.), “Être marginal au Maghreb,” CNRS Editions, Paris, p. 155-160.
Larguèche A. (et al.), 2006, « Les communautés méditerranéennes de Tunisie », Centre de publication universitaire, Tunis.
Le Clézio J.M.G., 2004, L’Africain, Mercure de France, Paris.
Macherey P., 1966, « Pour une théorie de la production littéraire », Maspero, Paris.
Moniot H. (dir.), 1976, « Le mal de voir. Ethnologie et orientalisme : politique et épistémologie, critique et autocritique… », Université Paris VII, « Cahiers de Jussieu n°2 » Union Générale d’Édition, Collection « 10/18 », Paris.
Pouchepadas J., 2008, « Les émeutes du "93" sont elles postcoloniales ? », “L’Homme”, vol. 3-4, n°187-188, p. 413-421.
Warburg A., 2003, « Essais florentins », Klincksieck, Paris.
Yelles M., 2005, « Cultures et métissages en Algérie. La racine et la trace », L’Harmattan, Paris.